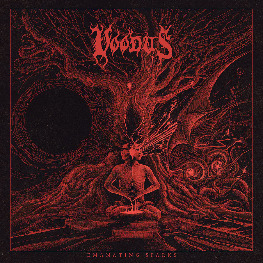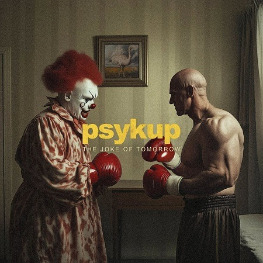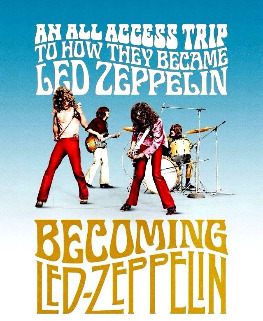Nourishment
Flesh Mother
23/01/2018
Autoproduction
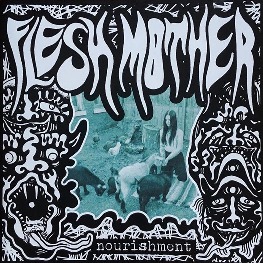
Voilà une pochette qui sent bon le Larzac, la vie à la fraîche, le lait de chèvre, le laid de chanvre, les robes de chambre, et qui s’entortille autour de vos mirettes comme les poils de barbe d’un vieux beatnik perdu dans les limbes post-soixante-huitardes. On imagine assez bien cette demoiselle avec un chemisier blanc en lin, s’extasier devant la beauté d’un parterre de marguerites sauvages, chantant et dansant la nature en ressentant soudainement le besoin de s’affranchir de toute couche de tissu superflu. Mais pas de bol pour vous sales petits voyeurs virtuels à deux sous, cette scène se passe à Cincinnati dans l’Ohio, et en guise de communion avec mère nature, vous allez vous cogner un EP/LP de Sludge bien poisseux, urbain comme un chewing-gum collé sous une godasse à l’heure de pointe, et sale comme un container de quartier qui vomit ses immondices par ses interstices. Et vous savez quoi ? Finalement, le tableau me plait infiniment plus qu’une ode champêtre dédiée aux existentialistes ruraux exilés pour cause de ras-le-bol du métro. Hop. Pas de malaise.
Mais vous en risquez un par contre en confiant vos tympans à cette horde de pesants qui n’ont pas oublié la lourdeur et la graisse dans la poche de leur salopette. Leur unique but semble en effet de rendre concrète la dualité qui existe entre l’oppression et l’agression, en confrontant les deux concepts dans un même exutoire, à deux tiers du chemin entre le Sludge sud-américain que la vague Nola affectionne tant, et un tiers des poussées de colère des PRIMITIVE MAN et autres NAILS. Pour autant, c’est tout de même le Heavy qui l’emporte sur l’embolie, même si le dénominateur commun reste la folie. Et sur ce sujet-là, nos amis du jour semblent incollables.
Entendons-nous bien, le Sludge, on commence à connaître aussi bien qu’un fan d’Ozzy et Tony ses idoles de BLACK SABBATH en 1975. On se disait justement que le style, comme celui de ses aînés commençait à tourner en rond, sauf qu’à chaque fois que cette assertion affleure la surface de la raison, une bande de tarés se pointe avec son esprit de contradiction. C’est le cas des FLESH MOTHER, qui tout en respectant les dogmes du créneau qu’ils honorent, prennent leurs distances pour affirmer leur indépendance, et nous offrent un premier jet presque longue-durée qui remet le débat sur le tapis usé. D’un coup de dés (ou de sept, plus exactement), les originaires de l’Ohio ne se demandent pas d’où en vient le O, mais en fond de jolis avec la fumée qui sort de leurs instruments. Riffs de mammouth, voix rauque dégueulée, basse pachydermique assurée, rythmique plombée, tout y est pour que notre compte soit bon, sauf qu’en plus, les gus y ajoutent deux ou trois soudaines accélérations. Alors, on ne sait plus trop sur quel pied stagner, puisque la surprise nous guette à chaque rangée, bien que la cohésion de l’ensemble soit confortée. Lourd donc, mais aussi nerveux, et surtout, créatif dans la méchanceté, puisque ce Nourishment aux accents aussi psychédéliques que dissonants n’évite aucunement de nous provoquer. D’une part, avec l’utilisation d’un format très court pour des morceaux du cru, bien cuits, qui ne dépassent que très rarement les trois minutes (une seule fois d’ailleurs). Le Sludge et le Doom nous ont habitués à des digressions bien plus élargies, et c’est avec un plaisir non feint que l’on constate que certains osent enfin bousculer les conventions pour modifier notre horizon. D’autre part, et ce dès l’introductif et glauque « High Power » - et son riff à faire verdir de dégoût Kirk Windstein accro à ELECTRIC WIZARD - FLESH MOTHER n’hésite pas à se barrer en couille Grind et Crust pour ne pas nous laisser nous installer trop confortablement dans notre foi aveugle en des prévisions trop certaines.
Mais pas de méprise. Les lascars sont Sludge quand même, et ce, jusqu’aux trous de leurs chaussettes. Ils sont simplement un peu plus que des feignasses lambda qui se reposent sur un thème unique pour causer la panique.
Et ce bouillonnement de puissance nous fascine. En tout cas, ME fascine, parce qu’un groupe qui parvient à me faire apprécier la lourdeur par contraste de terreur, je suis preneur. D’autant plus qu’ils ont travaillé leur copie pour la rendre impeccable et sans fouillis, en bossant les transitions histoire que l’eau continue de couler sous les ponts. Un travail de mixage presque digne de celui de sir George Martin sur Sgt Pepper (j’exagère à peine, mais je suis de bonne humeur), pour seize minutes de logique instrumentale à deux voix parfois (John Hays & Tyler Bollinger), le tout dissimulé sous une production impeccable de John Hoffman et Jerome Westerkamp. Et ne cherchez pas à en savoir plus sur le produit en question, puisque les facétieux n’ont ni page Facebook, si site sous leur propre nom. Quant à leur Bandcamp, il préfère se taire et laisser parler la musique. Ce qu’il y a de mieux à faire, puisqu’elle parle beaucoup mieux que n’importe quel argument présomptueux. On pourrait même dire que les musiciens l’ont tellement mauvaise qu’ils nous la jouent bonne, en affirmant qu’après tout, nous « ne sommes pas humain, juste une maladie ». Et ils n’ont pas tort. Sauf que leur virus à eux est du genre pur et non muté, et qu’il galvanise l’organisme tout en faisant descendre le moral en flèche. Paradoxal ? Pas tant que ça, puisque Sludge mais pas que. Et ce groove qui sort de nulle part sur « Disgusting Creatures », fabuleux non ? Et ce sens de la concision mid sur le gluant « Lizard King », via une schizophrénie vocale pleine de mordant…Impeccable, je prends. Aussi. Des constats à l’avenant ? Oui, « Sick World / Sick Shit », qui s’accompagne d’une embardée de blasts à main levée, et d’un mélange d’OLD et EYEHATEGOD. Effets offerts par la maison, et larsen trituré plus que de raison.
Basse profonde comme une tombe sur laquelle des poivrots pissent (« Felt Death », le fameux à presque franchir la barre des quatre minutes), tombe en elle-même pas vraiment fleurie mais qui sent bon le bourbier Sludge bien moisi (« Graves »), et puis…c’est fini. Mais pour eux, l’aventure commence, ou continue plutôt (vous référer à leur Bandcamp pour en savoir plus sur leur passé, j’ai la flemme). Elle continue dans l’Ohio, et ne finira pas dans le Larzac, puisque les FLESH MOTHER sont à peu près aussi américains que les bayous de Louisiane. Et il n’y a pas de chèvre dans les bayous.
Titres de l'album:
- High Power
- Lizard King
- Hounds
- Disgusting Creatures
- Sick World-Sick Shit
- Graves
- Felt Death
Derniers articles
Concerts à 7 jours
Tags
Photos stream
Derniers commentaires
Un report ? Je crois que j’y reviendrai l’an prochain mais deux jours afin de mieux profiter. J’en connais qui ont du moins apprécier le camping avec l’orage du dernier soir
16/05/2025, 06:52
Avec Massacra legacy, ça commence nettement à avoir plus de gueule ! Reste à voir la suite des annonces. Mais je crois que je vais plus préférer le Westill le mois suivant au même endroit cette année, déjà Elder et Wytch Hazel de confi(...)
13/05/2025, 07:48
Mea culpa....J'avais pas vu la news en première page - j'ai été directement te répondre.
12/05/2025, 14:33
S'il est du même acabit que le The Cthulhian Pulse: Call From The Dead City sorti en 2020, Mountains of Madness risque d'être un allday listening pour moi.J'ai hâte, bordel !
12/05/2025, 13:44
J'étais passé totalement à côté de cette petite pépite de Death Suédois!Vieux moutard que jamais!Puteraeon glisse de belles ambiances lovecraftiennes sur cet album et les arrangements apportent un plus à l'ensemble.
12/05/2025, 13:42
Necro est sympa, avec de bons passages groovy et d'autres où le groupe envoie du bois.Pas sûr de l'écouter durablement, d'autant plus que le prochain Puteraeon sort le 30 avril prochain.
12/05/2025, 13:40
Sentiment mitigé pour ma part Le chant de Johan Lindqvist n'atteint pas un pouïème de ce qu(...)
12/05/2025, 13:38
Au vu de la dernière vidéo-ITW en date du gonze sur ce site, pour ce qui est de "feu sacré", il a toujours l'air de l'avoir le mec.Je pars donc confiant.
08/05/2025, 09:17
@ MobidOM :oui, pas faux pour la "captation d'héritage" ! :-/ En même temps, s'il a encore le feu sacré et propose un truc pas trop moisi... De toute façon la critique sera sans pitié si le truc ne tient pas la(...)
07/05/2025, 11:52
Ah ce fameux BRUTAL TOUR avec Loudblast / MASSACRA / No Return et Crusher en 95 ! LA PUTAIN de bonne époque
07/05/2025, 11:04
@ Oliv : Montpellier étant une ville et une agglomération plus petite que Lyon, il n'y a véritablement de la place que pour deux petites salles orientées Rock-Metal-Punk-etc, à ce qui me semble après vingt-cinq ans d'observation. Au-delà,(...)
06/05/2025, 20:29
"Death To All", à chaque fois que je les ai vu ils avaient un line-up tout à fait légitime (dont une fois tous les musiciens qui ont joué sur "Human", à part Chuck bien sûr)Et puis la phrase "Chris Palengat pr(...)
06/05/2025, 20:28
Je ne vois pas beaucoup l'intérêt, et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas attendu les trente ans de l'album l'an prochain. Ces dernières semaines je me retape les premiers, et ça reste un bonheur.
06/05/2025, 19:29
Vénérant ces albums et n'ayant jamais vu la vraie incarnation de Massacra, hors de question de louper ça (si ça passe à portée de paluche, pas à Pétaouchnok). Un peu comme un "Death To All"...
06/05/2025, 17:11