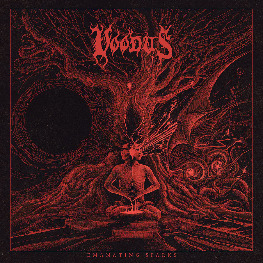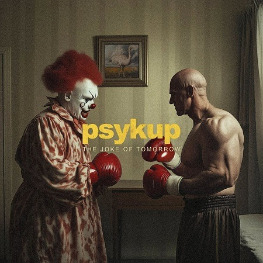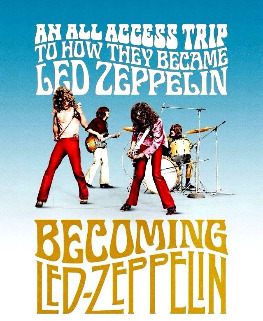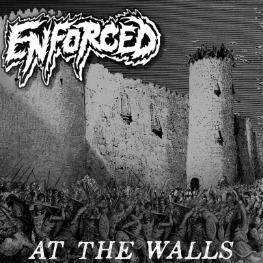Metalciné : le Mariage Impossible (Part II) - Show Me Your B.O
Myrkur, Marilyn Manson, Biohazard, Static-x, Faith No More
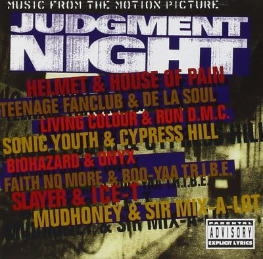
Après les documentaires, les biopics, abordons la plus grosse partie de ce dossier, elle-même en deux volets. Seront ainsi traitées les bandes-originales, et les fictions tournées sur l’univers du Metal, qui sont les deux catégories les plus vastes. Il aura fallu du temps pour que le Hard-Rock et le Heavy-Metal se fassent une place sur les B.O des films, mais une fois la boîte de Pandore ouverte, la playlist a pris des proportions dantesques. Une fois encore, cette liste ne sera pas exhaustive, il conviendra d’y ajouter vos propres entrées, mais le tour effectué est assez grand, et vous laisse largement de quoi (re)découvrir.
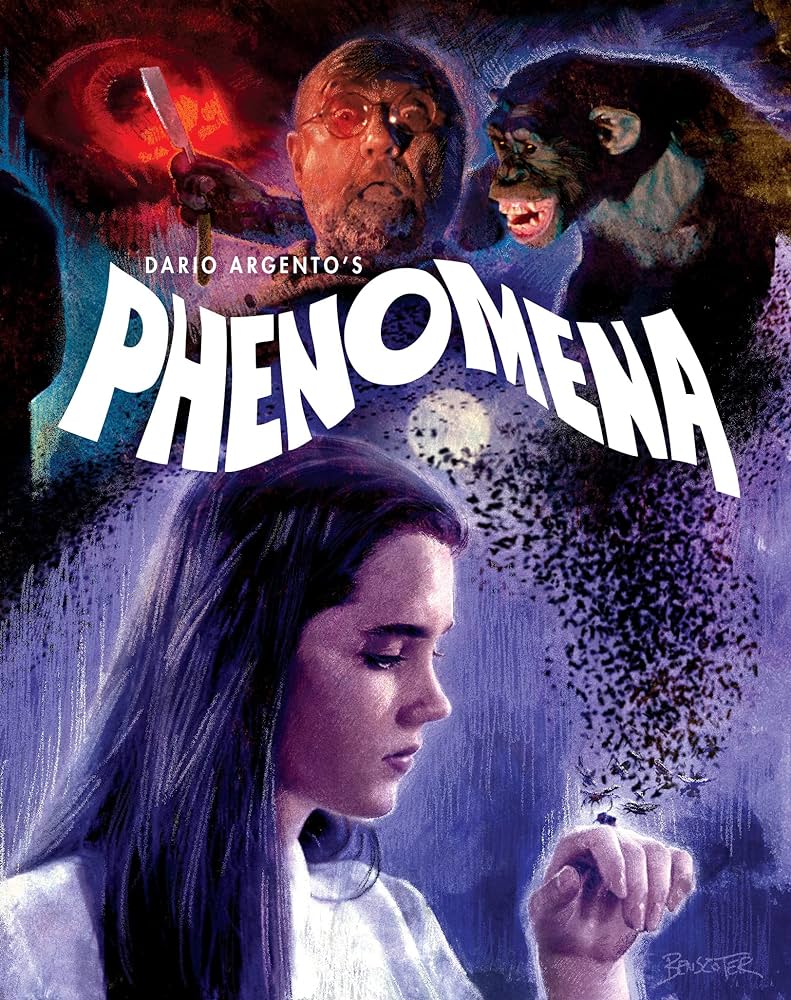 Commençons par le maître de l’horreur transalpine, Dario Argento. Ça n’est un secret pour personne, si le réalisateur italien a souvent confié ses musiques au groupe national GOBLIN, il n’en a pas moins caviardé ses réalisations de tubes Hard-Rock, dont Phenomena est l’exemple le plus probant. Découvert alors que j’étais déjà fan du maestro, et surtout à cause de la beauté incroyable de la jeune Jennifer Connelly, Phenomena est un souvenir de jeunesse encore très vivace, eu égard à deux de nos représentants dont les chansons rythment les passages les plus angoissants. La meilleure illustration filmique du classique « Flash of the Blade » d’IRON MAIDEN permet d’en apprécier l’ambiance électrique, renforcée par l’emploi ad hoc du « Locomotive » de MOTORHEAD. D’autres artistes plus ou moins proches trouvent refuge aussi, dont les mythiques ANDI SEXGANG, mais Phenomena a pu compter sur deux chansons fort à propos pour raconter son histoire de poignard télescopique.
Commençons par le maître de l’horreur transalpine, Dario Argento. Ça n’est un secret pour personne, si le réalisateur italien a souvent confié ses musiques au groupe national GOBLIN, il n’en a pas moins caviardé ses réalisations de tubes Hard-Rock, dont Phenomena est l’exemple le plus probant. Découvert alors que j’étais déjà fan du maestro, et surtout à cause de la beauté incroyable de la jeune Jennifer Connelly, Phenomena est un souvenir de jeunesse encore très vivace, eu égard à deux de nos représentants dont les chansons rythment les passages les plus angoissants. La meilleure illustration filmique du classique « Flash of the Blade » d’IRON MAIDEN permet d’en apprécier l’ambiance électrique, renforcée par l’emploi ad hoc du « Locomotive » de MOTORHEAD. D’autres artistes plus ou moins proches trouvent refuge aussi, dont les mythiques ANDI SEXGANG, mais Phenomena a pu compter sur deux chansons fort à propos pour raconter son histoire de poignard télescopique.
 En restant dans l’entourage de Dario Argento, impossible de ne pas parler du diptyque Demons de son petit protégé Lamberto Bava. Fils du grand Mario, l’inventeur du giallo et réalisateur incontournable de la nouvelle vague transalpine d’adaptation des fumetti, Lamberto n’a pas l’aura ni le talent de son père, mais nous laisse croire pendant quelques années qu’il sera capable de se dessiner une filmographie respectable. Après un initial et très pervers Macabro et ses fantasmes nécrophiles, et un plutôt moyen La Maison de la Terreur, Bava se lance dans le bricolage démoniaque et nous pond une histoire de cinéma hanté par des goules affreuses, dont les morsures sont évidemment contagieuses. Le premier volet, et le plus maîtrisé des deux est encore à ce jour une petite perle de cinéma bis pétrie de références. Cette histoire de masque hanté qui d’une simple éraflure engendre des légions de vilains est pour le moins croustillante, et permet au réalisateur de se laisser aller à quelques délires dont il a le secret, notamment avec cette scène surréaliste dans laquelle un hélicoptère traverse le plafond du cinéma pour venir s’écraser dans la salle. Il fallait du rythme, il fallait de l’agressivité, il fallait donc du Metal pour accompagner la fuite des survivants, et c’est avec MÖTLEY CRÜE, PRETTY MAIDS, ACCEPT, SAXON, que Bava nous fait tourner la tête, à défaut de nous la retourner. Le second volet est quasiment calqué sur le modèle du premier, avec cette fois-ci des téléviseurs en portails inter-dimensionnels, et un immeuble entier pris au piège des méchants. Mais pour cette séquelle, Bava s’interdit toute mesure, et laisse sortir ses horreurs dans les rues, préfigurant une invasion à l’échelle mondiale. Moins de sursauts, moins de costauds, la BO en pâtit aussi, et ne laisse guère que THE CULT pour représenter les masses amplifiées, tout en permettant à des références sérieuses comme DEAD CAN DANCE, FIELDS OF THE NEPHILIM, GENE LOVE GEZEBEL de se glisser dans l’ambiance.
En restant dans l’entourage de Dario Argento, impossible de ne pas parler du diptyque Demons de son petit protégé Lamberto Bava. Fils du grand Mario, l’inventeur du giallo et réalisateur incontournable de la nouvelle vague transalpine d’adaptation des fumetti, Lamberto n’a pas l’aura ni le talent de son père, mais nous laisse croire pendant quelques années qu’il sera capable de se dessiner une filmographie respectable. Après un initial et très pervers Macabro et ses fantasmes nécrophiles, et un plutôt moyen La Maison de la Terreur, Bava se lance dans le bricolage démoniaque et nous pond une histoire de cinéma hanté par des goules affreuses, dont les morsures sont évidemment contagieuses. Le premier volet, et le plus maîtrisé des deux est encore à ce jour une petite perle de cinéma bis pétrie de références. Cette histoire de masque hanté qui d’une simple éraflure engendre des légions de vilains est pour le moins croustillante, et permet au réalisateur de se laisser aller à quelques délires dont il a le secret, notamment avec cette scène surréaliste dans laquelle un hélicoptère traverse le plafond du cinéma pour venir s’écraser dans la salle. Il fallait du rythme, il fallait de l’agressivité, il fallait donc du Metal pour accompagner la fuite des survivants, et c’est avec MÖTLEY CRÜE, PRETTY MAIDS, ACCEPT, SAXON, que Bava nous fait tourner la tête, à défaut de nous la retourner. Le second volet est quasiment calqué sur le modèle du premier, avec cette fois-ci des téléviseurs en portails inter-dimensionnels, et un immeuble entier pris au piège des méchants. Mais pour cette séquelle, Bava s’interdit toute mesure, et laisse sortir ses horreurs dans les rues, préfigurant une invasion à l’échelle mondiale. Moins de sursauts, moins de costauds, la BO en pâtit aussi, et ne laisse guère que THE CULT pour représenter les masses amplifiées, tout en permettant à des références sérieuses comme DEAD CAN DANCE, FIELDS OF THE NEPHILIM, GENE LOVE GEZEBEL de se glisser dans l’ambiance.
 Autre exemple des années 80, Less Than Zero, aka Neige sur Beverly Hills en VF. Ce film de Marek Kanievska raconte l’histoire d’un étudiant de première année qui retourne à Los Angeles pour les vacances à la demande de son ex-petite amie, et qui découvre que son ancien meilleur ami a une dépendance à la drogue qu'il ne maîtrise pas. Avec la participation d’acteurs comme Robert Downey Jr. ou James Spader, et sur un scénario du sulfureux Bret Easton Ellis, Less Than Zero n’atteint pas la dramatique frapadingue du modèle American Psycho, mais délivre une partition tout à fait honnête. Partition sur laquelle s’incruste la crème de la crème de l’époque, avec un casting quatre étoiles. SLAYER, AEROSMITH, POISON, DAVID LEE ROTH, Joan JETT, Glenn DANZIG, THE CULT, les RED HOT CHILI PEPPERS se disputent le butin, apportant un peu de densité à un métrage certes honorable, mais loin de ses possibilités subversives d’origine.
Autre exemple des années 80, Less Than Zero, aka Neige sur Beverly Hills en VF. Ce film de Marek Kanievska raconte l’histoire d’un étudiant de première année qui retourne à Los Angeles pour les vacances à la demande de son ex-petite amie, et qui découvre que son ancien meilleur ami a une dépendance à la drogue qu'il ne maîtrise pas. Avec la participation d’acteurs comme Robert Downey Jr. ou James Spader, et sur un scénario du sulfureux Bret Easton Ellis, Less Than Zero n’atteint pas la dramatique frapadingue du modèle American Psycho, mais délivre une partition tout à fait honnête. Partition sur laquelle s’incruste la crème de la crème de l’époque, avec un casting quatre étoiles. SLAYER, AEROSMITH, POISON, DAVID LEE ROTH, Joan JETT, Glenn DANZIG, THE CULT, les RED HOT CHILI PEPPERS se disputent le butin, apportant un peu de densité à un métrage certes honorable, mais loin de ses possibilités subversives d’origine.
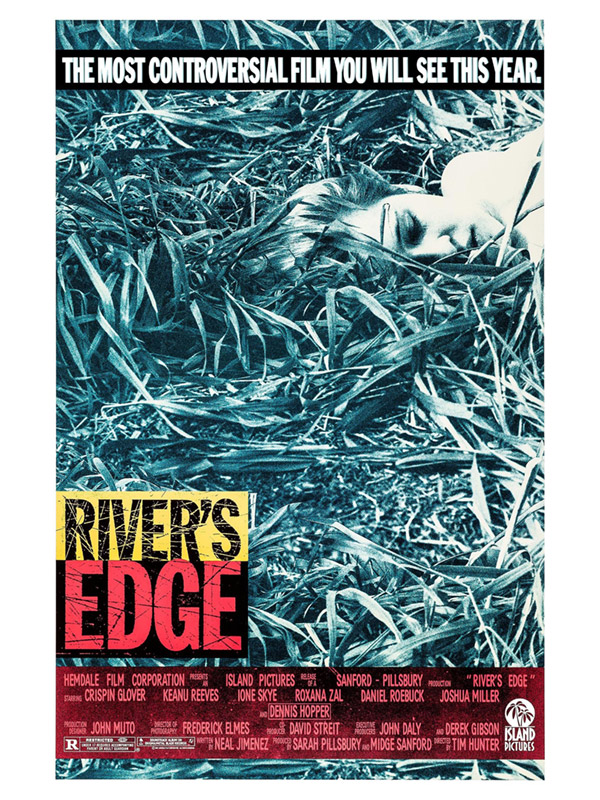 River's Edge aka La Rivière de la Mort apporte un tout autre éclairage sur la jeunesse américaine. Film âpre et violent, il permet de compter sur le charisme d’un jeune Keanu Reeves, parfaitement secondé par le déjà bargeot Crispin Glover. Samson 'John' Tollet (Daniel Roebuck) est un type pour le moins étrange. Mais personne n’aurait pu prévoir qu’il tuerait sa petite amie Jamie. Il a laissé son corps dénudé sur le bord de la rivière. Mais lorsqu’il l’a avoué à la communauté, personne ne l’a cru. Alors quand les gens découvrent le corps, ils doivent chacun apprendre à vivre avec. Centré sur une communauté lycéenne de glandeurs et de petits voyous, River's Edge est un film blême, loin du faste hollywoodien glorifiant les sportifs et les cheerleaders. Ici, ce sont les parias qui sont mis sous la lumière, et pour mieux sonoriser leur univers, Tim Hunter pioche dans le répertoire Metal et Hardcore US. S’éloignant des facilités, il met en avant les HALLOWS EVE, SLAYER, FATES WARNING, et AGENT ORANGE, rendant son film encore plus singulier. Il laisse d’ailleurs un goût très amer dans la bouche, et est régulièrement cité comme une œuvre dérangeante. Ce qu’il est assurément.
River's Edge aka La Rivière de la Mort apporte un tout autre éclairage sur la jeunesse américaine. Film âpre et violent, il permet de compter sur le charisme d’un jeune Keanu Reeves, parfaitement secondé par le déjà bargeot Crispin Glover. Samson 'John' Tollet (Daniel Roebuck) est un type pour le moins étrange. Mais personne n’aurait pu prévoir qu’il tuerait sa petite amie Jamie. Il a laissé son corps dénudé sur le bord de la rivière. Mais lorsqu’il l’a avoué à la communauté, personne ne l’a cru. Alors quand les gens découvrent le corps, ils doivent chacun apprendre à vivre avec. Centré sur une communauté lycéenne de glandeurs et de petits voyous, River's Edge est un film blême, loin du faste hollywoodien glorifiant les sportifs et les cheerleaders. Ici, ce sont les parias qui sont mis sous la lumière, et pour mieux sonoriser leur univers, Tim Hunter pioche dans le répertoire Metal et Hardcore US. S’éloignant des facilités, il met en avant les HALLOWS EVE, SLAYER, FATES WARNING, et AGENT ORANGE, rendant son film encore plus singulier. Il laisse d’ailleurs un goût très amer dans la bouche, et est régulièrement cité comme une œuvre dérangeante. Ce qu’il est assurément.
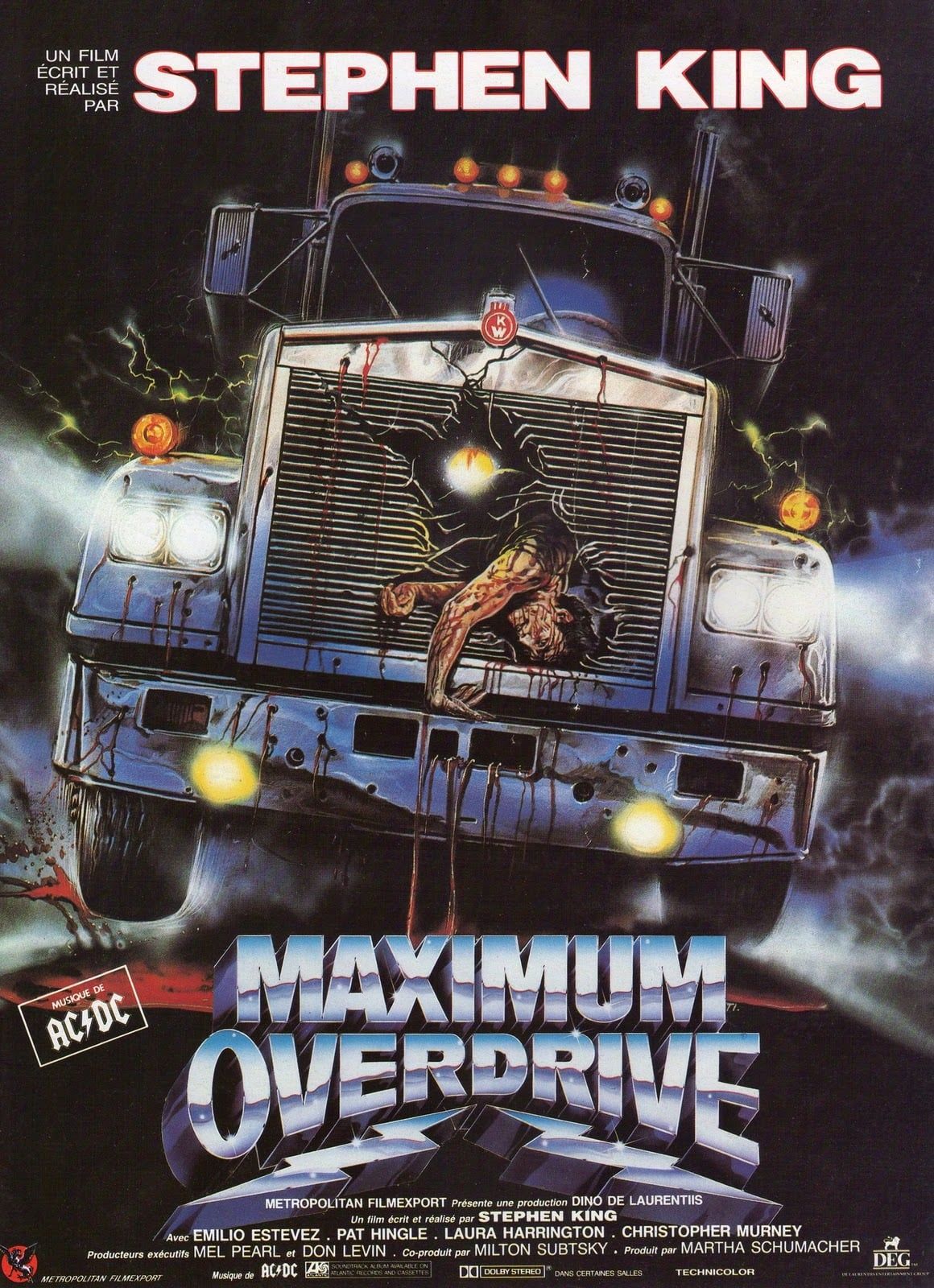 Maximum Overdrive choisit d’adapter Stephen King, et lance un gros pavé dans la mare. Centré sur un groupe de quidams luttant pour leur survie alors que les machines deviennent animées des plus mauvaises intentions, ce film exubérant et improbable s’attaque au côté obscur de l’œuvre de King, et tape dans ses nouvelles (Trucks en l’occurrence) pour flatter le public dans le sens du WTF. Si l’histoire est assez inhabituelle, le rendu n’en est pas pour autant effrayant, ni même captivant. Mais il y a quelque chose de jouissif à voir ces imbéciles tenter d’échapper aux monstres de fer et de tôle, plus particulièrement quand on s’intéresse de près à la musique les mettant en scène. AC/DC y tire sa couverture, avec une grosse dizaine de titres, entre « Sink the Pink », « You Shook Me All Night Long », « Hell’s Bells » et « Ride On ». Alors, évidemment, les Cahiers du Cinéma n’en ont pas fait tout un foin, mais voir des bagnoles dézinguer de pauvres hères sur fond de binaire austral est un plaisir qui ne se refuse pas.
Maximum Overdrive choisit d’adapter Stephen King, et lance un gros pavé dans la mare. Centré sur un groupe de quidams luttant pour leur survie alors que les machines deviennent animées des plus mauvaises intentions, ce film exubérant et improbable s’attaque au côté obscur de l’œuvre de King, et tape dans ses nouvelles (Trucks en l’occurrence) pour flatter le public dans le sens du WTF. Si l’histoire est assez inhabituelle, le rendu n’en est pas pour autant effrayant, ni même captivant. Mais il y a quelque chose de jouissif à voir ces imbéciles tenter d’échapper aux monstres de fer et de tôle, plus particulièrement quand on s’intéresse de près à la musique les mettant en scène. AC/DC y tire sa couverture, avec une grosse dizaine de titres, entre « Sink the Pink », « You Shook Me All Night Long », « Hell’s Bells » et « Ride On ». Alors, évidemment, les Cahiers du Cinéma n’en ont pas fait tout un foin, mais voir des bagnoles dézinguer de pauvres hères sur fond de binaire austral est un plaisir qui ne se refuse pas.
 Encore plus Metal ? Demandez à Wes Craven ce qu’il en pense, et il vous aiguillera sans aucun doute vers son foutraque Shocker. Et pour cause, puisque avec un pitch pareil, il y a de quoi se lâcher sur les watts. Horace Pinker, tueur en série exécuté sur la chaise électrique, utilise l'électricité pour revenir d'entre les morts et se venger du footballeur qui l'a dénoncé à la police. Bon, sur le papier, tout ça ne laissait pas augurer grand-chose de bon, et pourtant, en bon fourbe, Craven parvient à nous embarquer dans cette course-poursuite à la limite de l’absurde et du slapstick (cette scène inénarrable durant laquelle les deux protagonistes passent d’un programme TV à l’autre est restée gravée dans bien des mémoires, à l’inverse de Cineman). Pour mieux retranscrire l’ambiance électrique de l’affrontement entre notre héros et un Mitch Pileggi en roue libre (on est bien loin de la sobriété du futur directeur adjoint Skinner), Wes convie aux agapes de la violence toute une ribambelle de groupes, mais utilise aussi la carrure de Kane Roberts, alors guitariste d’Alice COOPER (également présent, mais sous forme d’images d’archives) venu donner un coup de pioche en passant. Quels groupes ? MEGADETH, BONFIRE, SARAYA, DANGEROUS TOYS, DEAD ON et VOODOO X, largement de quoi se sustenter des oreilles tout en contemplant un carnage savamment orchestré.
Encore plus Metal ? Demandez à Wes Craven ce qu’il en pense, et il vous aiguillera sans aucun doute vers son foutraque Shocker. Et pour cause, puisque avec un pitch pareil, il y a de quoi se lâcher sur les watts. Horace Pinker, tueur en série exécuté sur la chaise électrique, utilise l'électricité pour revenir d'entre les morts et se venger du footballeur qui l'a dénoncé à la police. Bon, sur le papier, tout ça ne laissait pas augurer grand-chose de bon, et pourtant, en bon fourbe, Craven parvient à nous embarquer dans cette course-poursuite à la limite de l’absurde et du slapstick (cette scène inénarrable durant laquelle les deux protagonistes passent d’un programme TV à l’autre est restée gravée dans bien des mémoires, à l’inverse de Cineman). Pour mieux retranscrire l’ambiance électrique de l’affrontement entre notre héros et un Mitch Pileggi en roue libre (on est bien loin de la sobriété du futur directeur adjoint Skinner), Wes convie aux agapes de la violence toute une ribambelle de groupes, mais utilise aussi la carrure de Kane Roberts, alors guitariste d’Alice COOPER (également présent, mais sous forme d’images d’archives) venu donner un coup de pioche en passant. Quels groupes ? MEGADETH, BONFIRE, SARAYA, DANGEROUS TOYS, DEAD ON et VOODOO X, largement de quoi se sustenter des oreilles tout en contemplant un carnage savamment orchestré.
 Judgement Night est un autre cas d’école, sa B.O proposant de confronter divers groupes de Metal et assimilés à des artistes issus du monde du Hip-Hop. Drame/thriller mineur de Stephen Hopkins, La Nuit du Jugement suit les aventures nocturnes de quatre amis en route vers un match de boxe qui prennent le mauvais raccourci, et deviennent témoins d’un meurtre. Emilio Estevez, Cuba Gooding JR, Stephen Dorff se glissent dans la peau de ces déambulateurs lambda qui font la mauvaise rencontre au mauvais moment, donnant corps à une œuvre sympathique à défaut d’être inoubliable. Ce qui l’est à l’inverse, ce sont ces collaborations entre HELMET et HOUSE OF PAIN, FAITH NO MORE et BOO-YAA T.R.I.B.E., BIOHAZARD et ONYX, LIVING COLOUR et RUN D.M.C, PEARL JAM et CYPRESS HILL, ou encore, dans le plus salé, SLAYER et ICE T. Alors que la Fusion est le genre à la mode le plus excitant, ces rencontres improbables accouchent de morceaux passés dans la légende. Ne le nions pas, cette B.O est le principal intérêt d’un film qui ne m’a pas marqué outre mesure. Elle est toujours aussi délicieuse des décennies plus tard, et mérite amplement de compléter votre collection.
Judgement Night est un autre cas d’école, sa B.O proposant de confronter divers groupes de Metal et assimilés à des artistes issus du monde du Hip-Hop. Drame/thriller mineur de Stephen Hopkins, La Nuit du Jugement suit les aventures nocturnes de quatre amis en route vers un match de boxe qui prennent le mauvais raccourci, et deviennent témoins d’un meurtre. Emilio Estevez, Cuba Gooding JR, Stephen Dorff se glissent dans la peau de ces déambulateurs lambda qui font la mauvaise rencontre au mauvais moment, donnant corps à une œuvre sympathique à défaut d’être inoubliable. Ce qui l’est à l’inverse, ce sont ces collaborations entre HELMET et HOUSE OF PAIN, FAITH NO MORE et BOO-YAA T.R.I.B.E., BIOHAZARD et ONYX, LIVING COLOUR et RUN D.M.C, PEARL JAM et CYPRESS HILL, ou encore, dans le plus salé, SLAYER et ICE T. Alors que la Fusion est le genre à la mode le plus excitant, ces rencontres improbables accouchent de morceaux passés dans la légende. Ne le nions pas, cette B.O est le principal intérêt d’un film qui ne m’a pas marqué outre mesure. Elle est toujours aussi délicieuse des décennies plus tard, et mérite amplement de compléter votre collection.
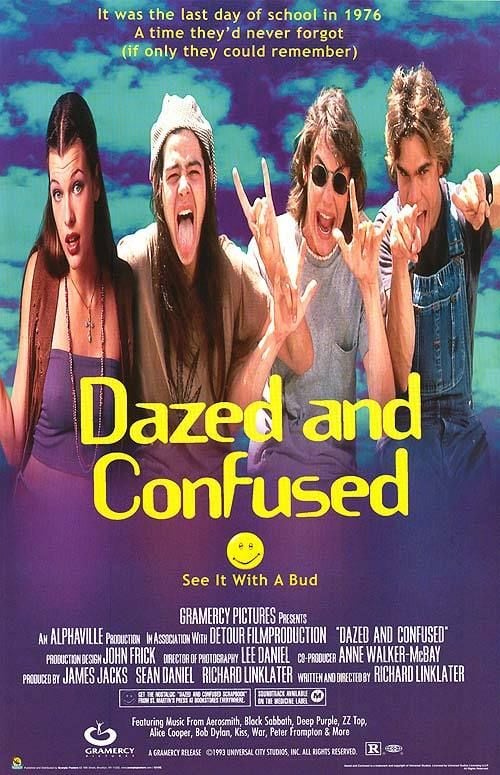 Même année, mais univers différent pour Dazed and Confused. Stupidement traduit par un lénifiant Génération Rebelle chez nous, ce film du surdoué Richard Linklater (Before Midnight, le marathon en temps réel Boyhood, le sous-estimé A Scanner Darkly) rend évidemment hommage à LED ZEPPELIN, et brosse le portrait de collégiens et lycéens le dernier jour d'école de mai 1976. Un pitch réduit à la portion congrue, comme Linklater les adore, mais une maestria de mise en scène époustouflante, vous donnant l’impression que cette journée dure toutes les vacances d’été. Parfaitement aidé par un casting impeccable (Matthew McConaughey, Milla Jovovich, Jason London, Joey Lauren Adams et bien d’autres), Richard Linklater continue son exploration d’un quotidien non altéré, et laisse ses interprètes donner le ton de ce portrait sans fard de l’adolescence américaine. Il convenait évidemment de laisser siffler les groupes les plus emblématiques de cette époque, et c’est avec plaisir que FOGHAT, Ted NUGENT, SWEET, Alice COOPER, ZZ TOP, LYNYRD SKYNYRD, DEEP PURPLE, BLACK SABBATH et KISS rythment les amours, les emmerdes, les peurs et les peines de ces lycéens aux fortunes diverses. A écouter en vinyle bien sûr, pour respirer le souffle d’époque.
Même année, mais univers différent pour Dazed and Confused. Stupidement traduit par un lénifiant Génération Rebelle chez nous, ce film du surdoué Richard Linklater (Before Midnight, le marathon en temps réel Boyhood, le sous-estimé A Scanner Darkly) rend évidemment hommage à LED ZEPPELIN, et brosse le portrait de collégiens et lycéens le dernier jour d'école de mai 1976. Un pitch réduit à la portion congrue, comme Linklater les adore, mais une maestria de mise en scène époustouflante, vous donnant l’impression que cette journée dure toutes les vacances d’été. Parfaitement aidé par un casting impeccable (Matthew McConaughey, Milla Jovovich, Jason London, Joey Lauren Adams et bien d’autres), Richard Linklater continue son exploration d’un quotidien non altéré, et laisse ses interprètes donner le ton de ce portrait sans fard de l’adolescence américaine. Il convenait évidemment de laisser siffler les groupes les plus emblématiques de cette époque, et c’est avec plaisir que FOGHAT, Ted NUGENT, SWEET, Alice COOPER, ZZ TOP, LYNYRD SKYNYRD, DEEP PURPLE, BLACK SABBATH et KISS rythment les amours, les emmerdes, les peurs et les peines de ces lycéens aux fortunes diverses. A écouter en vinyle bien sûr, pour respirer le souffle d’époque.
 Trois ans auparavant, le cas de Hardware était assez intéressant. Bien que le film de Richard Stanley soit loin du chef d’œuvre, avec son histoire de Cyborg revenant à la vie, la présence de quelques morceaux mais aussi de certaines de nos stars en font un intrus assez croustillant. Outre Iggy Pop en voix-off et Lemmy en chauffeur de taxi, la bande-originale propose évidemment un titre des deux musiciens susnommés, ainsi que quelques petites friandises, comme le classique « Stigmata » de MINISTRY. Pas de quoi relever le niveau assez haut pour envisager un achat en DVD, mais de quoi donner envie de se plonger avec précaution dans cette histoire post-apocalyptique bancale et bâclée.
Trois ans auparavant, le cas de Hardware était assez intéressant. Bien que le film de Richard Stanley soit loin du chef d’œuvre, avec son histoire de Cyborg revenant à la vie, la présence de quelques morceaux mais aussi de certaines de nos stars en font un intrus assez croustillant. Outre Iggy Pop en voix-off et Lemmy en chauffeur de taxi, la bande-originale propose évidemment un titre des deux musiciens susnommés, ainsi que quelques petites friandises, comme le classique « Stigmata » de MINISTRY. Pas de quoi relever le niveau assez haut pour envisager un achat en DVD, mais de quoi donner envie de se plonger avec précaution dans cette histoire post-apocalyptique bancale et bâclée.
 Beaucoup plus sérieux et enthousiasmant, Last Action Hero avec un Arnold au sommet de sa forme. Sur un principe simple de personnage de fiction devenant réalité pour un gamin, le film de John McTiernan dose admirablement bien action et humour. Accueilli assez fraichement à l’époque, ce blockbuster familial n’en est pas moins une réussite absolue dans les faits. Outre des sfx très valables, l’énergie qui s’en dégage est contagieuse, et on se laisse prendre au jeu de ce jeune Danny Madigan, perdu dans les films de son idole Jack Slater. Des punchlines savoureuses, un tandem attachant, des aventures pendant plus de deux heures, il fallait évidemment proposer une bande-son à la hauteur. John McTiernan pioche donc allègrement dans le réservoir Metal pour mettre en scène ses cascades, et nous propose une playlist alléchante, avec MEGADETH, ALICE IN CHAINS, DEF LEPPARD, TESLA, AC/DC, QUEENSRYCHE, FISHBONE, ANTHRAX et quelques autres. Adoubé par les masses Metal à l’époque, Last Action Hero est un cadeau de Noël qu’on ouvre avec toujours autant de paillettes dans les yeux, et reste à ce jour l’une des associations Metal/cinéma les plus crédibles.
Beaucoup plus sérieux et enthousiasmant, Last Action Hero avec un Arnold au sommet de sa forme. Sur un principe simple de personnage de fiction devenant réalité pour un gamin, le film de John McTiernan dose admirablement bien action et humour. Accueilli assez fraichement à l’époque, ce blockbuster familial n’en est pas moins une réussite absolue dans les faits. Outre des sfx très valables, l’énergie qui s’en dégage est contagieuse, et on se laisse prendre au jeu de ce jeune Danny Madigan, perdu dans les films de son idole Jack Slater. Des punchlines savoureuses, un tandem attachant, des aventures pendant plus de deux heures, il fallait évidemment proposer une bande-son à la hauteur. John McTiernan pioche donc allègrement dans le réservoir Metal pour mettre en scène ses cascades, et nous propose une playlist alléchante, avec MEGADETH, ALICE IN CHAINS, DEF LEPPARD, TESLA, AC/DC, QUEENSRYCHE, FISHBONE, ANTHRAX et quelques autres. Adoubé par les masses Metal à l’époque, Last Action Hero est un cadeau de Noël qu’on ouvre avec toujours autant de paillettes dans les yeux, et reste à ce jour l’une des associations Metal/cinéma les plus crédibles.
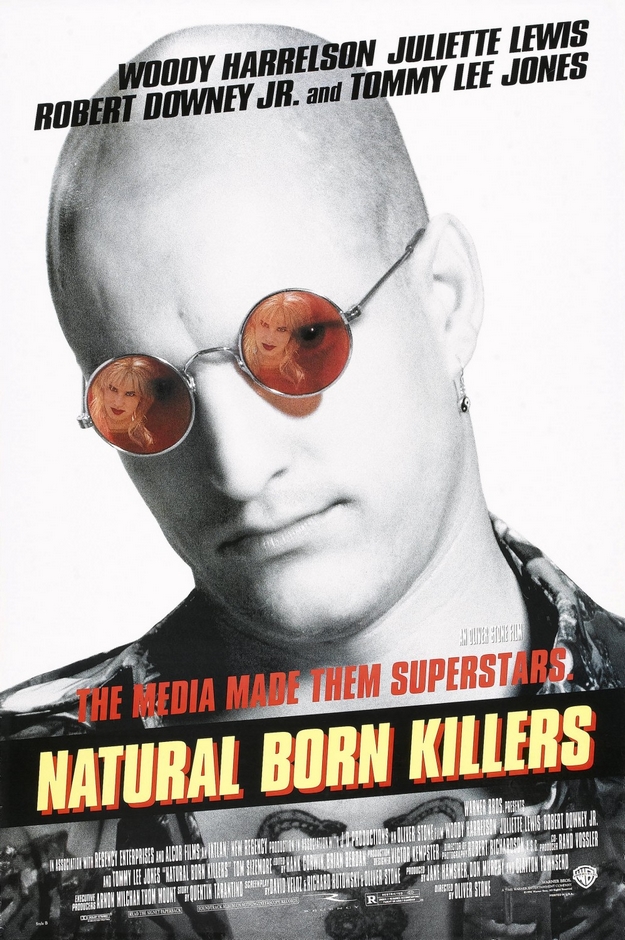 Natural Born Killers, l’un des films les plus controversés d’un des réalisateurs les plus controversés d’Hollywood, profite aussi de l’apport en puissance de morceaux bien choisis pour illustrer sa cavale mortelle d’un couple de serial-killers. Dénoncé comme étant la glamourisation du crime, Natural Born Killers s’en est pris plein la tête, le réalisateur étant plus habitué à filmer la guerre, ou à s’intéresser à des figures essentielles de l’histoire américaine. Mais très justement, en choisissant ce scénario écrit partiellement par Quentin Tarantino, Stone s’attaque au marketing organisé autour des tueurs les plus impitoyables de l’histoire des USA. Entre les biographies, les t-shirts, les objets dérivés, voire les œuvres d’art dans le cas de Gacy, l’hypocrisie d’un pays qui pointe du doigt ses enfants les plus meurtriers tout en capitalisant sur leur aura est ici mise à mal par un homme qui n’a jamais été avare en provocations. Dans les deux rôles principaux, Woody Harrelson et Juliette Lewis sont tout bonnement sidérants, dégageant une énergie animale, qui est toutefois sublimée par le personnage totalement halluciné de Robert Downey Jr. Ajoutons au casting un Tommy Lee Jones azimuté, un Tom Sizemore libidineux, et nous obtenons un petit miracle de violence exacerbée. Mis en scène comme un gigantesque cartoon filmé, Natural Born Killers propose des scènes d’anthologie, notamment celle de l’émeute dans la prison, rendue encore plus épileptique par le « Forkboy » de LARD. L7, NINE INCH NAILS complètent le casting, et tranchent avec le reste du soundtrack, plus classique. Le film a certes vieilli, mais reste un regard très pertinent sur l’Amérique des serial-killers, ces figures nationales qu’on aime présenter comme les boogeymen ultimes, mais qui exercent une fascination sur les esprits les plus pervers.
Natural Born Killers, l’un des films les plus controversés d’un des réalisateurs les plus controversés d’Hollywood, profite aussi de l’apport en puissance de morceaux bien choisis pour illustrer sa cavale mortelle d’un couple de serial-killers. Dénoncé comme étant la glamourisation du crime, Natural Born Killers s’en est pris plein la tête, le réalisateur étant plus habitué à filmer la guerre, ou à s’intéresser à des figures essentielles de l’histoire américaine. Mais très justement, en choisissant ce scénario écrit partiellement par Quentin Tarantino, Stone s’attaque au marketing organisé autour des tueurs les plus impitoyables de l’histoire des USA. Entre les biographies, les t-shirts, les objets dérivés, voire les œuvres d’art dans le cas de Gacy, l’hypocrisie d’un pays qui pointe du doigt ses enfants les plus meurtriers tout en capitalisant sur leur aura est ici mise à mal par un homme qui n’a jamais été avare en provocations. Dans les deux rôles principaux, Woody Harrelson et Juliette Lewis sont tout bonnement sidérants, dégageant une énergie animale, qui est toutefois sublimée par le personnage totalement halluciné de Robert Downey Jr. Ajoutons au casting un Tommy Lee Jones azimuté, un Tom Sizemore libidineux, et nous obtenons un petit miracle de violence exacerbée. Mis en scène comme un gigantesque cartoon filmé, Natural Born Killers propose des scènes d’anthologie, notamment celle de l’émeute dans la prison, rendue encore plus épileptique par le « Forkboy » de LARD. L7, NINE INCH NAILS complètent le casting, et tranchent avec le reste du soundtrack, plus classique. Le film a certes vieilli, mais reste un regard très pertinent sur l’Amérique des serial-killers, ces figures nationales qu’on aime présenter comme les boogeymen ultimes, mais qui exercent une fascination sur les esprits les plus pervers.
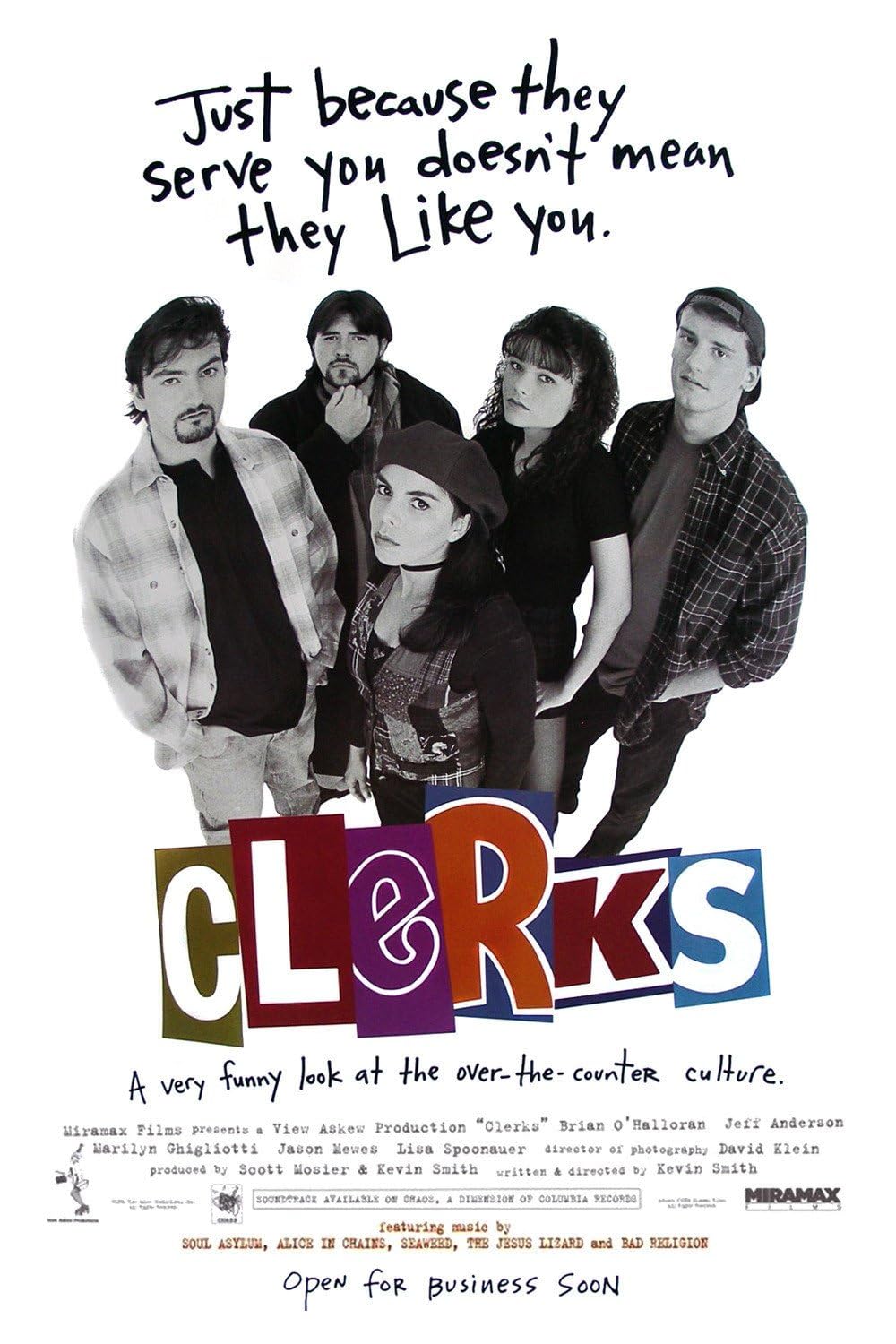 Un budget ridicule, des conditions de tournage spartiates, des acteurs totalement inconnus et un noir et blanc hors contexte, telles sont les critères selon lesquelles le chef d’œuvre Clerks est sorti en 1994. Lançant la carrière prolifique de Kevin Smith, Clerks est un petit miracle qui m’a traîné au cinéma plus de 10 fois l’année de sa sortie. Mettant en scène deux personnages que l’Amérique aime appeler des slackers (des gens qui n’aiment ni travailler, ni s’investir dans quoi que ce soit, en gros…des glandeurs comme le soulignera Smith un peu plus tard dans sa filmo), Dante et Randal, employés respectifs d’une supérette et d’un vidéoclub, qui tout au long de la journée croisent des personnages tous plus lunaires les uns que les autres. Dans cette déconstruction de l’Amérique idéale, Kevin Smith met l’accent sur l’aspect improbable de chaque situation, et nous brosse le tableau attachant d’une classe sociale moyenne voire basse. En traitant chaque scène comme un sketch de Saturday Night Live sans oublier son fil conducteur, le réalisateur à l’éternelle casquette s’offre un carton plein, et endosse le rôle de Silent Bob, l’éternel complice placide de l’hystérique Jay, dealer notoire. Se suivent donc des débats sur Star Wars, des ajustements sur la date de validité des bidons de lait, la mort d’un pauvre hère dans les toilettes, le travail sournois d’un distributeur en chewing-gum, mais aussi la vie sentimentale de ce pauvre Dante…qui n’aurait même pas dû travailler ce jour. Pour la bande-son, en bon metalhead, Smith nous engloutit de morceaux cultes, entre CORROSION OF CONFORMITY, ALICE IN CHAINS, JESUS LIZARD, BAD RELIGION, SOUL ASYLUM, et permet à sa modeste pellicule de multiplier ses gains par cent, passant d’un montant initial de 27.000 dollars à 3 millions. Culte de chez culte aujourd’hui, Clerks aura les honneurs d’une suite plutôt tardive, mais elle aussi réussie, et en couleurs. Les deux peuvent se voir à la suite, même si les personnages de Kevin Smith interagissent comme dans un multivers.
Un budget ridicule, des conditions de tournage spartiates, des acteurs totalement inconnus et un noir et blanc hors contexte, telles sont les critères selon lesquelles le chef d’œuvre Clerks est sorti en 1994. Lançant la carrière prolifique de Kevin Smith, Clerks est un petit miracle qui m’a traîné au cinéma plus de 10 fois l’année de sa sortie. Mettant en scène deux personnages que l’Amérique aime appeler des slackers (des gens qui n’aiment ni travailler, ni s’investir dans quoi que ce soit, en gros…des glandeurs comme le soulignera Smith un peu plus tard dans sa filmo), Dante et Randal, employés respectifs d’une supérette et d’un vidéoclub, qui tout au long de la journée croisent des personnages tous plus lunaires les uns que les autres. Dans cette déconstruction de l’Amérique idéale, Kevin Smith met l’accent sur l’aspect improbable de chaque situation, et nous brosse le tableau attachant d’une classe sociale moyenne voire basse. En traitant chaque scène comme un sketch de Saturday Night Live sans oublier son fil conducteur, le réalisateur à l’éternelle casquette s’offre un carton plein, et endosse le rôle de Silent Bob, l’éternel complice placide de l’hystérique Jay, dealer notoire. Se suivent donc des débats sur Star Wars, des ajustements sur la date de validité des bidons de lait, la mort d’un pauvre hère dans les toilettes, le travail sournois d’un distributeur en chewing-gum, mais aussi la vie sentimentale de ce pauvre Dante…qui n’aurait même pas dû travailler ce jour. Pour la bande-son, en bon metalhead, Smith nous engloutit de morceaux cultes, entre CORROSION OF CONFORMITY, ALICE IN CHAINS, JESUS LIZARD, BAD RELIGION, SOUL ASYLUM, et permet à sa modeste pellicule de multiplier ses gains par cent, passant d’un montant initial de 27.000 dollars à 3 millions. Culte de chez culte aujourd’hui, Clerks aura les honneurs d’une suite plutôt tardive, mais elle aussi réussie, et en couleurs. Les deux peuvent se voir à la suite, même si les personnages de Kevin Smith interagissent comme dans un multivers.
 Intermède rapide pour souligner que le mainstream n’était pas imperméable aux sonorités abrasives et viriles, avec les deux volets d’Ace Ventura, et le second Gremlins. Si la performance de CANNIBAL CORPSE est restée dans les annales, la présence de l’éternel « Angel of Death » de SLAYER sur le soundtrack de Gremlins 2: The New Batch est toute aussi étonnante. Si Jim Carrey, en bon imitateur Death/Grind (ses performances valent le coup d’œil, spécialement lorsqu’il se décide à singer NAPALM DEATH sur les plateaux TV) remettra le couvert plus calmement avec WHITE ZOMBIE pour la suite de ses aventures animalo-comiques, les Gremlins sont restés sages, et patientent toujours dans l’ombre pour bouffer du poulet après minuit. La suite de leurs pérégrinations ne devrait pas tarder.
Intermède rapide pour souligner que le mainstream n’était pas imperméable aux sonorités abrasives et viriles, avec les deux volets d’Ace Ventura, et le second Gremlins. Si la performance de CANNIBAL CORPSE est restée dans les annales, la présence de l’éternel « Angel of Death » de SLAYER sur le soundtrack de Gremlins 2: The New Batch est toute aussi étonnante. Si Jim Carrey, en bon imitateur Death/Grind (ses performances valent le coup d’œil, spécialement lorsqu’il se décide à singer NAPALM DEATH sur les plateaux TV) remettra le couvert plus calmement avec WHITE ZOMBIE pour la suite de ses aventures animalo-comiques, les Gremlins sont restés sages, et patientent toujours dans l’ombre pour bouffer du poulet après minuit. La suite de leurs pérégrinations ne devrait pas tarder.
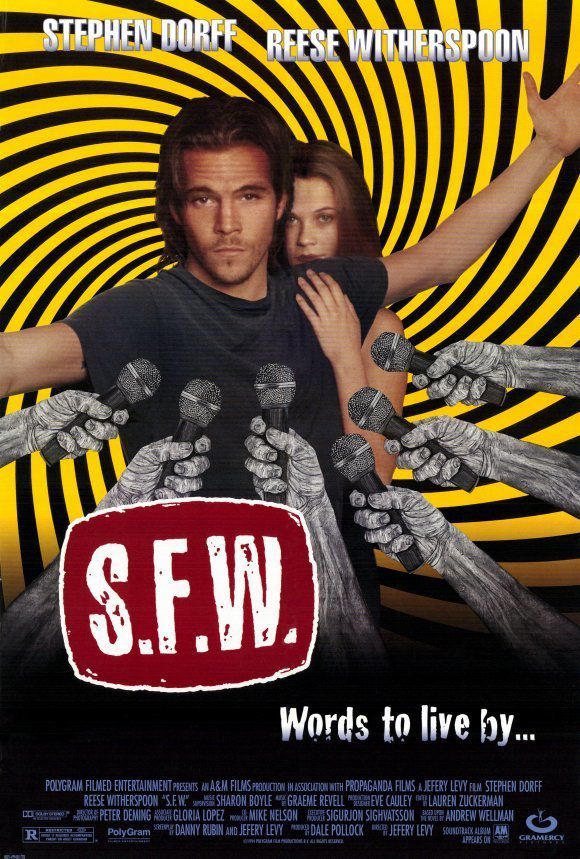 Cliff Spab est un mec qui ne se préoccupe de rien. Il est retenu en otage dans un magasin pendant 36 jours par des terroristes qui exigent que tout soit diffusé à la télévision nationale. Cliff finit par prendre une balle pour protéger Wendy, autre otage, ce qui en fait un héros national. Les deux sont les seuls survivants de l’épreuve, et deviennent bientôt prisonniers des médias. Cliff fuit loin de tout, pour se retrouver repoussé par Wendy au moment où il a le plus besoin d’elle. Ainsi va le pitch de S.F.W (Safe For Work), réalisé en 1994 par Jefery Levy. Une histoire pas si banale, avec en couple star, la jeune et prometteuse Reese Witherspoon et le charismatique Stephen Dorff. Satire de l’importance des médias sur la réalité des américains, S.F.W tire avantage de ses travers (réalisation MTV, langage d’jeunz, montage au cordeau) pour se poser en regard sans fard sur une télévision de plus en plus omniprésente dans les chaumières. Pas inintéressant, il laisse ses deux interprètes se débattre avec leurs bourreaux, puis avec les médias, qui considèrent que dès qu’une figure devient publique, elle leur appartient indéfiniment. On manque un peu de recul, le propos n’est pas toujours très finement amené, mais musicalement, l’œuvre fait un sans-faute. Chris CORNELL, THERAPY ?, MONSTER MAGNET, HOLE, BABES IN TOYLAND, les inénarrables GWAR, RAINBOW, MARILYN MANSON, PAW, SUICIDAL TENDENCIES, COP SHOOT COP, largement de quoi se ruer sur un CD qui se veut compagnon indispensable d’un DVD qui ne serait considéré comme un achat dispensable. Œil objectif sur époque chic et choc, S.F.W a enrichi l’année 1994 de sa vision pour le moins Orwellienne. Dans une certaine mesure, s’entend.
Cliff Spab est un mec qui ne se préoccupe de rien. Il est retenu en otage dans un magasin pendant 36 jours par des terroristes qui exigent que tout soit diffusé à la télévision nationale. Cliff finit par prendre une balle pour protéger Wendy, autre otage, ce qui en fait un héros national. Les deux sont les seuls survivants de l’épreuve, et deviennent bientôt prisonniers des médias. Cliff fuit loin de tout, pour se retrouver repoussé par Wendy au moment où il a le plus besoin d’elle. Ainsi va le pitch de S.F.W (Safe For Work), réalisé en 1994 par Jefery Levy. Une histoire pas si banale, avec en couple star, la jeune et prometteuse Reese Witherspoon et le charismatique Stephen Dorff. Satire de l’importance des médias sur la réalité des américains, S.F.W tire avantage de ses travers (réalisation MTV, langage d’jeunz, montage au cordeau) pour se poser en regard sans fard sur une télévision de plus en plus omniprésente dans les chaumières. Pas inintéressant, il laisse ses deux interprètes se débattre avec leurs bourreaux, puis avec les médias, qui considèrent que dès qu’une figure devient publique, elle leur appartient indéfiniment. On manque un peu de recul, le propos n’est pas toujours très finement amené, mais musicalement, l’œuvre fait un sans-faute. Chris CORNELL, THERAPY ?, MONSTER MAGNET, HOLE, BABES IN TOYLAND, les inénarrables GWAR, RAINBOW, MARILYN MANSON, PAW, SUICIDAL TENDENCIES, COP SHOOT COP, largement de quoi se ruer sur un CD qui se veut compagnon indispensable d’un DVD qui ne serait considéré comme un achat dispensable. Œil objectif sur époque chic et choc, S.F.W a enrichi l’année 1994 de sa vision pour le moins Orwellienne. Dans une certaine mesure, s’entend.
 Certains partenariats semblent couler de source dès le lancement d’un projet. Il était évident qu’Alex Proyas allait devoir flatter la communauté Metal dans le sens des poils avec son The Crow, narrant les aventures nocturnes d’Eric Draven. Misant sur le gothique en vogue à l’époque, développant une iconographie passée à la postérité, Proyas filme avec brio les agissements du justicier revenu d’entre les morts, tel un Lazare moderne avec un walkman vissé sur les oreilles. Mais pour écouter quoi ? MACHINES OF LOVING GRACE, STONE TEMPLE PILOTS, NINE INCH NAILS, RAGE AGAINST THE MACHINE, HELMET, ROLLINS BAND et PANTERA, la crème de la crème de l’époque, entre Alternatif cru et Industriel dru. La musique et les images font corps dans ce métrage aux allures de clip géant, les costumes se mettant au diapason des passions en piochant dans les coffres de la Hammer, dans les loges des vidéos de Metal, et la culture Pop US des années 80. Mais derrière cette débauche de noirceur, ce maquillage entre Black Metal naissant et The Rocky Horror Picture Show, se cache une œuvre intime à bien des égards. Loin du blockbuster habituel, The Crow révèle la souffrance de son créateur, James O'Barr, qui avait créé le personnage d’Eric Draven pour supporter la perte de sa petite amie, morte dans un accident de voiture causé par un conducteur ivre. L’autre élément dramatique, connu de tous, a été la mort accidentelle de l’acteur Brandon Lee, sur le plateau, dans des circonstances troubles de pistolet chargé à balles réelles. Depuis, le film bénéficie d’une aura très spéciale, l’œuvre initiale ou dérivée s’étant construite sur la mort de deux personnes. Difficile de ne pas y penser en voyant ces images magnifiques, et de ne pas faire de The Crow un film emblématique pour sa génération.
Certains partenariats semblent couler de source dès le lancement d’un projet. Il était évident qu’Alex Proyas allait devoir flatter la communauté Metal dans le sens des poils avec son The Crow, narrant les aventures nocturnes d’Eric Draven. Misant sur le gothique en vogue à l’époque, développant une iconographie passée à la postérité, Proyas filme avec brio les agissements du justicier revenu d’entre les morts, tel un Lazare moderne avec un walkman vissé sur les oreilles. Mais pour écouter quoi ? MACHINES OF LOVING GRACE, STONE TEMPLE PILOTS, NINE INCH NAILS, RAGE AGAINST THE MACHINE, HELMET, ROLLINS BAND et PANTERA, la crème de la crème de l’époque, entre Alternatif cru et Industriel dru. La musique et les images font corps dans ce métrage aux allures de clip géant, les costumes se mettant au diapason des passions en piochant dans les coffres de la Hammer, dans les loges des vidéos de Metal, et la culture Pop US des années 80. Mais derrière cette débauche de noirceur, ce maquillage entre Black Metal naissant et The Rocky Horror Picture Show, se cache une œuvre intime à bien des égards. Loin du blockbuster habituel, The Crow révèle la souffrance de son créateur, James O'Barr, qui avait créé le personnage d’Eric Draven pour supporter la perte de sa petite amie, morte dans un accident de voiture causé par un conducteur ivre. L’autre élément dramatique, connu de tous, a été la mort accidentelle de l’acteur Brandon Lee, sur le plateau, dans des circonstances troubles de pistolet chargé à balles réelles. Depuis, le film bénéficie d’une aura très spéciale, l’œuvre initiale ou dérivée s’étant construite sur la mort de deux personnes. Difficile de ne pas y penser en voyant ces images magnifiques, et de ne pas faire de The Crow un film emblématique pour sa génération.
 Strange Days garde une partie de cette ambiance pour développer un univers dystopique bien avant l’heure. Signé par la virtuose Kathryn Bigelow sur un scénario de James Cameron, Strange Days profite d’un casting quatre étoiles pour broder autour du thème de l’écroulement de la civilisation, avec en toile de fond une guerre faisant rage entre la population afro-américaine de Los Angeles et les forces de police. Ancien flic, Lenny Nero (Ralph Fiennes) s’est reconverti dans le deal, et négocie des CD procurant des sensations très réelles à ses consommateurs. Novateur pour l’époque, et assez culotté au jugé de l’année à laquelle se déroule l’action (1999, soit cinq ans après le tournage, c’est assez peu pour qu’une mégapole s’écroule sur elle-même), Strange Days déroule un décor futuriste surgonflé de néons, d’annonces publicitaires, mais en profite pour brosser une critique au vitriol du LAPD, police jugée parmi l’une des plus racistes des Etats-Unis. Outre Fiennes, Kathryn Bigelow enrôle Angela Bassett, Juliette Lewis, Tom Sizemore, Vincent D'Onofrio dans cette histoire en forme de course poursuite, très ancrée dans une époque où l’informatique commençait à prendre une part plus importante de la vie des citoyens. Et quel style musical plus adapté que le Heavy Metal pour rythmer les aventures borderline de Lenny Nero ? SKUNK ANANSIE, MARILYN MANSON, TESTAMENT et les LORDS OF ACID se disputent la place avec le classique éponyme des DOORS, et la prestation tout à fait honnête de Juliette Lewis (dont la carrière musicale vaut d’être suivie de près), pour que Strange Days bénéficie d’une ambiance surchauffée, en adéquation avec ses scènes d’action musclées. Le film a évidemment vieilli, mais reste recommandable, ne serait-ce que comme illustration du talent de Kathryn Bigelow, déjà responsable du carton surf Point Break, et du culte Near Dark.
Strange Days garde une partie de cette ambiance pour développer un univers dystopique bien avant l’heure. Signé par la virtuose Kathryn Bigelow sur un scénario de James Cameron, Strange Days profite d’un casting quatre étoiles pour broder autour du thème de l’écroulement de la civilisation, avec en toile de fond une guerre faisant rage entre la population afro-américaine de Los Angeles et les forces de police. Ancien flic, Lenny Nero (Ralph Fiennes) s’est reconverti dans le deal, et négocie des CD procurant des sensations très réelles à ses consommateurs. Novateur pour l’époque, et assez culotté au jugé de l’année à laquelle se déroule l’action (1999, soit cinq ans après le tournage, c’est assez peu pour qu’une mégapole s’écroule sur elle-même), Strange Days déroule un décor futuriste surgonflé de néons, d’annonces publicitaires, mais en profite pour brosser une critique au vitriol du LAPD, police jugée parmi l’une des plus racistes des Etats-Unis. Outre Fiennes, Kathryn Bigelow enrôle Angela Bassett, Juliette Lewis, Tom Sizemore, Vincent D'Onofrio dans cette histoire en forme de course poursuite, très ancrée dans une époque où l’informatique commençait à prendre une part plus importante de la vie des citoyens. Et quel style musical plus adapté que le Heavy Metal pour rythmer les aventures borderline de Lenny Nero ? SKUNK ANANSIE, MARILYN MANSON, TESTAMENT et les LORDS OF ACID se disputent la place avec le classique éponyme des DOORS, et la prestation tout à fait honnête de Juliette Lewis (dont la carrière musicale vaut d’être suivie de près), pour que Strange Days bénéficie d’une ambiance surchauffée, en adéquation avec ses scènes d’action musclées. Le film a évidemment vieilli, mais reste recommandable, ne serait-ce que comme illustration du talent de Kathryn Bigelow, déjà responsable du carton surf Point Break, et du culte Near Dark.
 Beaucoup plus calme et réaliste, Empire Records se concentre sur l’un des pôles d’attraction majeurs des années 90 : le disquaire. Nous avons tous des souvenirs de CD et vinyle écoutés religieusement au casque pendant des heures avant de devoir faire un choix douloureux, et le réalisateur Allan Moyle le sait bien. C’est ainsi qu’il nous propose de suivre pendant vingt-quatre heures la vie de divers employés et clients d’une enseigne, qui visiblement n’a pas échappé à la hype d’époque. Vêtements colorés, coiffures à l’avenant, attitude léchées et dialogues soupesés. Rien ne dépasse de ce métrage, qu’il ne faudrait pas non plus estimer trop stérile. On y retrouve les figures féminines emblématiques des nineties, avec l’incontournable Liv Tyler, mais aussi les adorables Robin Tunney, Renée Zellweger, et Debi Mazar. Jouant sur le passage difficile à l’âge adulte, Allan Moyle nous propose du proto-Richard Linklater, et roule sur les tubes radio. La fréquence d’Empire Records n’est pas vraiment spécialisée Funky, mais n’est évidemment pas totalement Metal. On pioche un peu de tout, du SUICIDAL TENDENCIES, du GWAR, les ADOLESCENTS parmi un tracklisting entre college radios et Indie Rock branché. THE THE, THE CRANBERRIES, THROWING MUSES, DISHWALLA, mais aussi AC/DC. Ceci étant posé, ce film se regarde avec un plaisir un peu coupable, nous présentant des amours adolescentes confrontées à la loi du marché du travail, et au capitalisme américain galopant. Entre la jolie muse prête à se donner corps et âme à sa star préférée, quelques glandeurs qui passent leur temps à deviser au lieu de ranger, et un concert final assez bien troussé, cette œuvre mineure à sa place dans le clan fermé des films musicaux valables, malgré quelques facilités, et une tendance à se vouloir plus philosophique qu’il n’est vraiment.
Beaucoup plus calme et réaliste, Empire Records se concentre sur l’un des pôles d’attraction majeurs des années 90 : le disquaire. Nous avons tous des souvenirs de CD et vinyle écoutés religieusement au casque pendant des heures avant de devoir faire un choix douloureux, et le réalisateur Allan Moyle le sait bien. C’est ainsi qu’il nous propose de suivre pendant vingt-quatre heures la vie de divers employés et clients d’une enseigne, qui visiblement n’a pas échappé à la hype d’époque. Vêtements colorés, coiffures à l’avenant, attitude léchées et dialogues soupesés. Rien ne dépasse de ce métrage, qu’il ne faudrait pas non plus estimer trop stérile. On y retrouve les figures féminines emblématiques des nineties, avec l’incontournable Liv Tyler, mais aussi les adorables Robin Tunney, Renée Zellweger, et Debi Mazar. Jouant sur le passage difficile à l’âge adulte, Allan Moyle nous propose du proto-Richard Linklater, et roule sur les tubes radio. La fréquence d’Empire Records n’est pas vraiment spécialisée Funky, mais n’est évidemment pas totalement Metal. On pioche un peu de tout, du SUICIDAL TENDENCIES, du GWAR, les ADOLESCENTS parmi un tracklisting entre college radios et Indie Rock branché. THE THE, THE CRANBERRIES, THROWING MUSES, DISHWALLA, mais aussi AC/DC. Ceci étant posé, ce film se regarde avec un plaisir un peu coupable, nous présentant des amours adolescentes confrontées à la loi du marché du travail, et au capitalisme américain galopant. Entre la jolie muse prête à se donner corps et âme à sa star préférée, quelques glandeurs qui passent leur temps à deviser au lieu de ranger, et un concert final assez bien troussé, cette œuvre mineure à sa place dans le clan fermé des films musicaux valables, malgré quelques facilités, et une tendance à se vouloir plus philosophique qu’il n’est vraiment.
 1996, The Fan sort sur les écrans, et n’y reste guère longtemps. Il faut dire que cette histoire rebattue de star poursuivie par un stalker inquiétant n’a rien d’enthousiasmant, malgré la présence de Robert De Niro au générique. Tony Scott, habile faiseur à la filmographie déjà bien pleine (Top Gun, Le Flic de Beverley Hills 2, Le Dernier Samaritain, True Romance) se fourvoie dans un classicisme outrancier, et oblige De Niro à surjouer, alors même que sa prestation monstrueuse dans la peau de Maximilian "Max" Cady du Cape Fear de Scorsese est encore fraiche dans les mémoires. Wesley Snipes, star musclé de nineties gonflées donne ce qu’il a dans le ventre pour rendre son personnage crédible (les scènes de jeu ont été supervisées par des professionnels du base-ball), mais las, la mayonnaise amère ne prend pas, et on quitte la salle la tête vide, pas vraiment certain d’avoir vu quelque chose de notable. La B.O heureusement nous gâte un peu plus, avec l’omniprésence de NINE INCH NAILS, secondé par CORROSION OF CONFORMITY, entre autres joyeusetés. Depuis, le métrage a été légèrement réévalué, mais il n’en reste pas moins un temps mort dans la carrière de Scott.
1996, The Fan sort sur les écrans, et n’y reste guère longtemps. Il faut dire que cette histoire rebattue de star poursuivie par un stalker inquiétant n’a rien d’enthousiasmant, malgré la présence de Robert De Niro au générique. Tony Scott, habile faiseur à la filmographie déjà bien pleine (Top Gun, Le Flic de Beverley Hills 2, Le Dernier Samaritain, True Romance) se fourvoie dans un classicisme outrancier, et oblige De Niro à surjouer, alors même que sa prestation monstrueuse dans la peau de Maximilian "Max" Cady du Cape Fear de Scorsese est encore fraiche dans les mémoires. Wesley Snipes, star musclé de nineties gonflées donne ce qu’il a dans le ventre pour rendre son personnage crédible (les scènes de jeu ont été supervisées par des professionnels du base-ball), mais las, la mayonnaise amère ne prend pas, et on quitte la salle la tête vide, pas vraiment certain d’avoir vu quelque chose de notable. La B.O heureusement nous gâte un peu plus, avec l’omniprésence de NINE INCH NAILS, secondé par CORROSION OF CONFORMITY, entre autres joyeusetés. Depuis, le métrage a été légèrement réévalué, mais il n’en reste pas moins un temps mort dans la carrière de Scott.
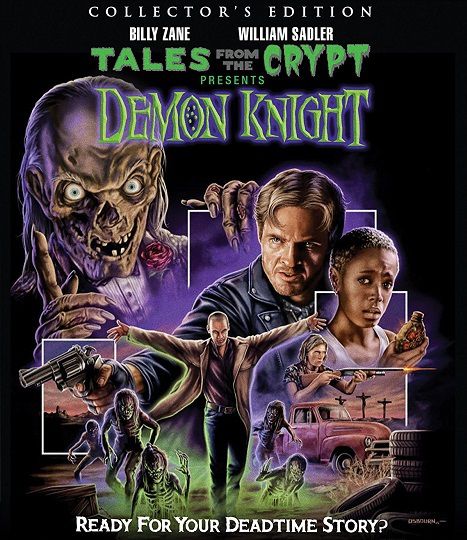 Plus plaisant est le double cas de Tales from the Crypt: Demon Knight/Bordello of Blood, de la fameuse franchise du même nom. Notre gardien de crypte préféré nous ouvre les portes d’un enfer décidément bien séduisant, entre comics et macabre joyeux. Si les deux films sont de qualité inégale (Demon Knight est décidément le plus jouissif des deux), les sons qu’ils proposent ont de quoi allécher les amateurs de décibels. ANTHRAX, FREE, THIN LIZZY, HUMBLE PIE pour les vampires, mais FILTER, ROLLINS BAND, PANTERA, MINISTRY, MACHINE HEAD et MEGADETH pour notre cavalier de minuit, une sacrée playlist et surtout, la présence du classique « Cemetery Gates » de PANTERA qui prend ici une autre dimension, totalement diabolique. Votre serviteur avoue un gros faible pour les aventures de Billy Zane, « Le Collectionneur », qui traque sans relâche un pauvre homme en cavale. Tournés à la façon d’un clip géant pour conserver l’aura des Contes de la Crypte intacte, ces deux volumes proposent de l’horreur light, une nudité très à propos, et des séquences indéniablement rythmées. A vous de voir si les démons sont plus attirants que les vampires, ces dernières se montrant sous un jour excessivement flatteur.
Plus plaisant est le double cas de Tales from the Crypt: Demon Knight/Bordello of Blood, de la fameuse franchise du même nom. Notre gardien de crypte préféré nous ouvre les portes d’un enfer décidément bien séduisant, entre comics et macabre joyeux. Si les deux films sont de qualité inégale (Demon Knight est décidément le plus jouissif des deux), les sons qu’ils proposent ont de quoi allécher les amateurs de décibels. ANTHRAX, FREE, THIN LIZZY, HUMBLE PIE pour les vampires, mais FILTER, ROLLINS BAND, PANTERA, MINISTRY, MACHINE HEAD et MEGADETH pour notre cavalier de minuit, une sacrée playlist et surtout, la présence du classique « Cemetery Gates » de PANTERA qui prend ici une autre dimension, totalement diabolique. Votre serviteur avoue un gros faible pour les aventures de Billy Zane, « Le Collectionneur », qui traque sans relâche un pauvre homme en cavale. Tournés à la façon d’un clip géant pour conserver l’aura des Contes de la Crypte intacte, ces deux volumes proposent de l’horreur light, une nudité très à propos, et des séquences indéniablement rythmées. A vous de voir si les démons sont plus attirants que les vampires, ces dernières se montrant sous un jour excessivement flatteur.
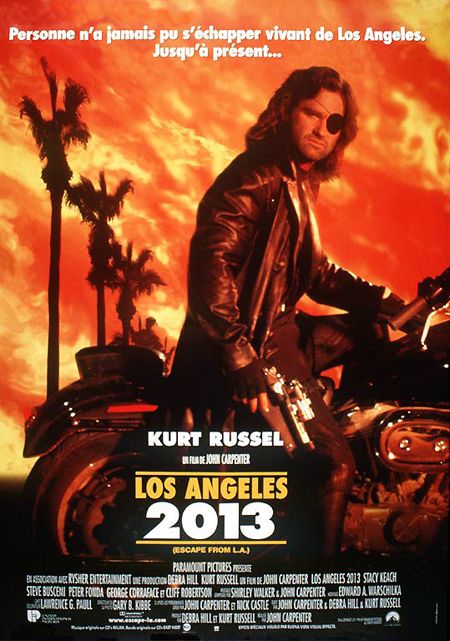 Les années 90 n’ont pas été tendres avec tout le monde, des musiciens aux réalisateurs. Certains, jouissant pourtant d’une aura immaculée ont manqué quelques marches, et notre bon vieux John Carpenter n’a pas échappé à la règle. Les Aventures de l’Homme Invisible a fait sonner la cloche et donné l’alerte, avec sa relecture un peu trop sage du mythe (et un Chevy Chase alors en bout de course niveau popularité), et si In The Mouth of Madness a légèrement rassuré la population, la décennie de notre cher Johnny a été marquée par de simples réadaptations, de ses propres histoires qui plus est. Sa nouvelle version du Village des Damnés était certes honorable, mais ce sont les nouvelles turpitudes de Snake Plissken qui ont définitivement plombé la ligne. Il n’y avait nul besoin de prolonger le plaisir ressenti à la découverte de New-York 1997, et pourtant, Kurt Russell reprend du service pour une suite qui a tout du fan service en pilote automatique. Le nihilisme d’hier a été remplacé par une pseudo rébellion pas vraiment crédible, et si l’original nous plongeait dans les artères de la grosse pomme, son petit frère préfère le soleil de la Californie, ce qui n’est jamais bon signe. Produit de son temps, Los Angeles 2013 modernise un peu l’action, s’ancre dans son époque avec quelques astuces de production un peu trop grosses, et laisse ce pauvre Snake se débattre non seulement avec ses ennemis, mais aussi avec un scénario qui tient sur une page. Carpenter joue la montre, et filme sans entrain ce décalque peu inspiré, et confie la bande-originale aux artistes en vue. Le simple fait d’intégrer un morceau des ignobles SUGAR RAY suffit à envisager les proportions du naufrage, à peine évité par la présence de TOOL, STABBING WESTWARD, GRAVITY KILLS et WHITE ZOMBIE. De l’électronique, du gros son, des tubes à la mode, pour un passage à vide qui n’a pas laissé de traces impérissables dans la mémoire des fans du bonhomme.
Les années 90 n’ont pas été tendres avec tout le monde, des musiciens aux réalisateurs. Certains, jouissant pourtant d’une aura immaculée ont manqué quelques marches, et notre bon vieux John Carpenter n’a pas échappé à la règle. Les Aventures de l’Homme Invisible a fait sonner la cloche et donné l’alerte, avec sa relecture un peu trop sage du mythe (et un Chevy Chase alors en bout de course niveau popularité), et si In The Mouth of Madness a légèrement rassuré la population, la décennie de notre cher Johnny a été marquée par de simples réadaptations, de ses propres histoires qui plus est. Sa nouvelle version du Village des Damnés était certes honorable, mais ce sont les nouvelles turpitudes de Snake Plissken qui ont définitivement plombé la ligne. Il n’y avait nul besoin de prolonger le plaisir ressenti à la découverte de New-York 1997, et pourtant, Kurt Russell reprend du service pour une suite qui a tout du fan service en pilote automatique. Le nihilisme d’hier a été remplacé par une pseudo rébellion pas vraiment crédible, et si l’original nous plongeait dans les artères de la grosse pomme, son petit frère préfère le soleil de la Californie, ce qui n’est jamais bon signe. Produit de son temps, Los Angeles 2013 modernise un peu l’action, s’ancre dans son époque avec quelques astuces de production un peu trop grosses, et laisse ce pauvre Snake se débattre non seulement avec ses ennemis, mais aussi avec un scénario qui tient sur une page. Carpenter joue la montre, et filme sans entrain ce décalque peu inspiré, et confie la bande-originale aux artistes en vue. Le simple fait d’intégrer un morceau des ignobles SUGAR RAY suffit à envisager les proportions du naufrage, à peine évité par la présence de TOOL, STABBING WESTWARD, GRAVITY KILLS et WHITE ZOMBIE. De l’électronique, du gros son, des tubes à la mode, pour un passage à vide qui n’a pas laissé de traces impérissables dans la mémoire des fans du bonhomme.
 Si vous n’aimez pas la daube, il y a fort à parier que vous êtes passé à côté d’une des catastrophes les plus emblématiques des années 90. Lorsque la nouvelle de l’adaptation du comics Spawn s’est ébruitée, tous les adorateurs de la secte d’Al Simmons ont commencé à trembler, l’époque n’étant pas aux réussites en termes de transposition. Mais ces mêmes disciples étaient encore à cent lieues de s’imaginer l’ampleur du désastre qui a souillé les écrans en 1997. Tâcheron sans âme, Mark A.Z. Dippé se retrouve aux commandes d’un des projets les plus casse-gueule du moment, et s’acquitte de sa mission avec une application…douteuse. Malgré la présence de Martin Sheen, Spawn est l’un des plus mauvais comics gravé sur pellicule, et se traîne le long de répliques foireuses et d’effets spéciaux pas toujours très valides. Difficile de faire le tri dans ce tas de mauvaises idées, empilées comme un stock de bonbons après Halloween, entre la mise en scène à la truelle et les acteurs en roue libre, sans encadrement, salissant ainsi l’image du soldat du démon à jamais. Alors que la mode n’était pas encore aux superhéros tous azimuts, Spawn se propose comme mètre étalon de la laideur et de la vacuité, se reposant entièrement sur le charisme de son personnage central, et sur l’efficacité d’une B.O ingénieuse. Avec son mariage ad hoc de phénomènes Rock et de sensations électroniques, Spawn nous offre de petites merveilles de crossover, et scelle des partenariats improbables. ORBITAL & Kirk Hammett, MARILYN MANSON & SNEAKER PIMPS, THE CRYSTAL METHOD & FILTER, KORN & THE DUST BROTHERS, Henry Rollins & GOLDIE, PRODIGY & Tom Morello, METALLICA & DJ SPOOKY, le résultat est évidemment aléatoire, mais plutôt jouissif. En tout cas, bien plus que cette incongruité filmique qui n’a pas vraiment été réhabilitée depuis. A juste titre.
Si vous n’aimez pas la daube, il y a fort à parier que vous êtes passé à côté d’une des catastrophes les plus emblématiques des années 90. Lorsque la nouvelle de l’adaptation du comics Spawn s’est ébruitée, tous les adorateurs de la secte d’Al Simmons ont commencé à trembler, l’époque n’étant pas aux réussites en termes de transposition. Mais ces mêmes disciples étaient encore à cent lieues de s’imaginer l’ampleur du désastre qui a souillé les écrans en 1997. Tâcheron sans âme, Mark A.Z. Dippé se retrouve aux commandes d’un des projets les plus casse-gueule du moment, et s’acquitte de sa mission avec une application…douteuse. Malgré la présence de Martin Sheen, Spawn est l’un des plus mauvais comics gravé sur pellicule, et se traîne le long de répliques foireuses et d’effets spéciaux pas toujours très valides. Difficile de faire le tri dans ce tas de mauvaises idées, empilées comme un stock de bonbons après Halloween, entre la mise en scène à la truelle et les acteurs en roue libre, sans encadrement, salissant ainsi l’image du soldat du démon à jamais. Alors que la mode n’était pas encore aux superhéros tous azimuts, Spawn se propose comme mètre étalon de la laideur et de la vacuité, se reposant entièrement sur le charisme de son personnage central, et sur l’efficacité d’une B.O ingénieuse. Avec son mariage ad hoc de phénomènes Rock et de sensations électroniques, Spawn nous offre de petites merveilles de crossover, et scelle des partenariats improbables. ORBITAL & Kirk Hammett, MARILYN MANSON & SNEAKER PIMPS, THE CRYSTAL METHOD & FILTER, KORN & THE DUST BROTHERS, Henry Rollins & GOLDIE, PRODIGY & Tom Morello, METALLICA & DJ SPOOKY, le résultat est évidemment aléatoire, mais plutôt jouissif. En tout cas, bien plus que cette incongruité filmique qui n’a pas vraiment été réhabilitée depuis. A juste titre.
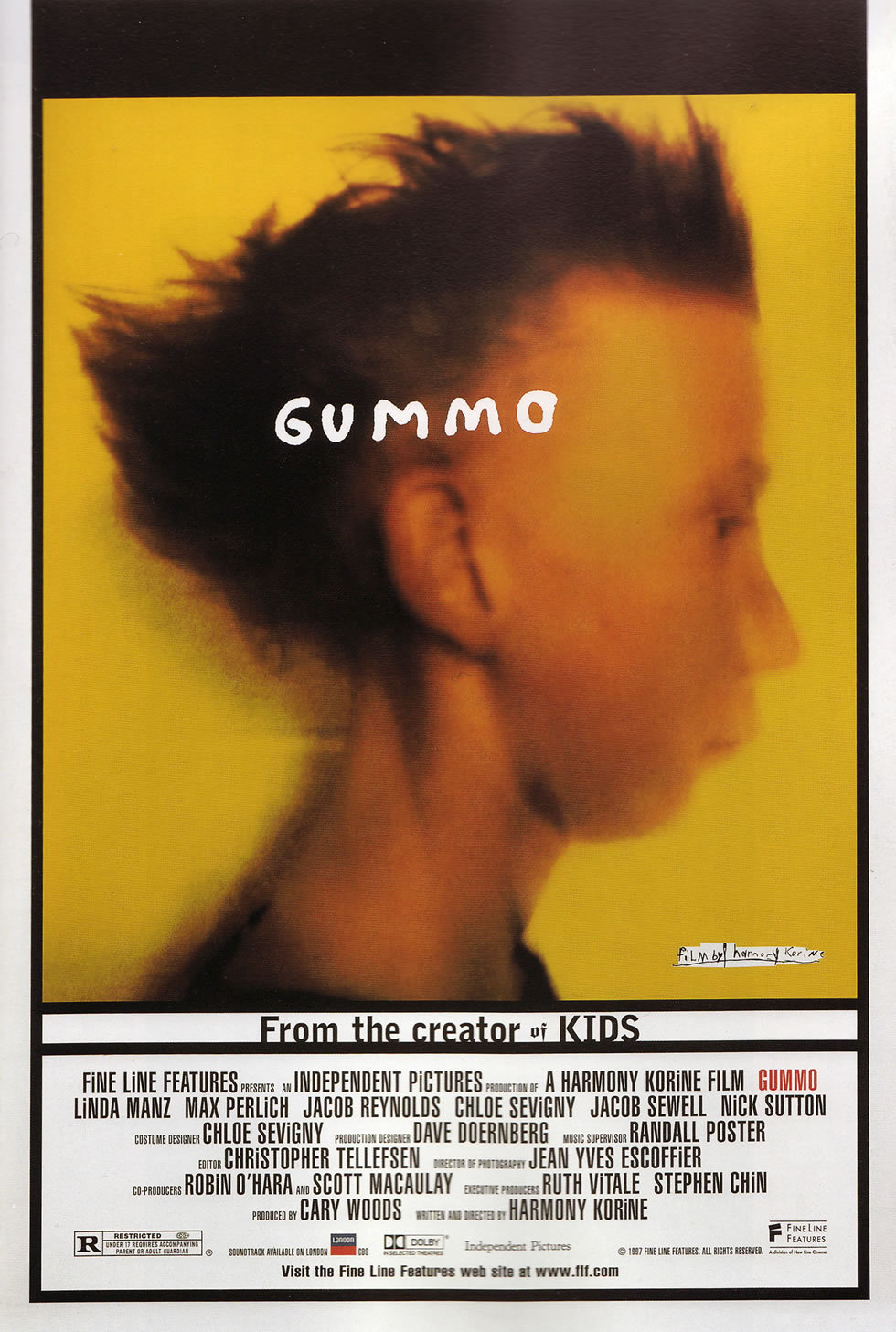 A l’autre bout du spectre cinématographique, les indépendants. Travaillant la plupart du temps avec des budgets ridicules, mais en toute liberté créative, ces animateurs de l’underground ont accouché d’œuvres étranges, biscornues, parfois passées à la postérité, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Gummo est sans doute l’exemple le plus parlant de film ancré dans la culture américaine, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Mis en scène par le quasi inconnu Harmony Korine, Gummo n’est pas un film à proprement parler, en termes de scénario et de mise en scène. Il dépeint le quotidien d’une faune pour le moins bizarre, qui déambule dans les rues d’une ville après une tempête. Auteur du sulfureux Kids de Larry Clark, Korine fait ses débuts derrière la caméra en la laissant se faire hypnotiser par des personnages sortis d’un asile de fous, dont la vie est marquée par un ennui profond et un nihilisme crasse. A la manière d’un documentaire sur le quart monde américain, Gummo est erratique, conditionné par sa propre sueur, visuellement très laid, mais étrangement fascinant, comme si ces jeunes adultes et enfants frappaient sur l’écran pour réclamer une existence légitime. Plusieurs scènes sont passées à la postérité, la plus connue étant celle montrant le jeune Solomon manger des pâtes à la sauce tomate dans son bain, moment très représentatif du vide artistique d’un film qui s’adresse à la frange la plus expérimentale des spectateurs potentiels. Souvent cité dans diverses listes, comme étant l’un des films les plus dégoutants, traumatiques, improbables et indéfinissables, Gummo en rajoute une couche (de saleté) et confronte MYSTIFIER, BATHORY, BURZUM et SLEEP à MADONNA, ROY ORBISON, Buddy HOLLY ou Johann Sebastian BACH. Cette bande-originale contradictoire est à l’image de ceux et celles qu’elle décrit, nous plongeant dans un univers glauque, aux cheveux gras, aux sourcils rasés et à la sexualité repoussante. Donc indispensable.
A l’autre bout du spectre cinématographique, les indépendants. Travaillant la plupart du temps avec des budgets ridicules, mais en toute liberté créative, ces animateurs de l’underground ont accouché d’œuvres étranges, biscornues, parfois passées à la postérité, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Gummo est sans doute l’exemple le plus parlant de film ancré dans la culture américaine, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Mis en scène par le quasi inconnu Harmony Korine, Gummo n’est pas un film à proprement parler, en termes de scénario et de mise en scène. Il dépeint le quotidien d’une faune pour le moins bizarre, qui déambule dans les rues d’une ville après une tempête. Auteur du sulfureux Kids de Larry Clark, Korine fait ses débuts derrière la caméra en la laissant se faire hypnotiser par des personnages sortis d’un asile de fous, dont la vie est marquée par un ennui profond et un nihilisme crasse. A la manière d’un documentaire sur le quart monde américain, Gummo est erratique, conditionné par sa propre sueur, visuellement très laid, mais étrangement fascinant, comme si ces jeunes adultes et enfants frappaient sur l’écran pour réclamer une existence légitime. Plusieurs scènes sont passées à la postérité, la plus connue étant celle montrant le jeune Solomon manger des pâtes à la sauce tomate dans son bain, moment très représentatif du vide artistique d’un film qui s’adresse à la frange la plus expérimentale des spectateurs potentiels. Souvent cité dans diverses listes, comme étant l’un des films les plus dégoutants, traumatiques, improbables et indéfinissables, Gummo en rajoute une couche (de saleté) et confronte MYSTIFIER, BATHORY, BURZUM et SLEEP à MADONNA, ROY ORBISON, Buddy HOLLY ou Johann Sebastian BACH. Cette bande-originale contradictoire est à l’image de ceux et celles qu’elle décrit, nous plongeant dans un univers glauque, aux cheveux gras, aux sourcils rasés et à la sexualité repoussante. Donc indispensable.
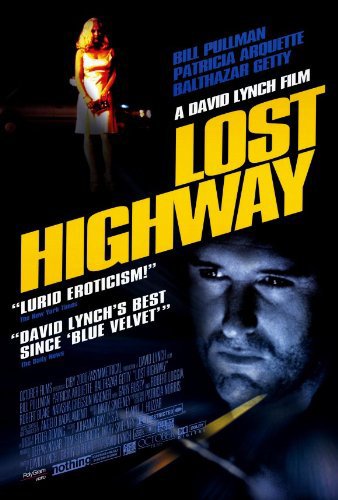 Pour rester dans le bizarre tout en regagnant un minimum de zone de confort, replongeons-nous dans le chef d’œuvre absolu de David Lynch, Lost Highway. Lynch, le chantre des désaxés, des penseurs non binaires, des incongruités physiques et du dérangement mental est déjà en 1997 le réalisateur culte qu’il a toujours été. Si son Elephant Man l’a rapproché d’un classicisme qui ne lui était guère coutumier, si Dune s’est planté dans les grandes largeurs (et il faudra attendre un bon bout de temps avant que le bouquin de Herbert bénéficie d’un traitement adapté, et sans TOTO cette fois-ci), Blue Velvet, Sailor et Lula, Twin Peaks et bien sur Eraserhead ont contribué à faire de lui un artiste abscons, au propos hermétique et aux capacités indéniables. L’homme n’aime rien tant que dérouter son public, mais l’apogée de cette philosophie est atteinte par Lost Highway, qui n’a certainement pas été baptisé au hasard. Fred Madison, un saxophoniste, est accusé d’avoir tué sa femme Renée dans des circonstances mystérieuses. Dans le couloir de la mort, il se transforme inexplicablement en un jeune homme nommé Pete Dayton, menant une vie complètement différente. Quand Pete est libéré, ses chemins et ceux de Fred commencent à se croiser dans un réseau d’intrigues surréalistes et suspensives, orchestrés par un truand louche nommé Dick Laurent. Avec un tel postulat, impossible de tourner autre chose qu’un OVNI cinématographique, qui intervertit et change ses personnages comme bon lui semble. Archétype du film indéchiffrable et assuré d’un statut culte auprès des admirateurs de Lynch, Lost Highway parvient quand même à rester lisible, et surtout, incroyablement dense et dramatique. Le plaisir de retrouver Bill Pullman, Patricia Arquette, Henry Rollins, Gary Busey et Robert Blake est amplifié par une utilisation de la musique exceptionnelle, le soundtrack distillant les ambiances et serrant les mains de David BOWIE, Trent REZNOR, THIS MORTAL COIL, MARILYN MANSON et les allemands émergents de RAMMSTEIN, dont la carrière fut méchamment boostée par cette inclusion. Lost Highway reste l’un des hauts-faits de David Lynch, qui s’est alors senti pousser des ailes de démons. Mulholland Drive, Inland Empire, et bien sur Twin Peaks: The Return ont achevé de le consacrer cinéaste insaisissable de sa génération, titre totalement mérité. Il suffit pour s’en convaincre de regarder l’épisode 8 de la suite de Twin Peaks, en réalisant que finalement, Eraserhead était franchement mainstream.
Pour rester dans le bizarre tout en regagnant un minimum de zone de confort, replongeons-nous dans le chef d’œuvre absolu de David Lynch, Lost Highway. Lynch, le chantre des désaxés, des penseurs non binaires, des incongruités physiques et du dérangement mental est déjà en 1997 le réalisateur culte qu’il a toujours été. Si son Elephant Man l’a rapproché d’un classicisme qui ne lui était guère coutumier, si Dune s’est planté dans les grandes largeurs (et il faudra attendre un bon bout de temps avant que le bouquin de Herbert bénéficie d’un traitement adapté, et sans TOTO cette fois-ci), Blue Velvet, Sailor et Lula, Twin Peaks et bien sur Eraserhead ont contribué à faire de lui un artiste abscons, au propos hermétique et aux capacités indéniables. L’homme n’aime rien tant que dérouter son public, mais l’apogée de cette philosophie est atteinte par Lost Highway, qui n’a certainement pas été baptisé au hasard. Fred Madison, un saxophoniste, est accusé d’avoir tué sa femme Renée dans des circonstances mystérieuses. Dans le couloir de la mort, il se transforme inexplicablement en un jeune homme nommé Pete Dayton, menant une vie complètement différente. Quand Pete est libéré, ses chemins et ceux de Fred commencent à se croiser dans un réseau d’intrigues surréalistes et suspensives, orchestrés par un truand louche nommé Dick Laurent. Avec un tel postulat, impossible de tourner autre chose qu’un OVNI cinématographique, qui intervertit et change ses personnages comme bon lui semble. Archétype du film indéchiffrable et assuré d’un statut culte auprès des admirateurs de Lynch, Lost Highway parvient quand même à rester lisible, et surtout, incroyablement dense et dramatique. Le plaisir de retrouver Bill Pullman, Patricia Arquette, Henry Rollins, Gary Busey et Robert Blake est amplifié par une utilisation de la musique exceptionnelle, le soundtrack distillant les ambiances et serrant les mains de David BOWIE, Trent REZNOR, THIS MORTAL COIL, MARILYN MANSON et les allemands émergents de RAMMSTEIN, dont la carrière fut méchamment boostée par cette inclusion. Lost Highway reste l’un des hauts-faits de David Lynch, qui s’est alors senti pousser des ailes de démons. Mulholland Drive, Inland Empire, et bien sur Twin Peaks: The Return ont achevé de le consacrer cinéaste insaisissable de sa génération, titre totalement mérité. Il suffit pour s’en convaincre de regarder l’épisode 8 de la suite de Twin Peaks, en réalisant que finalement, Eraserhead était franchement mainstream.
 Plus proche de la réalité et moins susceptible de déclencher des céphalées sévères, l’autobiographie du trublion américain Howard Stern, Private Parts. Sur un scénario qu’il a lui-même signé, et avec lui-même dans son propre rôle, l’enfant prodige des ondes US nous embarque dans son propre délire, entre attaques au vitriol de l’Americain Way of Life, happenings, stars complètement barrées, et fêtes hollywoodiennes dégoulinant de stupre et d’alcool. Ce petit DJ sans envergure qui se contentait de passer des disques et de lire le bulletin météo est vite devenu l’incontrôlable clown de la radio, s’attirant régulièrement les foudres de la censure et la colère de ses patrons de NBC. Mais plus qu’une simple hagiographie simpliste carburant à l’autosatisfaction, Private Parts est une véritable ode à la liberté d’expression, alors qu’à notre époque le moindre petit dérapage peut entraîner un bannissement public. Si Stern s’est évidemment calmé par la suite, obtenant une légitimité artistique méritée, ce film permet de le retrouver dans ses œuvres, et accompagné d’une bande sonore à son image. DEEP PURPLE, ZZ TOP, CHEAP TRICK, AEROSMITH, OZZY, les RAMONES jouent des coudes pour trouver leur place parmi les classiques de Nat King Cole, des TEMPTATIONS et de Benny GOODMAN. Sacré coup de pied au cul, Private Parts est une paire de couilles fièrement affichée sous un jean trop serré, et un souvenir d’une époque lointaine ou les bienpensants ne dirigeaient pas encore les médias par la peur d’un embargo sur le mauvais goût. Daté, typé, mais explosif. Avec une apparition du regretté Tiny Tim, décédé avant la sortie du film, et à enchaîner évidemment avec un best-of filmé du bonhomme. Savoureux.
Plus proche de la réalité et moins susceptible de déclencher des céphalées sévères, l’autobiographie du trublion américain Howard Stern, Private Parts. Sur un scénario qu’il a lui-même signé, et avec lui-même dans son propre rôle, l’enfant prodige des ondes US nous embarque dans son propre délire, entre attaques au vitriol de l’Americain Way of Life, happenings, stars complètement barrées, et fêtes hollywoodiennes dégoulinant de stupre et d’alcool. Ce petit DJ sans envergure qui se contentait de passer des disques et de lire le bulletin météo est vite devenu l’incontrôlable clown de la radio, s’attirant régulièrement les foudres de la censure et la colère de ses patrons de NBC. Mais plus qu’une simple hagiographie simpliste carburant à l’autosatisfaction, Private Parts est une véritable ode à la liberté d’expression, alors qu’à notre époque le moindre petit dérapage peut entraîner un bannissement public. Si Stern s’est évidemment calmé par la suite, obtenant une légitimité artistique méritée, ce film permet de le retrouver dans ses œuvres, et accompagné d’une bande sonore à son image. DEEP PURPLE, ZZ TOP, CHEAP TRICK, AEROSMITH, OZZY, les RAMONES jouent des coudes pour trouver leur place parmi les classiques de Nat King Cole, des TEMPTATIONS et de Benny GOODMAN. Sacré coup de pied au cul, Private Parts est une paire de couilles fièrement affichée sous un jean trop serré, et un souvenir d’une époque lointaine ou les bienpensants ne dirigeaient pas encore les médias par la peur d’un embargo sur le mauvais goût. Daté, typé, mais explosif. Avec une apparition du regretté Tiny Tim, décédé avant la sortie du film, et à enchaîner évidemment avec un best-of filmé du bonhomme. Savoureux.
On peut être un rockeur chevelu et aimer les poupées têtues. C’est la leçon donnée par la franchise Chucky, qui depuis les années 80 nous revend du « Bon Gars » comme s’il en pleuvait. Tout le monde connaît l’histoire de ce jouet possédé par l’esprit d’un tueur, dont les aventures ont été déclinées en plusieurs volumes, mais le plus intéressant pour nous date de 1998, lorsque ce brave Chucky trouve enfin l’amour. A la manière du phénoménal Re-Animator II - The Bride of Frankenstein, Bride of Chucky nous invite aux noces célébrées entre notre antihéros méchant comme une teigne et une belle poupée gothique incarnée par Jennifer Tilly. Brad Dourif reprend donc du service en tant que voix officielle du serial-toy, et si ce volet n’est pas le plus réussi de la franchise, il est certainement l’un des plus Metal. Pour mettre en scène ces pérégrinations mortelles, quoi de plus efficace qu’un bon gros riff de l’espace qui se crashe sur une rythmique de dégénérés ? 
Alors autant poser l’archer et choper le médiator, et par la même occasion laisser les amplis aux stars de l’époque, les Rob ZOMBIE, STATIC-X, STABBING WESTWARD, COAL CHAMBER, MONSTER MAGNET, mais aussi aux anciens de JUDAS PRIEST, Bruce DICKINSON, ou SLAYER pour donner au film l’impulsion nécessaire et la bonne dose de distorsion. Du sang, de l’humour noir, du Néo-Metal et encore plein d’autres surprises, Bride of Chucky est certes un plaisir mineur, mais aussi un témoignage de son époque dominée par le Metal à tendance électronique, en vogue depuis la moitié de la décennie. Et comme Noël approche, n’hésitez pas.
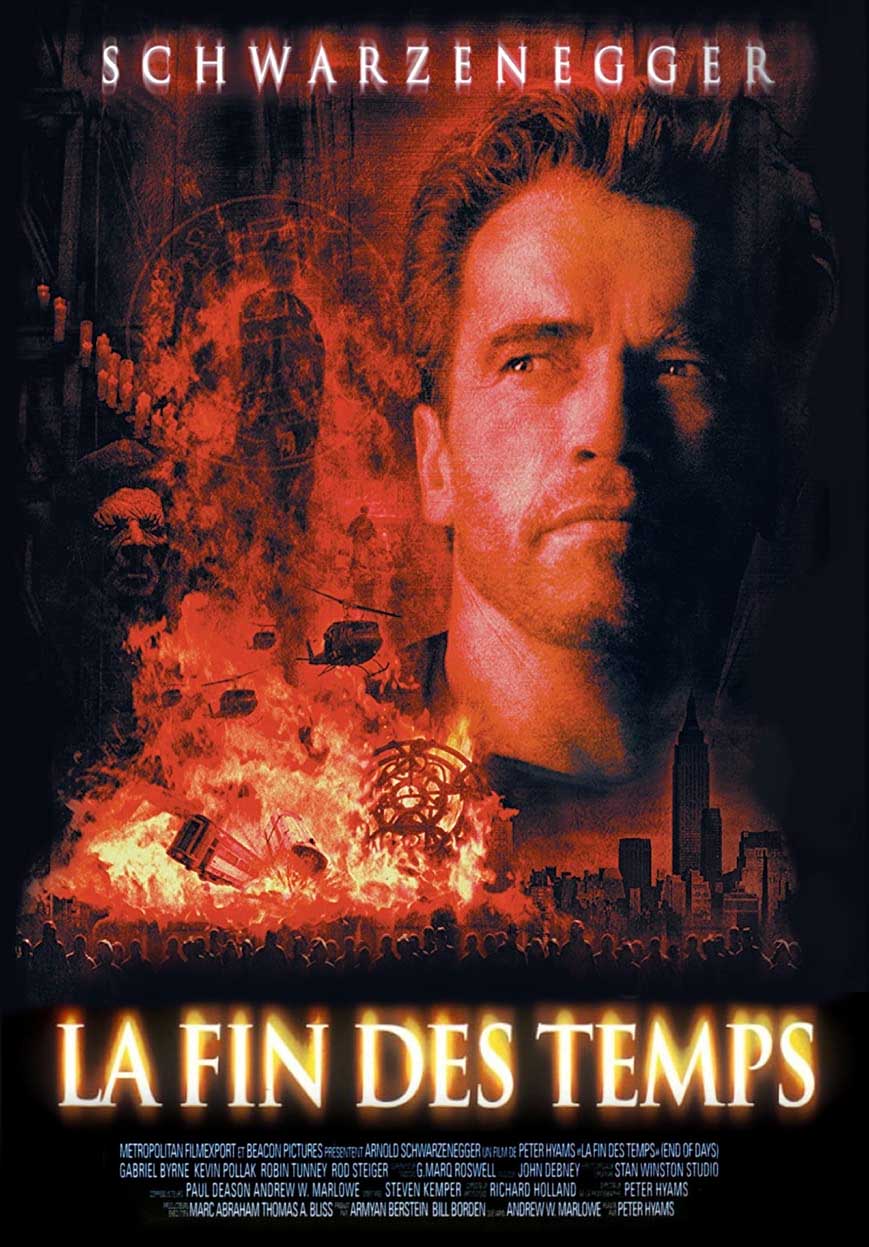 Redescendons d’un cran niveau qualité, pour aborder le très moyen La Fin des Temps, porté par un Arnold Schwarzenegger moyennement concerné par cette histoire d’apocalypse. Très en phase avec son temps, miné par l’approche du nouveau siècle et des prétendus catastrophes annoncées, La Fin des Temps aimerait nous faire croire à ce retour de Satan sur terre pour se trouver une épouse, dans un New-York évidemment ténébreux et crade. Mais avec le pitch suivant :
Redescendons d’un cran niveau qualité, pour aborder le très moyen La Fin des Temps, porté par un Arnold Schwarzenegger moyennement concerné par cette histoire d’apocalypse. Très en phase avec son temps, miné par l’approche du nouveau siècle et des prétendus catastrophes annoncées, La Fin des Temps aimerait nous faire croire à ce retour de Satan sur terre pour se trouver une épouse, dans un New-York évidemment ténébreux et crade. Mais avec le pitch suivant :
Le 28 décembre 1999, les citoyens de New York se préparent pour le tournant du millénaire. Cependant, le diable décide de faire capoter la fête en débarquant en ville, possédant le corps d’un homme pour venir chercher sa fiancée, une femme de 20 ans nommée Christine York. Christine doit porter son engeance entre 23 h et minuit le soir du Nouvel An, pour déclencher l’apocalypse, et le seul espoir réside dans un ex-flic athée nommé Jericho Cane, qui ne croit plus en Dieu à cause du meurtre de sa femme et de sa fille.
Même avec un casting aux petits oignons et un Gabriel Byrne délicieux en diablotin du nouvel-an, La Fin des Temps ne fait guère illusion longtemps, et se traîne de dialogues insipides en scènes d’action déjà éventées. Même la mignonne Robin Tunney et l’impeccable Kevin Pollak ne peuvent pas faire grand-chose pour sauver le métrage d’un naufrage annoncé, et certainement l’un des points noirs de la carrière pourtant généreuse en navets de Schwarzenegger. Heureusement pour nous, une fois encore, la musique apporte un peu d’air frais dans cet univers marketing vicié. Rob ZOMBIE, LIMP BIZKIT et KORN lâchent les watts, mais ne compensent pas les faiblesses d’un scénario prévisible, et d’une mystique de supermarché. A voir, et à oublier rapidement.
 Beaucoup plus solide et académique, L'Enfer du dimanche transpose les jeux du cirque dans l’Amérique contemporaine. Film fleuve au casting impressionnant (Al Pacino, Dennis Quaid, Cameron Diaz, Matthew Modine, James Woods, Jamie Foxx), L'Enfer du dimanche est une nouvelle preuve du panache d’Oliver Stone lorsqu’il s’agit de raconter une histoire simple empreinte de violence et de bons sentiments. D’un pitch classique, Stone tire une fable longue de deux heures et quarante-deux minutes, utilisant la rédemption, défonçant l’opportunisme mercantile et la déification des sportifs pour mieux tirer à balles réelles sur la morale US. L’histoire de ce joueur abonné au banc des remplaçants ayant enfin sa chance est portée comme un tourbillon par le réalisateur, qui fait montre d’une maestria certaine pour sublimer les scènes de jeu. Dès lors, malgré sa longueur, le film captive, peut-être moins que d’autres films du fils maudit d’Hollywood, mais largement plus que bon nombre de blockbusters de l’époque. Loin du millénarisme, des histoires si insipides qu’on les croirait racontées par Vianney, ou du sensationnalisme gratuit de pellicules déjà périmées avant leur sortie, Stone compare les arènes romaines aux stades américains, et donne à ses acteurs un décorum de tragédie grecque dans lequel ils évoluent avec beaucoup d’énergie. Autre source de chaleur, Gary GLITTER, GODSMACK, P.O.D, METALLICA, KID ROCK, ou HOLE, qui trouvent leur place dans la narration en nous collant de bons plaquages. On pourrait dire que la B.O est majoritairement tournée vers des choses plus mainstream, mais la qualité du film et la présence de ces quelques représentants Metal suffisent à en faire une entrée valable pour ce dossier, dont L'Enfer du dimanche est l’un des meilleurs représentants.
Beaucoup plus solide et académique, L'Enfer du dimanche transpose les jeux du cirque dans l’Amérique contemporaine. Film fleuve au casting impressionnant (Al Pacino, Dennis Quaid, Cameron Diaz, Matthew Modine, James Woods, Jamie Foxx), L'Enfer du dimanche est une nouvelle preuve du panache d’Oliver Stone lorsqu’il s’agit de raconter une histoire simple empreinte de violence et de bons sentiments. D’un pitch classique, Stone tire une fable longue de deux heures et quarante-deux minutes, utilisant la rédemption, défonçant l’opportunisme mercantile et la déification des sportifs pour mieux tirer à balles réelles sur la morale US. L’histoire de ce joueur abonné au banc des remplaçants ayant enfin sa chance est portée comme un tourbillon par le réalisateur, qui fait montre d’une maestria certaine pour sublimer les scènes de jeu. Dès lors, malgré sa longueur, le film captive, peut-être moins que d’autres films du fils maudit d’Hollywood, mais largement plus que bon nombre de blockbusters de l’époque. Loin du millénarisme, des histoires si insipides qu’on les croirait racontées par Vianney, ou du sensationnalisme gratuit de pellicules déjà périmées avant leur sortie, Stone compare les arènes romaines aux stades américains, et donne à ses acteurs un décorum de tragédie grecque dans lequel ils évoluent avec beaucoup d’énergie. Autre source de chaleur, Gary GLITTER, GODSMACK, P.O.D, METALLICA, KID ROCK, ou HOLE, qui trouvent leur place dans la narration en nous collant de bons plaquages. On pourrait dire que la B.O est majoritairement tournée vers des choses plus mainstream, mais la qualité du film et la présence de ces quelques représentants Metal suffisent à en faire une entrée valable pour ce dossier, dont L'Enfer du dimanche est l’un des meilleurs représentants.
 Propulsons-nous dans les réalités alternatives, et rejoignons la matrice. Matrix, le film des sœurs Wachowski est évidemment plus qu’un film, c’est un phénomène de société, comme ont pu l’être Titanic, Avatar, Le Grand Bleu, la Boum et beaucoup d’autres. Sorti sur les écrans en 1999 - timing parfait - Matrix raconte l’histoire de Thomas A. Anderson. Le jour, il est un programmeur informatique moyen et la nuit, un hacker connu sous le nom de Néo. Néo a toujours remis en question sa réalité, mais la vérité est bien au-delà de son imagination. Néo se retrouve pris pour cible par la police lorsqu’il est contacté par Morpheus, un légendaire hacker que le gouvernement considère comme terroriste. En tant que rebelle contre les machines, Néo doit affronter les agents : des programmes informatiques superpuissants dédiés à l’arrêter Néo ainsi que toute la rébellion humaine. Ce postulat qui ressemble à beaucoup d’œuvres de science-fiction a été le départ d’un nouveau mode de réalisation, notamment grâce aux innovations techniques du « bullet time », sorte de super ralenti à 360 degrés, largement utilisé par la suite à plus ou moins bon escient. Nul ne savait alors que les aventures de Néo allaient nous faire haleter pendant plus de vingt ans. Ce film, certes assuré n’était pas forcément programmé pour effectuer un hold-up mondial, et pourtant, il y eut un avant et un après Matrix. Si la tétralogie est évidemment de qualité inégale, les volumes 2 et 3 étant largement inférieurs, le premier volet reste un classique high-tech qui tient encore la route aujourd’hui, malgré son ancrage dans les sfx de l’époque. Vif, inventif et novateur, passionnant et même envoutant, Matrix est passé à la postérité de la SF, et le personnage de Néo fait depuis longtemps partie de la Pop Culture. Il était donc impensable de ne pas adapter sa BO, et de proposer des classiques aléatoires. Rob ZOMBIE, MARILYN MANSON, RAGE AGAINST THE MACHINE, mais aussi THE PRODIGY et MEAT BEAT MANIFESTO, pour plus de deux heures de violence fluide et d’anticipation pas si exagérée que ça. Les die-hard ont eu l’occasion de retrouver leur héros pour un Matrix Resurrections plus proche du fan service que de la réelle œuvre originale et digne, mais tout le monde s’accorde à dire que le pouvoir de Néo n’a jamais été aussi efficace qu’en 1999. D’ailleurs assez proche de la génération Metal de par ses costumes, son montage et ses allusions futuristes, Matrix est un film comme on en voit un ou deux par décennie, et qui a marqué durablement les esprits, comme en témoignent les excellentes ventes CD de son soundtrack. Alors, pilule bleue ou pilule rouge ?
Propulsons-nous dans les réalités alternatives, et rejoignons la matrice. Matrix, le film des sœurs Wachowski est évidemment plus qu’un film, c’est un phénomène de société, comme ont pu l’être Titanic, Avatar, Le Grand Bleu, la Boum et beaucoup d’autres. Sorti sur les écrans en 1999 - timing parfait - Matrix raconte l’histoire de Thomas A. Anderson. Le jour, il est un programmeur informatique moyen et la nuit, un hacker connu sous le nom de Néo. Néo a toujours remis en question sa réalité, mais la vérité est bien au-delà de son imagination. Néo se retrouve pris pour cible par la police lorsqu’il est contacté par Morpheus, un légendaire hacker que le gouvernement considère comme terroriste. En tant que rebelle contre les machines, Néo doit affronter les agents : des programmes informatiques superpuissants dédiés à l’arrêter Néo ainsi que toute la rébellion humaine. Ce postulat qui ressemble à beaucoup d’œuvres de science-fiction a été le départ d’un nouveau mode de réalisation, notamment grâce aux innovations techniques du « bullet time », sorte de super ralenti à 360 degrés, largement utilisé par la suite à plus ou moins bon escient. Nul ne savait alors que les aventures de Néo allaient nous faire haleter pendant plus de vingt ans. Ce film, certes assuré n’était pas forcément programmé pour effectuer un hold-up mondial, et pourtant, il y eut un avant et un après Matrix. Si la tétralogie est évidemment de qualité inégale, les volumes 2 et 3 étant largement inférieurs, le premier volet reste un classique high-tech qui tient encore la route aujourd’hui, malgré son ancrage dans les sfx de l’époque. Vif, inventif et novateur, passionnant et même envoutant, Matrix est passé à la postérité de la SF, et le personnage de Néo fait depuis longtemps partie de la Pop Culture. Il était donc impensable de ne pas adapter sa BO, et de proposer des classiques aléatoires. Rob ZOMBIE, MARILYN MANSON, RAGE AGAINST THE MACHINE, mais aussi THE PRODIGY et MEAT BEAT MANIFESTO, pour plus de deux heures de violence fluide et d’anticipation pas si exagérée que ça. Les die-hard ont eu l’occasion de retrouver leur héros pour un Matrix Resurrections plus proche du fan service que de la réelle œuvre originale et digne, mais tout le monde s’accorde à dire que le pouvoir de Néo n’a jamais été aussi efficace qu’en 1999. D’ailleurs assez proche de la génération Metal de par ses costumes, son montage et ses allusions futuristes, Matrix est un film comme on en voit un ou deux par décennie, et qui a marqué durablement les esprits, comme en témoignent les excellentes ventes CD de son soundtrack. Alors, pilule bleue ou pilule rouge ?
 Dans le registre de l’action débridée et high-tech, la saga Mission Impossible se pose là. Initiée par Brian De Palma en 1996, la suite Mission Impossible dérivée de la série du même nom commence par un non-sens absolu : la trahison de toute l’équipe d’Ethan Hunt. Assez décrié à l’époque comme un crachat à la face des fans, le succès de ce premier volet a entraîné de nombreuses séquelles, dont le point commun est assez inhabituel. Chaque nouveau volet a surpassé le précédent, sauf dans un cas très précis : Mission Impossible 2. Pourtant pris en charge par le phénomène John Woo, cette première suite se vautre dans les grandes largeurs, au point d’être démodée le jour même de sa sortie. Alors que Woo a toujours été considéré - et à juste titre - comme un virtuose de la caméra, le résisteur se fourvoie dans un clip grandeur nature, qui se paie le luxe d’être encore moins fidèle à l’œuvre que le premier volume. Toujours affuté, Ethan Hunt s’embarque dans de nouvelles aventures, d’une fadeur sans égale, et d’un design visuel absolument détestable. A tel point qu’on pourrait croire la pellicule payée par MTV, tant le film ressemble à toutes les vidéos Rock de l’époque. D’où la pertinence de la punchline de promotion : attendez-vous à l’impossible de nouveau. En effet, impossible de s’attacher à cette histoire de maladie mortelle dérobée par un ancien agent, même si Cruise donne encore une fois de sa personne en réalisant des cascades très pointues. Musicalement, c’est à l’avenant, et Woo fait même appel aux irritants LIMP BIZKIT pour signer le titre officiel. Si « Take a Look Around » n’est pas un titre désagréable en soi, il est à l’image des images qu’il illustre, entre facilité électronique et attraction putassière du Billboard. METALLICA essaie de rétablir l’équilibre avec l’inédit « I Disappear », tourné sur le set, mais peine aussi à convaincre d’un riff fatigué et d’une gestuelle coincée. Sabré de ralentis insupportables, truffé de tics de l’orée des années 2000, entre gimmicks et sonneries de portable à télécharger (pas encore mais ça va venir), Mission Impossible 2 est le seul faux-pas de la franchise, qui heureusement nous a soignés par la suite. Il est tout à fait possible de se faire l’intégrale (en attendant le volume 2 de Dead Reckoning) en zappant ce terrible naufrage, l’intrigue n’en pâtissant pas vraiment. Et sincèrement, perdre deux heures de sa vie est un luxe que peu d’entre nous ont encore.
Dans le registre de l’action débridée et high-tech, la saga Mission Impossible se pose là. Initiée par Brian De Palma en 1996, la suite Mission Impossible dérivée de la série du même nom commence par un non-sens absolu : la trahison de toute l’équipe d’Ethan Hunt. Assez décrié à l’époque comme un crachat à la face des fans, le succès de ce premier volet a entraîné de nombreuses séquelles, dont le point commun est assez inhabituel. Chaque nouveau volet a surpassé le précédent, sauf dans un cas très précis : Mission Impossible 2. Pourtant pris en charge par le phénomène John Woo, cette première suite se vautre dans les grandes largeurs, au point d’être démodée le jour même de sa sortie. Alors que Woo a toujours été considéré - et à juste titre - comme un virtuose de la caméra, le résisteur se fourvoie dans un clip grandeur nature, qui se paie le luxe d’être encore moins fidèle à l’œuvre que le premier volume. Toujours affuté, Ethan Hunt s’embarque dans de nouvelles aventures, d’une fadeur sans égale, et d’un design visuel absolument détestable. A tel point qu’on pourrait croire la pellicule payée par MTV, tant le film ressemble à toutes les vidéos Rock de l’époque. D’où la pertinence de la punchline de promotion : attendez-vous à l’impossible de nouveau. En effet, impossible de s’attacher à cette histoire de maladie mortelle dérobée par un ancien agent, même si Cruise donne encore une fois de sa personne en réalisant des cascades très pointues. Musicalement, c’est à l’avenant, et Woo fait même appel aux irritants LIMP BIZKIT pour signer le titre officiel. Si « Take a Look Around » n’est pas un titre désagréable en soi, il est à l’image des images qu’il illustre, entre facilité électronique et attraction putassière du Billboard. METALLICA essaie de rétablir l’équilibre avec l’inédit « I Disappear », tourné sur le set, mais peine aussi à convaincre d’un riff fatigué et d’une gestuelle coincée. Sabré de ralentis insupportables, truffé de tics de l’orée des années 2000, entre gimmicks et sonneries de portable à télécharger (pas encore mais ça va venir), Mission Impossible 2 est le seul faux-pas de la franchise, qui heureusement nous a soignés par la suite. Il est tout à fait possible de se faire l’intégrale (en attendant le volume 2 de Dead Reckoning) en zappant ce terrible naufrage, l’intrigue n’en pâtissant pas vraiment. Et sincèrement, perdre deux heures de sa vie est un luxe que peu d’entre nous ont encore.
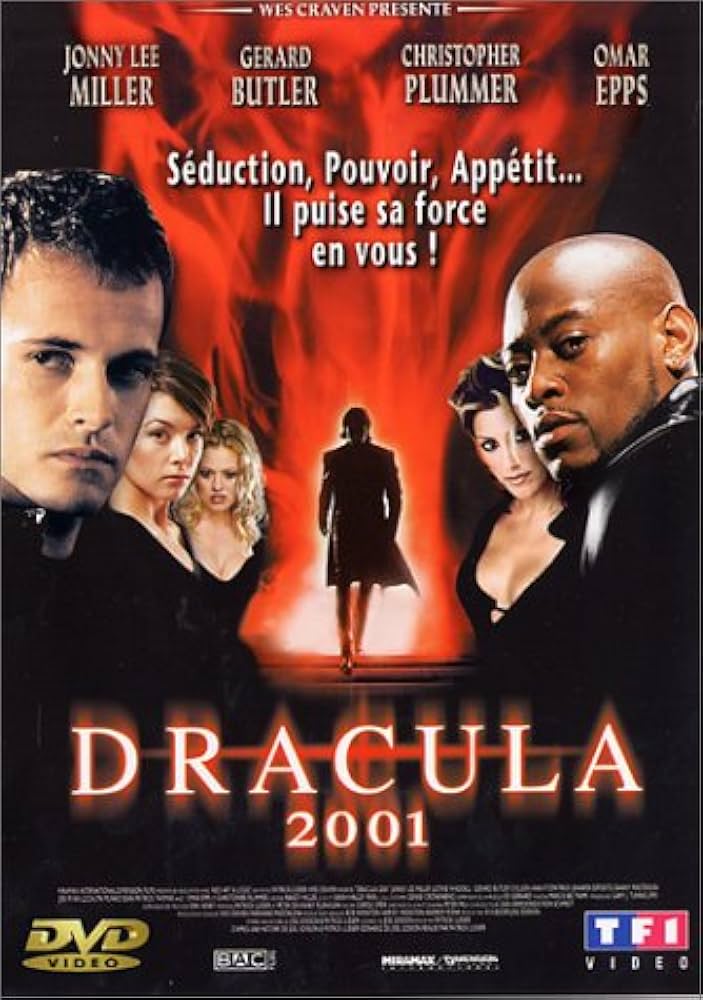 Dracula 2001, comme son titre l’indique, est une modernisation du mythe de Bram Stoker, très éloigné des réussites Dracula (Francis Ford Coppola) et Entretien avec un Vampire (Neil Jordan). Un groupe de voleurs fait irruption dans une chambre, dans l'espoir de trouver des peintures, mais au lieu de cela, ils libèrent le comte Dracula lui-même, qui se rend à la Nouvelle-Orléans pour trouver la fille de son ennemi, Mary Van Helsing. Mis en scène par le plâtrier/couvreur Patrick Lussier, qui par la suite insistera dans les veines des suceurs de cou et autres gourmandises pour nostalgiques de l’ère Delta Vidéo, Dracula 2001 est évidemment la purge absolue qu’il semble préfigurer, malgré la présence sur l’affiche de deux valeurs sûres, Gerard Butler et Jonny Lee Miller. En y ajoutant le toujours respectable Christopher Plummer dans le rôle d’Abraham Van Helsing, vous obtenez un intérêt certain, immédiatement dégonflé par une réalisation mollassonne et des sfx datés avant d’avoir été programmés. Typique du cinéma de genre de l’orée des années 2000, Dracula 2001 est un DTV qui ne mérite que ça, et qui tente de capitaliser sur un mythe de la littérature pour justifier de sa molle existence. Niveau musique, Patrick Lussier se met au diapason, et convoque les très actuels d’alors POWERMAN 5000, MONSTER MAGNET, STATIC-X, SOAD, SLAYER, DISTURBED, HED P.E, PANTERA, TAPROOT (toutes mes excuses pour l’odeur) et SALIVA, pour compenser le manque d’investissement de sa mise en scène. Sitôt vu, sitôt digéré et vomi, Dracula 2001 n’a d’autre intérêt que sa bande-son, reflet d’une époque branchée aux tenues bariolées.
Dracula 2001, comme son titre l’indique, est une modernisation du mythe de Bram Stoker, très éloigné des réussites Dracula (Francis Ford Coppola) et Entretien avec un Vampire (Neil Jordan). Un groupe de voleurs fait irruption dans une chambre, dans l'espoir de trouver des peintures, mais au lieu de cela, ils libèrent le comte Dracula lui-même, qui se rend à la Nouvelle-Orléans pour trouver la fille de son ennemi, Mary Van Helsing. Mis en scène par le plâtrier/couvreur Patrick Lussier, qui par la suite insistera dans les veines des suceurs de cou et autres gourmandises pour nostalgiques de l’ère Delta Vidéo, Dracula 2001 est évidemment la purge absolue qu’il semble préfigurer, malgré la présence sur l’affiche de deux valeurs sûres, Gerard Butler et Jonny Lee Miller. En y ajoutant le toujours respectable Christopher Plummer dans le rôle d’Abraham Van Helsing, vous obtenez un intérêt certain, immédiatement dégonflé par une réalisation mollassonne et des sfx datés avant d’avoir été programmés. Typique du cinéma de genre de l’orée des années 2000, Dracula 2001 est un DTV qui ne mérite que ça, et qui tente de capitaliser sur un mythe de la littérature pour justifier de sa molle existence. Niveau musique, Patrick Lussier se met au diapason, et convoque les très actuels d’alors POWERMAN 5000, MONSTER MAGNET, STATIC-X, SOAD, SLAYER, DISTURBED, HED P.E, PANTERA, TAPROOT (toutes mes excuses pour l’odeur) et SALIVA, pour compenser le manque d’investissement de sa mise en scène. Sitôt vu, sitôt digéré et vomi, Dracula 2001 n’a d’autre intérêt que sa bande-son, reflet d’une époque branchée aux tenues bariolées.
 Same year, different shit. The One, de James Wong suit les aventures d’un agent partant à la recherche de versions alternatives de lui-même, devenant plus fort à chaque mise à mort. Seule la dernière version de lui-même, un flic de Los Angeles, peut l'arrêter, mais aussi, permettre au mot fin de s’afficher sur l’écran avant que les spectateurs ne le maculent de mépris et de colère. Pourtant capable aux commandes de Final Destination, Wong se fourvoie dans ce thriller futuriste trop copié sur les modèles de son temps, laissant le pauvre Jet Li se dépatouiller de ces pérégrinations high-tech à la recherche du moi profond. Pas vraiment philosophique, The One porte mal son titre, et perd son unicité éventuelle dans un océan de conformisme et d’esthétique douteuse. Même la sublime Carla Gugino ne peut rien faire pour séduire les fans d’une science-fiction facile, qui rejettent en masse cet imbroglio en écheveau qu’il est inutile de dénouer. Tourné pour une génération avide d’écrans et de nouvelles technologies, The One se lâche un peu plus sur sa musique, et laisse les rennes à , DISTURBED, DROWNING POOL, pour tenter de combler le fossé entre ses défauts et sa seule qualité. Las, les tubes des groupes en question ne suffisent pas à excuser les maladresses, le jeu tout en charge et les gros bras omniprésents. Seul Jason Statham garde son charisme, si tant est que vous soyez fascinés par les taiseux très agiles de leurs membres. Sinon, no way.
Same year, different shit. The One, de James Wong suit les aventures d’un agent partant à la recherche de versions alternatives de lui-même, devenant plus fort à chaque mise à mort. Seule la dernière version de lui-même, un flic de Los Angeles, peut l'arrêter, mais aussi, permettre au mot fin de s’afficher sur l’écran avant que les spectateurs ne le maculent de mépris et de colère. Pourtant capable aux commandes de Final Destination, Wong se fourvoie dans ce thriller futuriste trop copié sur les modèles de son temps, laissant le pauvre Jet Li se dépatouiller de ces pérégrinations high-tech à la recherche du moi profond. Pas vraiment philosophique, The One porte mal son titre, et perd son unicité éventuelle dans un océan de conformisme et d’esthétique douteuse. Même la sublime Carla Gugino ne peut rien faire pour séduire les fans d’une science-fiction facile, qui rejettent en masse cet imbroglio en écheveau qu’il est inutile de dénouer. Tourné pour une génération avide d’écrans et de nouvelles technologies, The One se lâche un peu plus sur sa musique, et laisse les rennes à , DISTURBED, DROWNING POOL, pour tenter de combler le fossé entre ses défauts et sa seule qualité. Las, les tubes des groupes en question ne suffisent pas à excuser les maladresses, le jeu tout en charge et les gros bras omniprésents. Seul Jason Statham garde son charisme, si tant est que vous soyez fascinés par les taiseux très agiles de leurs membres. Sinon, no way.
 Beaucoup plus intéressant et fin, Ginger Snaps. Sorti l’année précédente, il incarne une adaptation de la lycanthropie transposée dans une banlieue anonyme. Deux sœurs obsédées par la mort, parias dans leur quartier de banlieue, doivent faire face aux conséquences tragiques lorsque l'une d'elles est mordue par un loup-garou. Enoncé à la volée, tout ça ressemble au script d’un loner de X-Files, et aurait largement pu l’être. Les deux rôles principaux, confiés à l’extraordinaire Katharine Isabelle et à la plus discrète Emily Perkins forment un tandem tout à fait crédible, qui accentue cette métaphore comparant les outcasts à des monstres mythologiques pour en expliquer la différence. Beaucoup de thèmes de société sont traités dans ce film, qui joue admirablement bien la carte de la sororité confrontée à la maladie (la lycanthropie est évidemment une métaphore sur une affliction bien réelle, cancer, SIDA, etc…), et qui nous passionne sans en rajouter dans le pathos ou le Gore. Adoubé par la critique et le public, Ginger Snaps est assurément une curiosité dans le monde des teen movies de l’époque, en refusant de rester à la surface des choses pour éviter à son public de trop réfléchir. Musicalement parlant, la chose n’est pas moins intéressante avec la présence de FEAR FACTORY, MACHINE HEAD, SOULFLY ou RAZED IN BLACK, qui viennent rythmer ces séquences de pleine lune et ces affrontements entre vivants et à moitié morts. Haut du panier des films de loups garous, Ginger Snaps file un bon coup de pied au cul au mythe qu’il aborde, et reste aujourd’hui un bon bréviaire des désaxés, paumés, individualistes et autres parias d’une société qui ne hait rien tant que la singularité. Le conformisme en prend donc un grand coup, et les bigots de rester chez eux les volets fermés de peur de se faire bouffer par la réalité.
Beaucoup plus intéressant et fin, Ginger Snaps. Sorti l’année précédente, il incarne une adaptation de la lycanthropie transposée dans une banlieue anonyme. Deux sœurs obsédées par la mort, parias dans leur quartier de banlieue, doivent faire face aux conséquences tragiques lorsque l'une d'elles est mordue par un loup-garou. Enoncé à la volée, tout ça ressemble au script d’un loner de X-Files, et aurait largement pu l’être. Les deux rôles principaux, confiés à l’extraordinaire Katharine Isabelle et à la plus discrète Emily Perkins forment un tandem tout à fait crédible, qui accentue cette métaphore comparant les outcasts à des monstres mythologiques pour en expliquer la différence. Beaucoup de thèmes de société sont traités dans ce film, qui joue admirablement bien la carte de la sororité confrontée à la maladie (la lycanthropie est évidemment une métaphore sur une affliction bien réelle, cancer, SIDA, etc…), et qui nous passionne sans en rajouter dans le pathos ou le Gore. Adoubé par la critique et le public, Ginger Snaps est assurément une curiosité dans le monde des teen movies de l’époque, en refusant de rester à la surface des choses pour éviter à son public de trop réfléchir. Musicalement parlant, la chose n’est pas moins intéressante avec la présence de FEAR FACTORY, MACHINE HEAD, SOULFLY ou RAZED IN BLACK, qui viennent rythmer ces séquences de pleine lune et ces affrontements entre vivants et à moitié morts. Haut du panier des films de loups garous, Ginger Snaps file un bon coup de pied au cul au mythe qu’il aborde, et reste aujourd’hui un bon bréviaire des désaxés, paumés, individualistes et autres parias d’une société qui ne hait rien tant que la singularité. Le conformisme en prend donc un grand coup, et les bigots de rester chez eux les volets fermés de peur de se faire bouffer par la réalité.
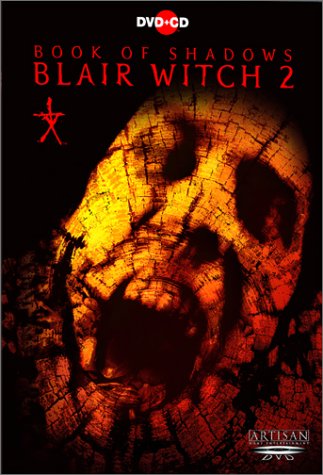 Petit retour en arrière, en 1999. Alors que personne ne s’y attend, un gigantesque ouragan va s’abattre sur les salles de cinéma mondiales, sous la forme d’un long-métrage d’une heure et quinze minutes, réalisé pour une bouchée de pain. Sous les yeux éberlués d’une foule qui découvre la technique du found-footage (déjà exploitée bien en amont par une partie de Cannibal Holocaust), The Blair Witch Project profite d’un effet de surprise et d’un noir et blanc très réaliste pour nous foutre la trouille du siècle…sans jamais rien montrer de choquant. Hold-up intersidéral, le film de Sanchez et Myrick engloutit le box-office, et se fait plaisir d’un sacré paquet de dollars, qui se comptent par centaines. Il devenait alors évident que le film allait déclencher un processus de séquelles et de reboots, qui jusqu’à présent ne se comptent que sur les deux doigts d’une main de lépreux. En 2000, un an à peine après la secousse d’origine, surgit de nulle part Blair Witch 2: Le Livre des Ombres signé par un anonyme venu de la télévision, Joe Berlinger. Alors que le parti-pris du Blair Witch original était de jouer sur la frontière entre la réalité et la fiction, un utilisant des techniques éprouvées comme l’absence de script et la méconnaissance totale des acteurs subissant les assauts de l’équipe technique en pleine nuit, Blair Witch 2: Le Livre des Ombres se pose immédiatement en fiction pure, et abandonne la technique de la caméra à l’épaule pour accentuer le réalisme. Plutôt bien vu en termes de renouvèlement, le principe tourne rapidement court, la faute à un scénario indigeste, à des personnages totalement stéréotypés, et à une intrigue aussi mince que Kate Moss après un brunch. Tous les clichés identitaires sont recensés, de la pseudo gothique morbide à la petite frappe qui trafique dans son coin, en passant par l’autoproclamée sorcière blanche, jusqu’au couple d’étudiants qui ont dû redoubler leur deuxième année au moins cinq fois. Véritable calvaire, Blair Witch 2: Le Livre des Ombres est une insulte à l’œuvre d’origine, et un gros glaviot craché à la face de l’innovation et de la prise de risques. Ni intéressant, ni séduisant, encore moins flippant, cette fausse suite est depuis heureusement tombée aux oubliettes depuis la seule vraie séquelle de 2016. Et comme accumuler les poncifs cinématographiques n’a pas suffi à la production, on tartine la bande son de distorsion, via MARILYN MANSON, SYSTEM OF A DOWN, AT THE DRIVE IN, Tony IOMMI, QUEENS OF THE STONE AGE, P.O.D, Rob ZOMBIE, GODHEAD, pour tenter de faire passer la pilule et de multiplier les clins d’œil à la génération MTV. Je dois reconnaître que le temps n’a pas vraiment permis de réévaluer cette abomination, qui en plus de son manque total de qualités, a très très mal vieilli. Next.
Petit retour en arrière, en 1999. Alors que personne ne s’y attend, un gigantesque ouragan va s’abattre sur les salles de cinéma mondiales, sous la forme d’un long-métrage d’une heure et quinze minutes, réalisé pour une bouchée de pain. Sous les yeux éberlués d’une foule qui découvre la technique du found-footage (déjà exploitée bien en amont par une partie de Cannibal Holocaust), The Blair Witch Project profite d’un effet de surprise et d’un noir et blanc très réaliste pour nous foutre la trouille du siècle…sans jamais rien montrer de choquant. Hold-up intersidéral, le film de Sanchez et Myrick engloutit le box-office, et se fait plaisir d’un sacré paquet de dollars, qui se comptent par centaines. Il devenait alors évident que le film allait déclencher un processus de séquelles et de reboots, qui jusqu’à présent ne se comptent que sur les deux doigts d’une main de lépreux. En 2000, un an à peine après la secousse d’origine, surgit de nulle part Blair Witch 2: Le Livre des Ombres signé par un anonyme venu de la télévision, Joe Berlinger. Alors que le parti-pris du Blair Witch original était de jouer sur la frontière entre la réalité et la fiction, un utilisant des techniques éprouvées comme l’absence de script et la méconnaissance totale des acteurs subissant les assauts de l’équipe technique en pleine nuit, Blair Witch 2: Le Livre des Ombres se pose immédiatement en fiction pure, et abandonne la technique de la caméra à l’épaule pour accentuer le réalisme. Plutôt bien vu en termes de renouvèlement, le principe tourne rapidement court, la faute à un scénario indigeste, à des personnages totalement stéréotypés, et à une intrigue aussi mince que Kate Moss après un brunch. Tous les clichés identitaires sont recensés, de la pseudo gothique morbide à la petite frappe qui trafique dans son coin, en passant par l’autoproclamée sorcière blanche, jusqu’au couple d’étudiants qui ont dû redoubler leur deuxième année au moins cinq fois. Véritable calvaire, Blair Witch 2: Le Livre des Ombres est une insulte à l’œuvre d’origine, et un gros glaviot craché à la face de l’innovation et de la prise de risques. Ni intéressant, ni séduisant, encore moins flippant, cette fausse suite est depuis heureusement tombée aux oubliettes depuis la seule vraie séquelle de 2016. Et comme accumuler les poncifs cinématographiques n’a pas suffi à la production, on tartine la bande son de distorsion, via MARILYN MANSON, SYSTEM OF A DOWN, AT THE DRIVE IN, Tony IOMMI, QUEENS OF THE STONE AGE, P.O.D, Rob ZOMBIE, GODHEAD, pour tenter de faire passer la pilule et de multiplier les clins d’œil à la génération MTV. Je dois reconnaître que le temps n’a pas vraiment permis de réévaluer cette abomination, qui en plus de son manque total de qualités, a très très mal vieilli. Next.
 Dans la même veine, et dans le style « remake foireux pour producteurs oisifs », Mortelle Saint-Valentin, sorti en 2001. Réadaptation plus ou moins officielle de Meurtres à la St-Valentin (My Bloody Valentine), Mortelle Saint-Valentin surfe sur la vague revival des slashers initiée par Wes Craven et Kevin Williamson, et débite des crétineries au kilomètre en profitant du physique avantageux de ses actrices. La bande des idoles de l’époque est là, Denise Richards, Katherine Heigl, Marley Shelton et même ce grand sot de David Boreanaz, qui a au moins eu le mérite de shooter toutes ses scènes en deux semaines. L’intrigue est évidemment aussi prévisible qu’un « non » après une main passée sur les sous-vêtements d’une vierge, et le massacre à des allures de body count fatigué et fatigant auquel personne ne prête attention…pas même ses victimes. Tout le monde se noie dans ce raz-de-marée de convenances, de facilités, de mise en scène à l’eau tiède, puisque Mortelle Saint-Valentin passe en revue le cahier des charges sans même essayer de se distinguer par une ou deux trouvailles. Aussi inintéressant qu’un Urban Legends ou qu’un Souviens-Toi l’Eté Dernier, le film se lâche un peu avec des interventions des abonnés MARILYN MANSON, Rob ZOMBIE, ORGY, DEFTONES, DISTURBED, STATIC-X, LINKIN PARK et FILTER, eux aussi en mode pilotage automatique et autres habitudes de B.O systématiques. A réserver à ceux qui ne supportent pas de passer à côté d’un slasher, même sans intérêt, ou aux fans de ces actrices aussi jolies qu’abonnées à des rôles de potiche. A tort pour certaines.
Dans la même veine, et dans le style « remake foireux pour producteurs oisifs », Mortelle Saint-Valentin, sorti en 2001. Réadaptation plus ou moins officielle de Meurtres à la St-Valentin (My Bloody Valentine), Mortelle Saint-Valentin surfe sur la vague revival des slashers initiée par Wes Craven et Kevin Williamson, et débite des crétineries au kilomètre en profitant du physique avantageux de ses actrices. La bande des idoles de l’époque est là, Denise Richards, Katherine Heigl, Marley Shelton et même ce grand sot de David Boreanaz, qui a au moins eu le mérite de shooter toutes ses scènes en deux semaines. L’intrigue est évidemment aussi prévisible qu’un « non » après une main passée sur les sous-vêtements d’une vierge, et le massacre à des allures de body count fatigué et fatigant auquel personne ne prête attention…pas même ses victimes. Tout le monde se noie dans ce raz-de-marée de convenances, de facilités, de mise en scène à l’eau tiède, puisque Mortelle Saint-Valentin passe en revue le cahier des charges sans même essayer de se distinguer par une ou deux trouvailles. Aussi inintéressant qu’un Urban Legends ou qu’un Souviens-Toi l’Eté Dernier, le film se lâche un peu avec des interventions des abonnés MARILYN MANSON, Rob ZOMBIE, ORGY, DEFTONES, DISTURBED, STATIC-X, LINKIN PARK et FILTER, eux aussi en mode pilotage automatique et autres habitudes de B.O systématiques. A réserver à ceux qui ne supportent pas de passer à côté d’un slasher, même sans intérêt, ou aux fans de ces actrices aussi jolies qu’abonnées à des rôles de potiche. A tort pour certaines.
 Parfois, en lisant un pitch, on réalise immédiatement dans quelle mésaventure on se fourvoie. Les exemples sont innombrables, mais la déception mieux digérée. En effet, lorsqu’on ramène sur la table des blettes bouillies au melon d’eau, les babines restent tranquilles et les papilles font la grève. Il en va de même, lorsqu’en lisant un court laïus de présentation, l’euphorie est aux abonnées absentes. Mais en même temps, comment ne pas se réjouir en tombant sur ça :
Parfois, en lisant un pitch, on réalise immédiatement dans quelle mésaventure on se fourvoie. Les exemples sont innombrables, mais la déception mieux digérée. En effet, lorsqu’on ramène sur la table des blettes bouillies au melon d’eau, les babines restent tranquilles et les papilles font la grève. Il en va de même, lorsqu’en lisant un court laïus de présentation, l’euphorie est aux abonnées absentes. Mais en même temps, comment ne pas se réjouir en tombant sur ça :
Dans cette suite adaptée librement du film Entretien avec un vampire : Les Chroniques des vampires (1994), le vampire Lestat devient une star du rock dont la musique réveille la reine des vampires, aussi belle que monstrueuse.
Les connaisseurs sachant très bien à quel saint ne pas se vouer, se rappelleront du magique Parking de Jacques Demy, avec Francis Huster en pseudo-star maudite remplissant les salles parisiennes avec un pull moche. Ici, le mythe est transposé chez les vampires, qui n’avaient d’ailleurs rien demandé, et le réalisateur Michael Rymer s’en remet entièrement au charisme incroyable de sa star féminine, la regrettée Aaliyah partie bien trop tôt à l’âge de 22 ans. Mais aussi attractive soit la présence de la chanteuse au casting, encore faut-il que le reste suive. Ici, on se vautre dans les clichés comme les faux vampires romantiques dans l’hémoglobine, et les skyblogs, et le film parvient à être aussi grotesque que complètement anonyme, ce qui n’est pas systématiquement antinomique. Les acteurs font ce qu’ils peuvent pour paraître séduisants et branchés à la fois, mais ce gigantesque clip qui se place de lui-même sous la tutelle d’Entretien avec un Vampire pour capitaliser sur son succès, pâtit justement de la comparaison au vu de sa mise en scène académique et de son histoire improbable. Alors, une fois encore, on a recours aux stars de la distorsion de l’époque, entre Jonathan Davis, Chester Bennington, MARILYN MANSON, STATIC-X, DISTURBED, GODHEAD et les DEFTONES, abonnés depuis des années aux bandes-originales de films à deux sous. Mais on se console comme on peut.
 Lorsque l’annonce de l’adaptation d’un jeu vidéo culte s’est ébruitée à l’orée des années 2000, les gamers ne retenaient pas leur joie. Encore fallait-il que l’entreprise soit à la hauteur du jeu en question, l’un des blockbusters de console qui ont tant fait flipper les joueurs durant leurs nuits blanches. Mais évidemment, et inévitablement, la déception fut au rendez-vous, et lorsque les salles de cinéma ont commencé à diffuser les bobines de Resident Evil, les avis négatifs étaient déjà plus nombreux que les louanges. Pourtant, les ingrédients étaient là. Le casting, dominé par l‘investie Milla Jovovich, la mise en scène, calée sur le parti d’un jeu entre hystérie, peur et jubilation, le cadre claustrophobique d’un labo souterrain, et même les vilains, en masse, secondés par des bestioles fort peu avenantes. Mais - puisqu’il y en a toujours un - Resident Evil a échoué une fois de plus à rendre hommage à l’univers des jeux vidéo, la faute à un manque de fidélité, de body count affreusement bas, et de situations totalement improbables. Sans oublier des chiens digitaux à peu près aussi bien faits que la dernière chirurgie faciale de Madonna, des libertés prises avec le matériau original, et une dynamique d’action trop systématique, gommant les séquences oppressives du jeu. Loin d’une catastrophe visuelle, et même s’il a très mal vieilli, Resident Evil n’est quand même pas la concrétisation que les fidèles attendaient. On peut facilement lui préférer l’excellent Silent Hill, sorti quatre ans plus tard, et beaucoup plus en phase avec l’intrigue de base. Mais pour un quickie d’action, Resident Evil s’en sort avec presque les honneurs et avec les horreurs, imposant une fois encore une bande-son dominée par les incontournables. MARILYN MANSON, NINE INCH NAILS, SPINESHANK, les jeunes SLIPKNOT, COAL CHAMBER, FEAR FACTORY, la sempiternelle liste que les réalisateurs se partagent depuis des années, mais qui parvient quand même à motiver les troupes lors des séquences les plus énergiques. Ne disons pas anxiogène, puisque rien ne l’est dans ce film, pas plus que dans ses interminables séquelles, qui ont porté le principe du citron pressé à son paroxysme.
Lorsque l’annonce de l’adaptation d’un jeu vidéo culte s’est ébruitée à l’orée des années 2000, les gamers ne retenaient pas leur joie. Encore fallait-il que l’entreprise soit à la hauteur du jeu en question, l’un des blockbusters de console qui ont tant fait flipper les joueurs durant leurs nuits blanches. Mais évidemment, et inévitablement, la déception fut au rendez-vous, et lorsque les salles de cinéma ont commencé à diffuser les bobines de Resident Evil, les avis négatifs étaient déjà plus nombreux que les louanges. Pourtant, les ingrédients étaient là. Le casting, dominé par l‘investie Milla Jovovich, la mise en scène, calée sur le parti d’un jeu entre hystérie, peur et jubilation, le cadre claustrophobique d’un labo souterrain, et même les vilains, en masse, secondés par des bestioles fort peu avenantes. Mais - puisqu’il y en a toujours un - Resident Evil a échoué une fois de plus à rendre hommage à l’univers des jeux vidéo, la faute à un manque de fidélité, de body count affreusement bas, et de situations totalement improbables. Sans oublier des chiens digitaux à peu près aussi bien faits que la dernière chirurgie faciale de Madonna, des libertés prises avec le matériau original, et une dynamique d’action trop systématique, gommant les séquences oppressives du jeu. Loin d’une catastrophe visuelle, et même s’il a très mal vieilli, Resident Evil n’est quand même pas la concrétisation que les fidèles attendaient. On peut facilement lui préférer l’excellent Silent Hill, sorti quatre ans plus tard, et beaucoup plus en phase avec l’intrigue de base. Mais pour un quickie d’action, Resident Evil s’en sort avec presque les honneurs et avec les horreurs, imposant une fois encore une bande-son dominée par les incontournables. MARILYN MANSON, NINE INCH NAILS, SPINESHANK, les jeunes SLIPKNOT, COAL CHAMBER, FEAR FACTORY, la sempiternelle liste que les réalisateurs se partagent depuis des années, mais qui parvient quand même à motiver les troupes lors des séquences les plus énergiques. Ne disons pas anxiogène, puisque rien ne l’est dans ce film, pas plus que dans ses interminables séquelles, qui ont porté le principe du citron pressé à son paroxysme.
 Après les mutants, les vampires, les zombies et Julie Lescaut en Bolivie, les muscles et les bolides. Comment séparer l’homme de son œuvre dans le cas de notre boule de billard préférée Vin Diesel ? Peut-on l’imaginer autrement qu’en repris de justice sur une planète hostile, ou comme gros bandit au volant d’une bagnole au moteur gonflé ? Impossible je vous l’accorde, et Vin en rajoute une couche avec le très prévisible XXX, signé par le tâcheron Rob Cohen. Le duo tente de reproduire le miracle commercial de l’année précédente, lorsque Fast & Furious avait cassé la baraque et le box-office, plaçant derechef ce cher Vin en tête de la file des acteurs baraqués abonnés aux histoires à la testostérone. En 2002, Vin incarne Xander "XXX" Cage, amateur de sensations fortes qui a jusqu’à présent été considéré comme intouchable par la loi. L’agent de la NSA Gibbons force XXX à coopérer avec le gouvernement pour infiltrer un réseau criminel russe, et ainsi éviter d’aller en prison. Gibbons envoie XXX pour entrer dans ce monde de crime où tant d’autres ont échoué, en utilisant ses prouesses athlétiques naturelles. Xander doit combattre une organisation dirigée par un Yorgi rusé, impitoyable et nihiliste dont la première cible est la ville de Prague. Inutile de se le cacher, XXX fait partie de cette catégorie de films dont les années 2000 ont raffolé, et qui ont rapporté assez de dollars pour continuer d’exister. Si Diesel roule au super, la machine reste bien huilée, et on se laisse prendre à ce jeu de chat et souris sans trop avoir à forcer sur la patience et l’abnégation. Loin du faste et du furieux, Rob Cohen se contente du minimum syndical, conscient que l’impact de son film repose sur les épaules carrées de son interprète, ainsi que sur un certain panache au moment de filmer des séquences vraiment impressionnantes. Pour souligner cette virilité à peine atténuée par la présence d’Asia Argento au générique, Cohen déroule le paillasson à RAMMSTEIN, DROWNING POOL, QUEENS OF THE STONE AGE, HATEBREED et MUSHROOMHEAD, la clique habituelle dont on bat le rappel pour battre le bitume alors qu’il est encore chaud. Anecdotique, mais plutôt jouissif.
Après les mutants, les vampires, les zombies et Julie Lescaut en Bolivie, les muscles et les bolides. Comment séparer l’homme de son œuvre dans le cas de notre boule de billard préférée Vin Diesel ? Peut-on l’imaginer autrement qu’en repris de justice sur une planète hostile, ou comme gros bandit au volant d’une bagnole au moteur gonflé ? Impossible je vous l’accorde, et Vin en rajoute une couche avec le très prévisible XXX, signé par le tâcheron Rob Cohen. Le duo tente de reproduire le miracle commercial de l’année précédente, lorsque Fast & Furious avait cassé la baraque et le box-office, plaçant derechef ce cher Vin en tête de la file des acteurs baraqués abonnés aux histoires à la testostérone. En 2002, Vin incarne Xander "XXX" Cage, amateur de sensations fortes qui a jusqu’à présent été considéré comme intouchable par la loi. L’agent de la NSA Gibbons force XXX à coopérer avec le gouvernement pour infiltrer un réseau criminel russe, et ainsi éviter d’aller en prison. Gibbons envoie XXX pour entrer dans ce monde de crime où tant d’autres ont échoué, en utilisant ses prouesses athlétiques naturelles. Xander doit combattre une organisation dirigée par un Yorgi rusé, impitoyable et nihiliste dont la première cible est la ville de Prague. Inutile de se le cacher, XXX fait partie de cette catégorie de films dont les années 2000 ont raffolé, et qui ont rapporté assez de dollars pour continuer d’exister. Si Diesel roule au super, la machine reste bien huilée, et on se laisse prendre à ce jeu de chat et souris sans trop avoir à forcer sur la patience et l’abnégation. Loin du faste et du furieux, Rob Cohen se contente du minimum syndical, conscient que l’impact de son film repose sur les épaules carrées de son interprète, ainsi que sur un certain panache au moment de filmer des séquences vraiment impressionnantes. Pour souligner cette virilité à peine atténuée par la présence d’Asia Argento au générique, Cohen déroule le paillasson à RAMMSTEIN, DROWNING POOL, QUEENS OF THE STONE AGE, HATEBREED et MUSHROOMHEAD, la clique habituelle dont on bat le rappel pour battre le bitume alors qu’il est encore chaud. Anecdotique, mais plutôt jouissif.
 Paquet cadeau, puisque les fêtes approchent, Charlie's Angels et Charlie's Angels Full Throttle s’approprient la Pop Culture des années 70, et tentent de faire oublier les sublimes Jaclyn Smith, Cheryl Ladd et Farrah Fawcett. A la place, les très bankable Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu, qui donnent de leur personne pour déjouer les plans des malfrats. Evidemment, tout le charme de l’œuvre originale a disparu, écrasé par le rouleau-compresseur de l’action non-stop, mais pourtant, les deux volets ont ce petit quelque chose qui permet d’oublier un parti pris un peu trop radical. Il est évident que le choix des trois actrices a été pensé et voulu, et ces dames s’en tirent avec plus que les honneurs, en bénéficiant de personnages avec un minimum d’épaisseur et de personnalité. Si je n’échangerai jamais un seul épisode de la série produite par Aaron Spelling contre l’un ou l’autre de ces remakes, j’apprécie tout de même ce rythme un peu fou, ces séquences de castagne assez délirantes, et cette énergie qui ne se dément jamais. Evidemment, le premier des deux volumes est le meilleur des deux, le suivant se contentant de refourguer la même recette avec les mêmes ingrédients, mais une cuisson trop longue. Les filles en remontrent aux gros costauds et tiennent leur rang, pour ce plaisir mineur, mais pas coupable pour autant. Le soundtrack est lui aussi assez bâtard, confrontant KORN et DEEE-LITE (groove is still in the heart ?), PRODIGY et AEROSMITH, HEART et SPANDAU BALLET, HEDNOIZE et BLUR, pour respecter les diverses situations rencontrées par les héroïnes. Charlie's Angels Full Throttle se réserve les faveurs de RAGE AGAINST THE MACHINE, MÖTLEY CRÜE, WHITE ZOMBIE, BON JOVI, LOVERBOY, NICKELBACK et JOURNEY, pour un résultat largement en deçà de sa grande sœur. Le tout est frais, à réserver à une soirée sans inspiration, entre potes qui supportent les blockbusters faciles et les bastons féminines.
Paquet cadeau, puisque les fêtes approchent, Charlie's Angels et Charlie's Angels Full Throttle s’approprient la Pop Culture des années 70, et tentent de faire oublier les sublimes Jaclyn Smith, Cheryl Ladd et Farrah Fawcett. A la place, les très bankable Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu, qui donnent de leur personne pour déjouer les plans des malfrats. Evidemment, tout le charme de l’œuvre originale a disparu, écrasé par le rouleau-compresseur de l’action non-stop, mais pourtant, les deux volets ont ce petit quelque chose qui permet d’oublier un parti pris un peu trop radical. Il est évident que le choix des trois actrices a été pensé et voulu, et ces dames s’en tirent avec plus que les honneurs, en bénéficiant de personnages avec un minimum d’épaisseur et de personnalité. Si je n’échangerai jamais un seul épisode de la série produite par Aaron Spelling contre l’un ou l’autre de ces remakes, j’apprécie tout de même ce rythme un peu fou, ces séquences de castagne assez délirantes, et cette énergie qui ne se dément jamais. Evidemment, le premier des deux volumes est le meilleur des deux, le suivant se contentant de refourguer la même recette avec les mêmes ingrédients, mais une cuisson trop longue. Les filles en remontrent aux gros costauds et tiennent leur rang, pour ce plaisir mineur, mais pas coupable pour autant. Le soundtrack est lui aussi assez bâtard, confrontant KORN et DEEE-LITE (groove is still in the heart ?), PRODIGY et AEROSMITH, HEART et SPANDAU BALLET, HEDNOIZE et BLUR, pour respecter les diverses situations rencontrées par les héroïnes. Charlie's Angels Full Throttle se réserve les faveurs de RAGE AGAINST THE MACHINE, MÖTLEY CRÜE, WHITE ZOMBIE, BON JOVI, LOVERBOY, NICKELBACK et JOURNEY, pour un résultat largement en deçà de sa grande sœur. Le tout est frais, à réserver à une soirée sans inspiration, entre potes qui supportent les blockbusters faciles et les bastons féminines.
 Jusqu’à lors concentrée sur un répertoire entre Shakespeare et Jane Austen, Kate Beckinsale se tourne vers la mythologie fantastique, en incarnant Selene, vampire tombant amoureuse d’un simple mortel. Bien qu’assez réfractaire aux vampires et loups garous, je dois reconnaître que la saga Underworld fait partie de mes friandises préférées, puisque tournée comme des films d’action au caractère vaguement gothique, et plus inspirée par les boites branchées de Berlin que par la mystique victorienne. Totalement en adéquation avec son époque, Underworld dépeint avec une belle conviction cette guerre éternelle entre humains, lycanthropes et vampires, avec force costumes serrés, plans l’étant tout autant, décorum à la Hammer revisitée MARILYN MANSON, et sexualité sous-jacente et même parfois évidente. Contre toute attente, Underworld a connu un succès amplement mérité, entraînant dans son sillage un nombre conséquent de séquelles, avec plus ou moins de bonheur. Mais le plaisir de retrouver l’irrésistible Bill Nighy en patriarche discuté, Scott Speedman en humain incrédule mais rapidement contaminé l’emporte sur les quelques doutes quant à la légitimité de l’œuvre au regard des auteurs de légende Bram Stoker, ou la plus récente Anne Rice. Musicalement, évidemment, l’affrontement entre les créatures de la nuit avait besoin d’une énergie distordue et électronique, avec Amy Lee en vedette, mais aussi PUSCIFER, Wes Borland et A PERFECT CIRCLE. Il est raisonnable de penser s’enfiler la saga dans son intégralité, chaque chapitre possédant son ADN propre, même si le volume 2 semble se détacher niveau qualité. Mais on constate un léger mieux au niveau des productions calibrées, moins évidentes et aseptisées, et plus tournées vers une modernisation du mythe que par sa digestion par un Hollywood qui depuis longtemps se contente de compter les billets.
Jusqu’à lors concentrée sur un répertoire entre Shakespeare et Jane Austen, Kate Beckinsale se tourne vers la mythologie fantastique, en incarnant Selene, vampire tombant amoureuse d’un simple mortel. Bien qu’assez réfractaire aux vampires et loups garous, je dois reconnaître que la saga Underworld fait partie de mes friandises préférées, puisque tournée comme des films d’action au caractère vaguement gothique, et plus inspirée par les boites branchées de Berlin que par la mystique victorienne. Totalement en adéquation avec son époque, Underworld dépeint avec une belle conviction cette guerre éternelle entre humains, lycanthropes et vampires, avec force costumes serrés, plans l’étant tout autant, décorum à la Hammer revisitée MARILYN MANSON, et sexualité sous-jacente et même parfois évidente. Contre toute attente, Underworld a connu un succès amplement mérité, entraînant dans son sillage un nombre conséquent de séquelles, avec plus ou moins de bonheur. Mais le plaisir de retrouver l’irrésistible Bill Nighy en patriarche discuté, Scott Speedman en humain incrédule mais rapidement contaminé l’emporte sur les quelques doutes quant à la légitimité de l’œuvre au regard des auteurs de légende Bram Stoker, ou la plus récente Anne Rice. Musicalement, évidemment, l’affrontement entre les créatures de la nuit avait besoin d’une énergie distordue et électronique, avec Amy Lee en vedette, mais aussi PUSCIFER, Wes Borland et A PERFECT CIRCLE. Il est raisonnable de penser s’enfiler la saga dans son intégralité, chaque chapitre possédant son ADN propre, même si le volume 2 semble se détacher niveau qualité. Mais on constate un léger mieux au niveau des productions calibrées, moins évidentes et aseptisées, et plus tournées vers une modernisation du mythe que par sa digestion par un Hollywood qui depuis longtemps se contente de compter les billets.
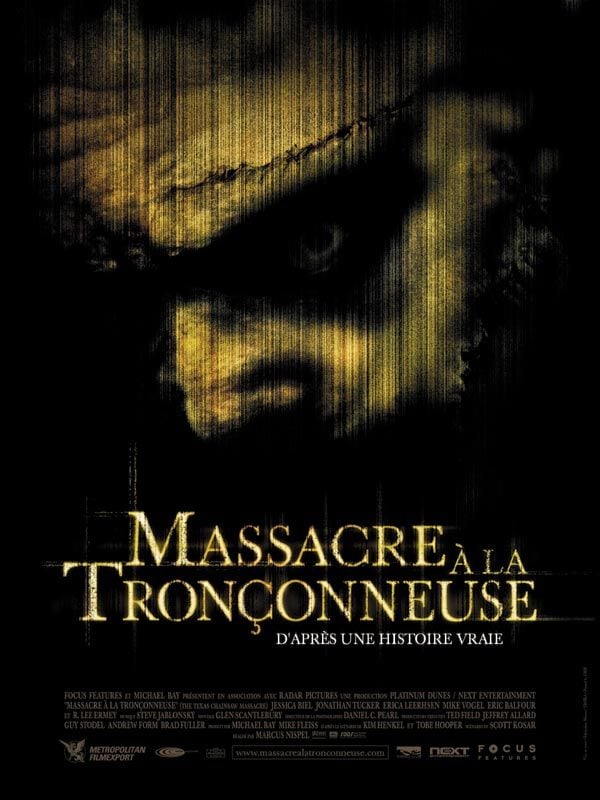 On n’a pas toujours besoin d’un remake. Ou d’une séquelle. Ou d’une préquelle. Mais certaines franchises sont si lucratives qu’elles ont droit…aux trois. Ainsi, ce pauvre Leatherface, déjà bien entamé, s’est vu relooké et rajeuni en 2003 par Marcus Nispel, qui souhaitait remettre le Texas sur la carte de l’horreur. Sur le même scénario que le chef d’œuvre de 1974, Nispel joue à fond le jeu du jeunisme, convoque des stars en vogue (Jessica Biel, Erica Leerhsen vue dans le « brillant » Blair Witch 2, Jonathan Tucker) pour les confronter à cette famille de dégénérés qui a toujours vécu de la viande. Sans doute pour faire oublier la catastrophe planétaire du ridicule et impardonnable Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation de 1994 (à voir absolument pour se taper sur le ventre de tristesse), The Texas Chainsaw Massacre se paie le titre original, prend une ou deux libertés avec le métrage d’origine, mais parvient quand même à intéresser le fan qui acceptera de troquer le malaise persistant du premier volume contre une efficacité plus volontiers Gore. Pas indispensable, mais loin d’être honteux, ce remake est à l’image de l’imagination d’Hollywood depuis le début des années 2000. Plutôt que de miser sur des scripts inventifs, la Mecque du cinéma se contente de revisiter sa légende, la plupart du temps en aseptisant le propos de base des œuvres qu’elle se réapproprie. Ici, le carnage artistique est évité, même si Tobe Hooper peut dormir tranquille sur ses deux oreilles. On saluera quand même cette volonté de rester crasseux, de transformer de pauvres jeunes en gibier à traquer à la chaîne et l’huile, et on admettra finalement que ce remake est loin d’être le pire jamais proposé (palme qui revient ex-aequo à Psycho et Cabin Fever). Musicalement, le public Metal est à la fête, avec un soundtrack de l’enfer. PANTERA, HATEBREED, STATIC-X, MUSHROOMHEAD, MESHUGGAH, FEAR FACTORY, MORBID ANGEL, LAMB OF GOD, de quoi faire tourner la mythique tronçonneuse à plein régime. Une belle adéquation entre l’image et le son, même s’il est légitime de regretter les longs silences de l’original, et ce score décrépi et flippant.
On n’a pas toujours besoin d’un remake. Ou d’une séquelle. Ou d’une préquelle. Mais certaines franchises sont si lucratives qu’elles ont droit…aux trois. Ainsi, ce pauvre Leatherface, déjà bien entamé, s’est vu relooké et rajeuni en 2003 par Marcus Nispel, qui souhaitait remettre le Texas sur la carte de l’horreur. Sur le même scénario que le chef d’œuvre de 1974, Nispel joue à fond le jeu du jeunisme, convoque des stars en vogue (Jessica Biel, Erica Leerhsen vue dans le « brillant » Blair Witch 2, Jonathan Tucker) pour les confronter à cette famille de dégénérés qui a toujours vécu de la viande. Sans doute pour faire oublier la catastrophe planétaire du ridicule et impardonnable Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation de 1994 (à voir absolument pour se taper sur le ventre de tristesse), The Texas Chainsaw Massacre se paie le titre original, prend une ou deux libertés avec le métrage d’origine, mais parvient quand même à intéresser le fan qui acceptera de troquer le malaise persistant du premier volume contre une efficacité plus volontiers Gore. Pas indispensable, mais loin d’être honteux, ce remake est à l’image de l’imagination d’Hollywood depuis le début des années 2000. Plutôt que de miser sur des scripts inventifs, la Mecque du cinéma se contente de revisiter sa légende, la plupart du temps en aseptisant le propos de base des œuvres qu’elle se réapproprie. Ici, le carnage artistique est évité, même si Tobe Hooper peut dormir tranquille sur ses deux oreilles. On saluera quand même cette volonté de rester crasseux, de transformer de pauvres jeunes en gibier à traquer à la chaîne et l’huile, et on admettra finalement que ce remake est loin d’être le pire jamais proposé (palme qui revient ex-aequo à Psycho et Cabin Fever). Musicalement, le public Metal est à la fête, avec un soundtrack de l’enfer. PANTERA, HATEBREED, STATIC-X, MUSHROOMHEAD, MESHUGGAH, FEAR FACTORY, MORBID ANGEL, LAMB OF GOD, de quoi faire tourner la mythique tronçonneuse à plein régime. Une belle adéquation entre l’image et le son, même s’il est légitime de regretter les longs silences de l’original, et ce score décrépi et flippant.
 Restons dans le domaine horrifique, avec l’un des films les plus emblématiques de son époque, Saw. Aux côtés de Paranormal Activity, Final Destination, American Nightmare ou même Friday The 13th, le film de l’incontournable James Wan a donné un bon coup de fouet à la terreur de papa, en profitant pour donner naissance - bien involontairement - à ce qu’on a baptisé plus tard le « Torture Porn ». Loin des égarements de ses séquelles, toutes plus graphiques et ennuyeuses les unes que les autres (à l’exception du volume 3, au-dessus de la moyenne), Saw se construit sur une histoire diaboliquement simple, mais méchamment effective. Deux inconnus se réveillent dans une pièce sans se souvenir de comment ils y sont arrivés. Ils découvrent vite qu'ils sont des pions dans un jeu mortel perpétré par un tueur en série mal embouché. Ainsi débarque sur les écrans médusés le fameux Jigsaw, boogeyman ultime, et le plus humain de tous. Car Jigsaw ne tue jamais gratuitement, et laisse toujours une chance à ses victimes de s’en sortir. Certes, cette chance s’accompagne souvent d’une ou deux mutilations, mais rester en vie malgré ses péchés à un prix, que tous ne sont pas prêts à payer. Les deux bougres, qui réalisent qu’ils sont liés par la même histoire vont l’apprendre à leurs dépens, et surtout, à ceux de leurs membres. Pas encore versé sur les blessures hideuses, Saw joue plus la carte de la tension et de la surprise que de l’horreur graphique pure, et nous prend aux tripes, le twist final restant gravé dans les rétines comme ceux de Se7en, Le Sixième Sens ou Usual Suspects. Pour illustrer cette panique, la production mise gros sur Charlie Clouser, qui truste une grosse moitié de la BO, partageant les restes avec les inévitables FEAR FACTORY, mais aussi les petits nouveaux CHIMAIRA, ou ILLDISPOSED. Une bonne grosse claque, pour un petit film au petit budget beaucoup plus malin que la moyenne.
Restons dans le domaine horrifique, avec l’un des films les plus emblématiques de son époque, Saw. Aux côtés de Paranormal Activity, Final Destination, American Nightmare ou même Friday The 13th, le film de l’incontournable James Wan a donné un bon coup de fouet à la terreur de papa, en profitant pour donner naissance - bien involontairement - à ce qu’on a baptisé plus tard le « Torture Porn ». Loin des égarements de ses séquelles, toutes plus graphiques et ennuyeuses les unes que les autres (à l’exception du volume 3, au-dessus de la moyenne), Saw se construit sur une histoire diaboliquement simple, mais méchamment effective. Deux inconnus se réveillent dans une pièce sans se souvenir de comment ils y sont arrivés. Ils découvrent vite qu'ils sont des pions dans un jeu mortel perpétré par un tueur en série mal embouché. Ainsi débarque sur les écrans médusés le fameux Jigsaw, boogeyman ultime, et le plus humain de tous. Car Jigsaw ne tue jamais gratuitement, et laisse toujours une chance à ses victimes de s’en sortir. Certes, cette chance s’accompagne souvent d’une ou deux mutilations, mais rester en vie malgré ses péchés à un prix, que tous ne sont pas prêts à payer. Les deux bougres, qui réalisent qu’ils sont liés par la même histoire vont l’apprendre à leurs dépens, et surtout, à ceux de leurs membres. Pas encore versé sur les blessures hideuses, Saw joue plus la carte de la tension et de la surprise que de l’horreur graphique pure, et nous prend aux tripes, le twist final restant gravé dans les rétines comme ceux de Se7en, Le Sixième Sens ou Usual Suspects. Pour illustrer cette panique, la production mise gros sur Charlie Clouser, qui truste une grosse moitié de la BO, partageant les restes avec les inévitables FEAR FACTORY, mais aussi les petits nouveaux CHIMAIRA, ou ILLDISPOSED. Une bonne grosse claque, pour un petit film au petit budget beaucoup plus malin que la moyenne.
 Un Punisher avec John Travolta ? Sur le papier, et pour l’époque, ça peut être vendeur, mais dans la réalité des faits, ça l’est beaucoup moins. Le scientologue Disco est pourtant au générique du film de Jonathan Hensleigh en 2004, pour une nouvelle version de l’antihéros de Marvel. Suivant de quinze ans la première tentative featuring Dolph Lundgren, The Punisher peine à retrouver cette ambiance noire et pourtant enthousiasmante de son aîné. Le pitch pour les étourdis ? L’agent spécial Frank Castle avait tout : une famille aimante, une vie formidable et un travail passionnant. Mais quand sa vie lui est enlevée par un criminel impitoyable et ses associés, Frank renaît. Maintenant, en tant que juge, jury et bourreau, il incarne un nouveau type de justicier menant sa propre guerre contre ceux qui lui ont tout pris. La bonne vieille histoire de vengeance à la Death Wish, sans Bronson, mais avec le très transparent Thomas Jane, vu dans Boogie Nights (1997), Peur Bleue (1999) et La Ligne Rouge (1998). Si John T fait ce qu’il peut pour donner de l’épaisseur à son personnage, Jane ne parvient pas à rééditer la performance de Dolph Lundgren, impeccable dans la peau de ce Lazare mutique et investi d’une mission divine. Décapité par la critique, mais apprécié par une certaine frange du public (les Marvel n’étaient pas encore ce qu’ils sont aujourd’hui), The Punisher n’a pas gagné à vieillir, et reste une tentative maladroite, mais dotée d’un budget confortable. Une partie en a d’ailleurs été accordée à la musique, avec les interventions de DROWNING POOL, NICKELBACK, Amy LEE, Ken Tamplin, qui donnent un peu d’énergie à ce métrage académique, et loin du potentiel subversif de l’œuvre picturale originelle. D’autres exemples suivront, mais permettez-moi de garder Dolph dans mon cœur et de ne pas m’y intéresser.
Un Punisher avec John Travolta ? Sur le papier, et pour l’époque, ça peut être vendeur, mais dans la réalité des faits, ça l’est beaucoup moins. Le scientologue Disco est pourtant au générique du film de Jonathan Hensleigh en 2004, pour une nouvelle version de l’antihéros de Marvel. Suivant de quinze ans la première tentative featuring Dolph Lundgren, The Punisher peine à retrouver cette ambiance noire et pourtant enthousiasmante de son aîné. Le pitch pour les étourdis ? L’agent spécial Frank Castle avait tout : une famille aimante, une vie formidable et un travail passionnant. Mais quand sa vie lui est enlevée par un criminel impitoyable et ses associés, Frank renaît. Maintenant, en tant que juge, jury et bourreau, il incarne un nouveau type de justicier menant sa propre guerre contre ceux qui lui ont tout pris. La bonne vieille histoire de vengeance à la Death Wish, sans Bronson, mais avec le très transparent Thomas Jane, vu dans Boogie Nights (1997), Peur Bleue (1999) et La Ligne Rouge (1998). Si John T fait ce qu’il peut pour donner de l’épaisseur à son personnage, Jane ne parvient pas à rééditer la performance de Dolph Lundgren, impeccable dans la peau de ce Lazare mutique et investi d’une mission divine. Décapité par la critique, mais apprécié par une certaine frange du public (les Marvel n’étaient pas encore ce qu’ils sont aujourd’hui), The Punisher n’a pas gagné à vieillir, et reste une tentative maladroite, mais dotée d’un budget confortable. Une partie en a d’ailleurs été accordée à la musique, avec les interventions de DROWNING POOL, NICKELBACK, Amy LEE, Ken Tamplin, qui donnent un peu d’énergie à ce métrage académique, et loin du potentiel subversif de l’œuvre picturale originelle. D’autres exemples suivront, mais permettez-moi de garder Dolph dans mon cœur et de ne pas m’y intéresser.
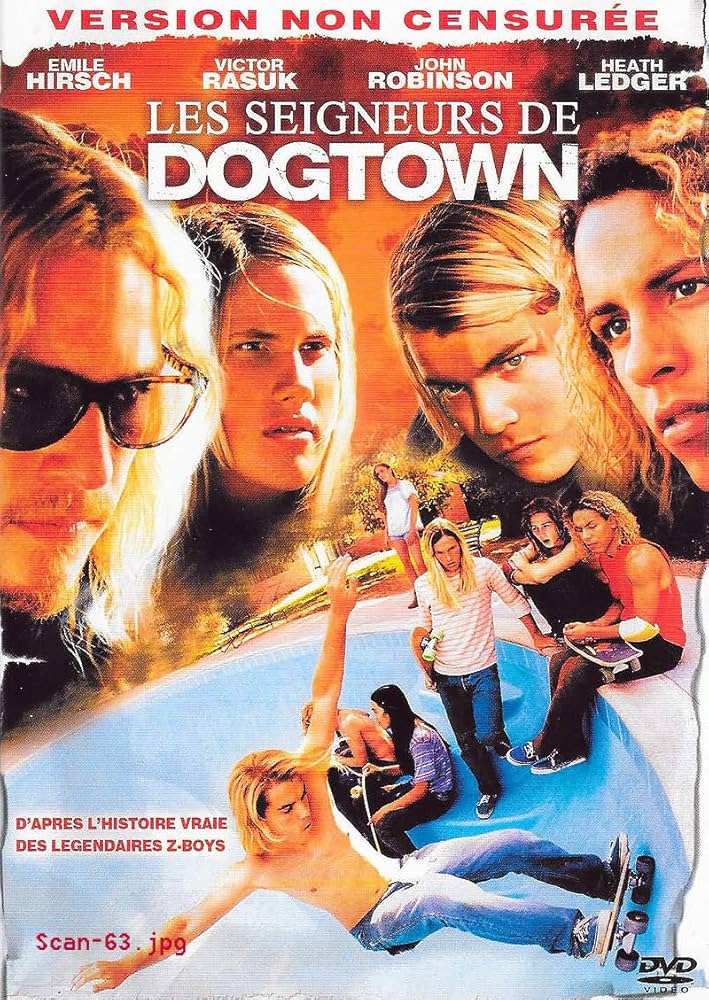 Parlons maintenant d’un film cher à mon cœur, qui en 2005 a été l’un de mes grands moments de cinéma. Les Seigneurs de Dogtown décrit avec un réalisme désarmant les tendances du surf et du skateboard qui ont vu le jour à Venice, en Californie, dans les années 70, par le biais d’un trio de personnages centraux aux destins et aux personnalités divers. La caméra suit donc les aventures du groupe de jeunes skateurs surdoués élevés dans les rues de Dogtown à Santa Monica, en Californie. Les Z-Boys, comme on les appelle, perfectionnent leur art dans les piscines vides des propriétaires de banlieue, élaborant la première étape d’un nouveau sport passionnant et en devenant finalement des légendes. Porté par un casting merveilleux, entre Heath Ledger, Emile Hirsch, Johnny Knoxville, Rebecca De Mornay, Les Seigneurs de Dogtown est une formidable immersion dans l’univers du skate-board américain, et de ses héros les plus mythiques. Si les spécialistes reconnaîtront l’ambiance de l’époque, magnifiquement transposée dans une chaleur estivale dorée, d’autres savoureront la naissance du Venice de SUICIDAL TENDENCIES, avec les bandanas vissés sur le front et les mines patibulaires défiant les autres clans. Avec une maestria incroyable pour mettre en scène les séquences sportives, Catherine Hardwicke nous fait basculer dans le temps et l’espace, en les laissant justement à cette génération issue de la classe ouvrière prête à tout défoncer pour croquer un bout du rêve américain. Passionné et passionnant pendant près de deux heures, Les Seigneurs de Dogtown est l’un des meilleurs films consacrés au sports de glisse, et la rivalité entre les trois protagonistes porte le drame à son paroxysme, lorsqu’ils sont tous trois courtisés par des équipes et sponsors différents. La B.O est un régal, avec Ted NUGENT, NAZARETH, SOCIAL DISTORTION, FOGHAT, THE SWEET, Jimi HENDRIX, DEEP PURPLE, BLACK SABBATH, T REX, Robin TROWER, ALICE COOPER, BLUE ÖYSTER CULT, soit la quintessence d’un juke-box des seventies calé sur les meilleurs singles. Capable de son rythme d’intéresser les néophytes comme de fédérer les plus férus, Les Seigneurs de Dogtown est à l’image de son thème : effréné, impudique, sans-gêne, rapide, dangereux et finalement cathartique. Brillant, pour le moins.
Parlons maintenant d’un film cher à mon cœur, qui en 2005 a été l’un de mes grands moments de cinéma. Les Seigneurs de Dogtown décrit avec un réalisme désarmant les tendances du surf et du skateboard qui ont vu le jour à Venice, en Californie, dans les années 70, par le biais d’un trio de personnages centraux aux destins et aux personnalités divers. La caméra suit donc les aventures du groupe de jeunes skateurs surdoués élevés dans les rues de Dogtown à Santa Monica, en Californie. Les Z-Boys, comme on les appelle, perfectionnent leur art dans les piscines vides des propriétaires de banlieue, élaborant la première étape d’un nouveau sport passionnant et en devenant finalement des légendes. Porté par un casting merveilleux, entre Heath Ledger, Emile Hirsch, Johnny Knoxville, Rebecca De Mornay, Les Seigneurs de Dogtown est une formidable immersion dans l’univers du skate-board américain, et de ses héros les plus mythiques. Si les spécialistes reconnaîtront l’ambiance de l’époque, magnifiquement transposée dans une chaleur estivale dorée, d’autres savoureront la naissance du Venice de SUICIDAL TENDENCIES, avec les bandanas vissés sur le front et les mines patibulaires défiant les autres clans. Avec une maestria incroyable pour mettre en scène les séquences sportives, Catherine Hardwicke nous fait basculer dans le temps et l’espace, en les laissant justement à cette génération issue de la classe ouvrière prête à tout défoncer pour croquer un bout du rêve américain. Passionné et passionnant pendant près de deux heures, Les Seigneurs de Dogtown est l’un des meilleurs films consacrés au sports de glisse, et la rivalité entre les trois protagonistes porte le drame à son paroxysme, lorsqu’ils sont tous trois courtisés par des équipes et sponsors différents. La B.O est un régal, avec Ted NUGENT, NAZARETH, SOCIAL DISTORTION, FOGHAT, THE SWEET, Jimi HENDRIX, DEEP PURPLE, BLACK SABBATH, T REX, Robin TROWER, ALICE COOPER, BLUE ÖYSTER CULT, soit la quintessence d’un juke-box des seventies calé sur les meilleurs singles. Capable de son rythme d’intéresser les néophytes comme de fédérer les plus férus, Les Seigneurs de Dogtown est à l’image de son thème : effréné, impudique, sans-gêne, rapide, dangereux et finalement cathartique. Brillant, pour le moins.
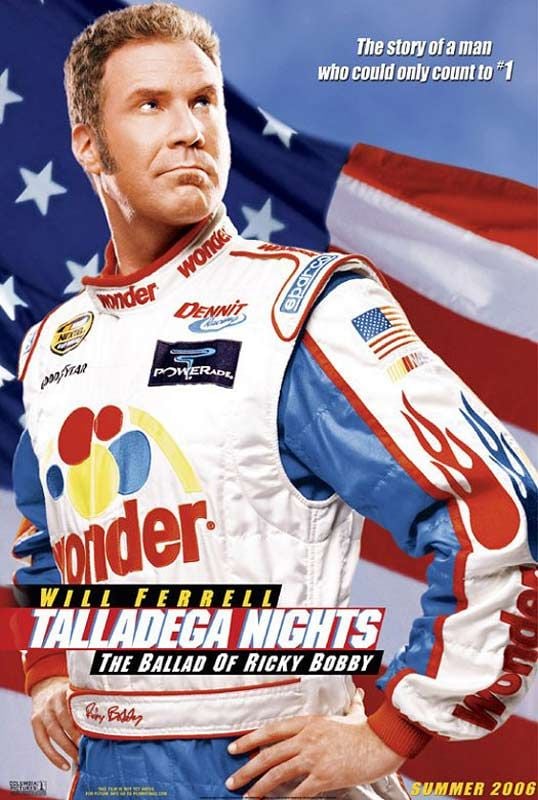 La sensation du NASCAR, Ricky Bobby, est un héros national grâce à son crédo "gagner à tout prix". Lui et son fidèle partenaire de course, l’ami d’enfance Cal Naughton Jr., forment un duo intrépide : Shake et Bake, grâce à leur capacité à terminer tant de courses aux positions 1 et 2, avec Cal toujours derrière. Lorsque le flamboyant pilote de Formule 1 français Jean Girard défie Shake et Bake pour la suprématie sur le NASCAR, Ricky Bobby doit affronter ses propres démons et combattre Girard pour le droit d’être reconnu comme le meilleur pilote de course du monde. Entre de mauvaises mains, un pitch pareil aurait donné une catastrophe planétaire, un séisme puissance 10 sur l’échelle d’Adam Sandler. Un genre de mix nullissime entre Le Mans et Jours de Tonnerre, revisité Benny Hill et Saturday Night Live un samedi de grève générale. Mais grâce à la douce folie d’Adam McKay, déjà aux commandes de l’irrésistible Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby est devenu un pastiche génial, une parodie magique, et une sacrée tranche de rire. Il faut dire que le casting laissait augurer du meilleur du pire, avec dans les rôles principaux le trio émoustillant Will Ferrell/John C. Reilly/Sacha Baron Cohen, qui fonctionne à plein régime dans le cabotinage, mais aussi dans l’émotion. Will Ferrell, inoubliable joueur de cowbell dans un sketch hilarant du SNL partage ici les responsabilités en trois, et se montre taillé pour ce costume de pilote qui lui colle à la peau comme les sièges de sa voiture dans Retour à la Fac. Exigeant dans les gags, pointilleux sur les reconstitutions, The Ballad of Ricky Bobby est une petite merveille d’humour loufoque, comme Hollywood sait parfois en produire lorsque la cité du cinéma oublie la facilité. Niveau son, il fallait se mettre au niveau du vrombissement des moteurs, ce que font AUDIOSLAVE, MÖTLEY CRÜE, BUCKCHERRY, LYNYRD SKYNYRD, Steve EARLE, JOURNEY, MONSTER MAGNET, AC/DC, ou SEPULTURA. Une playlist impeccable et un film totalement barré, mais pas moins prenant pour autant, le cocktail est salé, et le goût persistant dans la mémoire. De quoi donner envie de faire des cascades avec son Alfa Roméo en écoutant « I Can’t Drive 55 » de Sammy HAGAR.
La sensation du NASCAR, Ricky Bobby, est un héros national grâce à son crédo "gagner à tout prix". Lui et son fidèle partenaire de course, l’ami d’enfance Cal Naughton Jr., forment un duo intrépide : Shake et Bake, grâce à leur capacité à terminer tant de courses aux positions 1 et 2, avec Cal toujours derrière. Lorsque le flamboyant pilote de Formule 1 français Jean Girard défie Shake et Bake pour la suprématie sur le NASCAR, Ricky Bobby doit affronter ses propres démons et combattre Girard pour le droit d’être reconnu comme le meilleur pilote de course du monde. Entre de mauvaises mains, un pitch pareil aurait donné une catastrophe planétaire, un séisme puissance 10 sur l’échelle d’Adam Sandler. Un genre de mix nullissime entre Le Mans et Jours de Tonnerre, revisité Benny Hill et Saturday Night Live un samedi de grève générale. Mais grâce à la douce folie d’Adam McKay, déjà aux commandes de l’irrésistible Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby est devenu un pastiche génial, une parodie magique, et une sacrée tranche de rire. Il faut dire que le casting laissait augurer du meilleur du pire, avec dans les rôles principaux le trio émoustillant Will Ferrell/John C. Reilly/Sacha Baron Cohen, qui fonctionne à plein régime dans le cabotinage, mais aussi dans l’émotion. Will Ferrell, inoubliable joueur de cowbell dans un sketch hilarant du SNL partage ici les responsabilités en trois, et se montre taillé pour ce costume de pilote qui lui colle à la peau comme les sièges de sa voiture dans Retour à la Fac. Exigeant dans les gags, pointilleux sur les reconstitutions, The Ballad of Ricky Bobby est une petite merveille d’humour loufoque, comme Hollywood sait parfois en produire lorsque la cité du cinéma oublie la facilité. Niveau son, il fallait se mettre au niveau du vrombissement des moteurs, ce que font AUDIOSLAVE, MÖTLEY CRÜE, BUCKCHERRY, LYNYRD SKYNYRD, Steve EARLE, JOURNEY, MONSTER MAGNET, AC/DC, ou SEPULTURA. Une playlist impeccable et un film totalement barré, mais pas moins prenant pour autant, le cocktail est salé, et le goût persistant dans la mémoire. De quoi donner envie de faire des cascades avec son Alfa Roméo en écoutant « I Can’t Drive 55 » de Sammy HAGAR.
 Partons ensemble dans le métaverse, à la rencontre d’un des super-héros les plus aimés du public américain, Iron Man. L’univers Marvel, alors encore en gestation, lance sa phase 1 avec Tony Stark, scientifique multimilliardaire aussi mégalo que doué d’empathie pour ses contemporains. Le pitch est simple, et permet de jeter les bases du cycle des pierres de l’infini : après avoir été retenu prisonnier dans une grotte afghane, l'ingénieur milliardaire Tony Stark crée une armure unique pour lutter contre le mal. Sur le papier, tout ça sonne comme un gros blockbuster mêlant action, émotion et effets spéciaux à gogo…et sur l’écran, le résultat est le même. Mais avec le charisme incroyable de Robert Downey Jr, alors en pleine rédemption après des nineties troublées, une Gwyneth Paltrow qui donne de l’épaisseur à son personnage, une réalisation signée Jon Favreau et des clins d’œil à la galaxie sci-fi et fantastique, Iron Man impose le style Marvel en version définitive, avant que les autres personnages de la franchise n’entrent en jeu. Car après tout, c’est bien lui qui se trouve au centre de l’action, et lui qui permet à chaque nouveau tome de perfectionner son attirail tout en trouvant des solutions pour changer l’histoire. Sa mort dans le tome final des Avengers est d’ailleurs l’un des moments les plus déchirants de la franchise, tant son humanité a transpiré des quatre volets lui étant consacrés. Personne ne se doutait alors de l’importance qu’allait prendre le MCU dans la culture cinématographique mondiale, amassant des milliards de dollars avant de montrer des signes de faiblesse lors du passage à la phase 5. Comme tout bon blockbuster d’action qui se respecte, Iron Man peut compter sur la participation de nombreux artistes amplifiés pour agrémenter sa bande-son de passages homériques. AC/DC, SUICIDAL TENDENCIES, et évidemment BLACK SABBATH et son inévitable « Iron Man » se succèdent donc entre deux tranches de score, pour catapulter le milliardaire dans l’espace, et dans la stratosphère des figures iconiques de la pop culture. Jouissif, tendre, drôle, Iron Man est avec la tétralogie des Avengers le meilleur du MCU, et forcément, le plus fort de tous. Oui, même plus fort que Thor ou Thanos.
Partons ensemble dans le métaverse, à la rencontre d’un des super-héros les plus aimés du public américain, Iron Man. L’univers Marvel, alors encore en gestation, lance sa phase 1 avec Tony Stark, scientifique multimilliardaire aussi mégalo que doué d’empathie pour ses contemporains. Le pitch est simple, et permet de jeter les bases du cycle des pierres de l’infini : après avoir été retenu prisonnier dans une grotte afghane, l'ingénieur milliardaire Tony Stark crée une armure unique pour lutter contre le mal. Sur le papier, tout ça sonne comme un gros blockbuster mêlant action, émotion et effets spéciaux à gogo…et sur l’écran, le résultat est le même. Mais avec le charisme incroyable de Robert Downey Jr, alors en pleine rédemption après des nineties troublées, une Gwyneth Paltrow qui donne de l’épaisseur à son personnage, une réalisation signée Jon Favreau et des clins d’œil à la galaxie sci-fi et fantastique, Iron Man impose le style Marvel en version définitive, avant que les autres personnages de la franchise n’entrent en jeu. Car après tout, c’est bien lui qui se trouve au centre de l’action, et lui qui permet à chaque nouveau tome de perfectionner son attirail tout en trouvant des solutions pour changer l’histoire. Sa mort dans le tome final des Avengers est d’ailleurs l’un des moments les plus déchirants de la franchise, tant son humanité a transpiré des quatre volets lui étant consacrés. Personne ne se doutait alors de l’importance qu’allait prendre le MCU dans la culture cinématographique mondiale, amassant des milliards de dollars avant de montrer des signes de faiblesse lors du passage à la phase 5. Comme tout bon blockbuster d’action qui se respecte, Iron Man peut compter sur la participation de nombreux artistes amplifiés pour agrémenter sa bande-son de passages homériques. AC/DC, SUICIDAL TENDENCIES, et évidemment BLACK SABBATH et son inévitable « Iron Man » se succèdent donc entre deux tranches de score, pour catapulter le milliardaire dans l’espace, et dans la stratosphère des figures iconiques de la pop culture. Jouissif, tendre, drôle, Iron Man est avec la tétralogie des Avengers le meilleur du MCU, et forcément, le plus fort de tous. Oui, même plus fort que Thor ou Thanos.
 Moins épais, moins long, moins sujet à séquelles enchantées, Shoot'Em Up, le quickie vidéogamé de Michael Davis. Si Iron Man s’adresse à la frange la plus portée sur les comics de la jeunesse américaine, Shoot'Em Up louche vers les game addicts, qui connaissent bien le principe du shoot em’all. Pas de prise de tête, pas de question existentielle, le but est de flinguer tous azimuts, en prenant soin de débarrasser la terre de quelques nuisibles. L’impeccable Clive Owen, la toujours sublime Monica Bellucci, l’irremplaçable Paul Giamatti s’agitent dans un univers de crime, de gangsters, de vengeurs et de donneurs de leçon, et transforment ces quatre-vingt minutes de métrage en grand-huit qu’on apprécie pour ce qu’il est. Loin des sommets atteints par d’autres films abordés avec plus de moyens et d’ambitions, Shoot'Em Up n’en est pas moins étourdissant de violence toon et de virtuosité de caméra, et atteint son but sans trop en faire : nous divertir, nous vider la tête, et nous en donner pour notre argent en nous remboursant en courses-poursuites, gunfights, cascades et autres figures de style du cinéma d’action. Les metalheads ont évidemment adoubé le truc, une fois le casting musical dévoilé. MOTORHEAD, STRAPPING YOUNG LAD, AC/DC, NIRVANA et son « Breed » épileptique, WOLFMOTHER, MÖTLEY CRÜE et son « Kickstart my Heart » qui plait beaucoup aux amateurs de bolides, l’autoradio abuse de son loudness et grave pour l’éternité l‘union entre le cinéma rythmique et la musique la plus électrique. Anecdotique, mais plaisant.
Moins épais, moins long, moins sujet à séquelles enchantées, Shoot'Em Up, le quickie vidéogamé de Michael Davis. Si Iron Man s’adresse à la frange la plus portée sur les comics de la jeunesse américaine, Shoot'Em Up louche vers les game addicts, qui connaissent bien le principe du shoot em’all. Pas de prise de tête, pas de question existentielle, le but est de flinguer tous azimuts, en prenant soin de débarrasser la terre de quelques nuisibles. L’impeccable Clive Owen, la toujours sublime Monica Bellucci, l’irremplaçable Paul Giamatti s’agitent dans un univers de crime, de gangsters, de vengeurs et de donneurs de leçon, et transforment ces quatre-vingt minutes de métrage en grand-huit qu’on apprécie pour ce qu’il est. Loin des sommets atteints par d’autres films abordés avec plus de moyens et d’ambitions, Shoot'Em Up n’en est pas moins étourdissant de violence toon et de virtuosité de caméra, et atteint son but sans trop en faire : nous divertir, nous vider la tête, et nous en donner pour notre argent en nous remboursant en courses-poursuites, gunfights, cascades et autres figures de style du cinéma d’action. Les metalheads ont évidemment adoubé le truc, une fois le casting musical dévoilé. MOTORHEAD, STRAPPING YOUNG LAD, AC/DC, NIRVANA et son « Breed » épileptique, WOLFMOTHER, MÖTLEY CRÜE et son « Kickstart my Heart » qui plait beaucoup aux amateurs de bolides, l’autoradio abuse de son loudness et grave pour l’éternité l‘union entre le cinéma rythmique et la musique la plus électrique. Anecdotique, mais plaisant.
 Lorsque l’horreur et l’humour se mettent au diapason, ça peut donner un résultat très intéressant. Nous avons tous en tête les classiques Braindead, Re-Animator, Street Trash ou encore le sublime Shaun of the Dead, courte liste non exhaustive à laquelle il convient d’ajouter le désormais incontournable Bienvenue à Zombieland. Sur le pitch le plus évident du monde - le virus qui transforme tout le monde en Michel Houellebecq - Ruben Fleischer nous brode un road-trip improbable, le tout vécu à travers quatre personnages phare. Columbus, étudiant timide qui essaie de retrouver sa famille dans l'Ohio, Tallahassee, dur à cuire armé jusqu'aux dents à la recherche du dernier Twinkie, son biscuit préféré, et deux sœurs qui tentent de rejoindre un parc d'attractions unissent leurs forces pour traverser tout le pays qui grouille de zombies. Le postulat est posé, encore fallait-il transcender les poncifs pour parvenir à équilibrer le frisson et l’émotion. Mais avec un tel casting, rien d’impossible. Jesse Eisenberg, Emma Stone, Woody Harrelson, et Abigail Breslin rivalisent de leur talent pour porter cette histoire archi-rebattue à des hauteurs insoupçonnables, et tels des Mamas and Papas de l’extrême, traversent ville sur ville en affrontant des dangers qui les touchent de manière différente. Si Colombus, rongé de tocs et de règles de survie nous rend allergique aux clowns, si Tallahassee donne un nouveau sens au swing d’une batte de baseball, Wichita et Little Rock, frangines pas si sages, incarnent les deux personnages les plus intelligents, ce qui change un peu de la routine horrifique qui utilise la plupart du temps la gent féminine comme appât à tueur en série. Outre la fascination de Woody pour ce gâteau spongieux, l’obsession de Jesse pour les mèches de cheveux passés derrière l’oreille et autres aventures dans des magasins de souvenirs, l’apparition incroyable de Bill Murray dans son propre rôle reste l’un des clins d’œil les plus savoureux du cinéma. Aussi drôle qu’il n’est attachant, Bienvenue à Zombieland reste à ce jour l’une des plus grandes réussites du cinéma d’horreur se permettant une incartade sur le terrain de la comédie. Le genre de film qu’on peut se passer et repasser sans s’en lasser, tant il fourmille de répliques cultes et de gimmicks addictifs. L’un d’entre eux figure d’ailleurs dès le générique. Alors que Columbus énonce les règles à respecter pour rester en vie, les zombies s’affairent sur l’écran au rythme du plombé « For Whom the Bell Tolls » de METALLICA, créant dès le départ une connexion avec le public Metal. Ajoutez aux californiens les autres californiens de VAN HALEN, un soupçon de BLUE OYSTER CULT, un morceau méchamment Rock des RACONTEURS de Jack White, et vous obtenez le cocktail le plus rafraichissant de 2009. En moins d’une heure et trente minutes, Ruben Fleischer réinvente la comédie horrifique, et pave la voie pour une séquelle sympathique, quoi que moins réussie. La classe.
Lorsque l’horreur et l’humour se mettent au diapason, ça peut donner un résultat très intéressant. Nous avons tous en tête les classiques Braindead, Re-Animator, Street Trash ou encore le sublime Shaun of the Dead, courte liste non exhaustive à laquelle il convient d’ajouter le désormais incontournable Bienvenue à Zombieland. Sur le pitch le plus évident du monde - le virus qui transforme tout le monde en Michel Houellebecq - Ruben Fleischer nous brode un road-trip improbable, le tout vécu à travers quatre personnages phare. Columbus, étudiant timide qui essaie de retrouver sa famille dans l'Ohio, Tallahassee, dur à cuire armé jusqu'aux dents à la recherche du dernier Twinkie, son biscuit préféré, et deux sœurs qui tentent de rejoindre un parc d'attractions unissent leurs forces pour traverser tout le pays qui grouille de zombies. Le postulat est posé, encore fallait-il transcender les poncifs pour parvenir à équilibrer le frisson et l’émotion. Mais avec un tel casting, rien d’impossible. Jesse Eisenberg, Emma Stone, Woody Harrelson, et Abigail Breslin rivalisent de leur talent pour porter cette histoire archi-rebattue à des hauteurs insoupçonnables, et tels des Mamas and Papas de l’extrême, traversent ville sur ville en affrontant des dangers qui les touchent de manière différente. Si Colombus, rongé de tocs et de règles de survie nous rend allergique aux clowns, si Tallahassee donne un nouveau sens au swing d’une batte de baseball, Wichita et Little Rock, frangines pas si sages, incarnent les deux personnages les plus intelligents, ce qui change un peu de la routine horrifique qui utilise la plupart du temps la gent féminine comme appât à tueur en série. Outre la fascination de Woody pour ce gâteau spongieux, l’obsession de Jesse pour les mèches de cheveux passés derrière l’oreille et autres aventures dans des magasins de souvenirs, l’apparition incroyable de Bill Murray dans son propre rôle reste l’un des clins d’œil les plus savoureux du cinéma. Aussi drôle qu’il n’est attachant, Bienvenue à Zombieland reste à ce jour l’une des plus grandes réussites du cinéma d’horreur se permettant une incartade sur le terrain de la comédie. Le genre de film qu’on peut se passer et repasser sans s’en lasser, tant il fourmille de répliques cultes et de gimmicks addictifs. L’un d’entre eux figure d’ailleurs dès le générique. Alors que Columbus énonce les règles à respecter pour rester en vie, les zombies s’affairent sur l’écran au rythme du plombé « For Whom the Bell Tolls » de METALLICA, créant dès le départ une connexion avec le public Metal. Ajoutez aux californiens les autres californiens de VAN HALEN, un soupçon de BLUE OYSTER CULT, un morceau méchamment Rock des RACONTEURS de Jack White, et vous obtenez le cocktail le plus rafraichissant de 2009. En moins d’une heure et trente minutes, Ruben Fleischer réinvente la comédie horrifique, et pave la voie pour une séquelle sympathique, quoi que moins réussie. La classe.
 Petit détour innocent vers l’animation, et la sortie de Megamind en 2010 qui n’a évidemment rien à voir avec le jeu Mastermind. Megamind, c’est un super-vilain qui veut la peau des fesses de Metro Man, superhéros gentil comme tout. Une fois son ennemi juré terrassé, Megamind s’ennuie, puisqu’il n’a plus personne à affronter. Il se met donc à la recherche d’un adversaire à sa hauteur, provocant situations cocasses et autres délires pour enfants et grands qui ont su le rester. N’étant que très peu voire pas du tout porté sur l’animation, je n’ai vu ce film qu’une seule fois, mais il m’a fait bonne impression. Graphiquement très joli, il se situe dans une veine de Marvel simplifié pour bambins, sans les prendre pour de gentils crétins. L’action est addictive, les personnages travaillés, et les doublages assurés. Avec Will Ferrell, Jonah Hill et Brad Pitt, la diction est évidemment très adaptée, et la crédibilité renforcée. Sorte de blockbuster pour gosses émerveillés, Megamind prend le pli des directions artistiques modernes dans l’animation, plaçant l’humour au premier plan au détriment d’une moralité excessive. Musicalement, aussi étrange que cela puisse paraître, le soundtrack laisse se glisser les Guns N' Roses, AC/DC et Ozzy OSBOURNE, parachevant l’opinion de ceux qui pensent que le métrage peut aussi captiver les parents. Ce qui est totalement compréhensible, au vu de la qualité de la mise en scène et des dialogues. Animation fluide aux contours ronds, teintes bleutées de toute beauté, Megamind est une truffe au schtroumf en gélatine ferme, acidulée, et qui laisse la langue toute bleue. Et ça, c’est quand même super rigolo.
Petit détour innocent vers l’animation, et la sortie de Megamind en 2010 qui n’a évidemment rien à voir avec le jeu Mastermind. Megamind, c’est un super-vilain qui veut la peau des fesses de Metro Man, superhéros gentil comme tout. Une fois son ennemi juré terrassé, Megamind s’ennuie, puisqu’il n’a plus personne à affronter. Il se met donc à la recherche d’un adversaire à sa hauteur, provocant situations cocasses et autres délires pour enfants et grands qui ont su le rester. N’étant que très peu voire pas du tout porté sur l’animation, je n’ai vu ce film qu’une seule fois, mais il m’a fait bonne impression. Graphiquement très joli, il se situe dans une veine de Marvel simplifié pour bambins, sans les prendre pour de gentils crétins. L’action est addictive, les personnages travaillés, et les doublages assurés. Avec Will Ferrell, Jonah Hill et Brad Pitt, la diction est évidemment très adaptée, et la crédibilité renforcée. Sorte de blockbuster pour gosses émerveillés, Megamind prend le pli des directions artistiques modernes dans l’animation, plaçant l’humour au premier plan au détriment d’une moralité excessive. Musicalement, aussi étrange que cela puisse paraître, le soundtrack laisse se glisser les Guns N' Roses, AC/DC et Ozzy OSBOURNE, parachevant l’opinion de ceux qui pensent que le métrage peut aussi captiver les parents. Ce qui est totalement compréhensible, au vu de la qualité de la mise en scène et des dialogues. Animation fluide aux contours ronds, teintes bleutées de toute beauté, Megamind est une truffe au schtroumf en gélatine ferme, acidulée, et qui laisse la langue toute bleue. Et ça, c’est quand même super rigolo.
 En parlant de morale douteuse, celle de Cameron Diaz dans Bad Teacher est plus que borderline. Lorsque son riche fiancé rompt avec elle, la séductrice intéressée Elizabeth Halsey retourne à l’école secondaire : elle est une enseignante pathétique mais veut économiser pour se faire refaire les seins. Elle s’illumine lorsque Scott, un nouveau professeur, se révèle être riche et sexy. Habituée à montrer des films et à dormir en classe, elle change de braquet lorsqu’elle apprend qu’une prime est décernée au professeur dont la classe obtient les meilleurs résultats à l’examen d’état. Mais elle doit composer avec Amy, collègue aussi fourbe et bigote que proche de Scott. Amy cherche des renseignements sur Elizabeth, persuadé qu’elle ne s’intéresse à lui que pour son argent. Et si l’honnêteté avec les étudiants semble être sa seule compétence, elle ne remarque même pas que Russell, prof de gym drôle et sympa s’intéresse à elle. Une fois le sempiternel bla-bla burlesque posé, Bad Teacher s’avère beaucoup plus drôle que son affiche et son pitch ne le laissaient supposer. Si Cameron Diaz est évidemment brillante dans la peau de cette fumiste opportuniste, ce sont surtout Justin Timberlake et Lucy Punch qui sont irrésistibles en couple pieux et totalement niais. Sur une base de rom-com cocasse, Jake Kasdan profite des trouvailles de son scénario pour mettre en scène des situations impayables, dans la plus droite lignée des classiques des années 80, Porky’s et Police Academy en tête de liste. Evidemment assez loin du formalisme d’un Woody Allen ou de la folie déjantée des frangins Farrelly (Diaz a été à bonne école), Bad Teacher n’est rien de plus que la somme de ses gros éléments, et laisse évidemment la porte ouverte à une morale plus en adéquation avec les valeurs de l’Amérique. N’est pas John Waters qui veut, mais en saupoudrant du WHITESNAKE, du JUDAS PRIEST, du DIO et du Joan JETT, on obtient un bon gros cake sucré-salé-épicé. Et vu le niveau souvent atteint par les comédies américaines familiales, autant prendre ce qu’on vous donne.
En parlant de morale douteuse, celle de Cameron Diaz dans Bad Teacher est plus que borderline. Lorsque son riche fiancé rompt avec elle, la séductrice intéressée Elizabeth Halsey retourne à l’école secondaire : elle est une enseignante pathétique mais veut économiser pour se faire refaire les seins. Elle s’illumine lorsque Scott, un nouveau professeur, se révèle être riche et sexy. Habituée à montrer des films et à dormir en classe, elle change de braquet lorsqu’elle apprend qu’une prime est décernée au professeur dont la classe obtient les meilleurs résultats à l’examen d’état. Mais elle doit composer avec Amy, collègue aussi fourbe et bigote que proche de Scott. Amy cherche des renseignements sur Elizabeth, persuadé qu’elle ne s’intéresse à lui que pour son argent. Et si l’honnêteté avec les étudiants semble être sa seule compétence, elle ne remarque même pas que Russell, prof de gym drôle et sympa s’intéresse à elle. Une fois le sempiternel bla-bla burlesque posé, Bad Teacher s’avère beaucoup plus drôle que son affiche et son pitch ne le laissaient supposer. Si Cameron Diaz est évidemment brillante dans la peau de cette fumiste opportuniste, ce sont surtout Justin Timberlake et Lucy Punch qui sont irrésistibles en couple pieux et totalement niais. Sur une base de rom-com cocasse, Jake Kasdan profite des trouvailles de son scénario pour mettre en scène des situations impayables, dans la plus droite lignée des classiques des années 80, Porky’s et Police Academy en tête de liste. Evidemment assez loin du formalisme d’un Woody Allen ou de la folie déjantée des frangins Farrelly (Diaz a été à bonne école), Bad Teacher n’est rien de plus que la somme de ses gros éléments, et laisse évidemment la porte ouverte à une morale plus en adéquation avec les valeurs de l’Amérique. N’est pas John Waters qui veut, mais en saupoudrant du WHITESNAKE, du JUDAS PRIEST, du DIO et du Joan JETT, on obtient un bon gros cake sucré-salé-épicé. Et vu le niveau souvent atteint par les comédies américaines familiales, autant prendre ce qu’on vous donne.
 Il arrive souvent qu’un film soit exactement ce qu’il prétend être. La plupart du temps même. Je ne parle pas ici de twist plus ou moins habile qui tente de justifier une heure et trente minutes de formalisme, mais bien d’un scénario habile jouant avec les clichés d’un style pour le transcender, et offrir un travail novateur et captivant. Sur le papier, La Cabane dans les Bois avait tout pour être un énième slasher radiocommandé par un réalisateur lambda. Le cahier des charges respecté à la lettre, entre acteurs jeunes et sexy, prétexte à la Evil Dead, endroit isolé et occultisme bon marché. Avec un casting alléchant (Chris Hemsworth, Jesse Williams, Kristen Connolly et Anna Hutchison), l’éternel benêt drogué en sidekick, et un spot plutôt inquiétant, Drew Goddard brode avec l’incontournable Joss Whedon (Buffy, évidemment) une histoire incroyable de jeu télévisé diffusé dans le monde entier, auquel participe chaque pays. Si les premières mesures du film laissent augurer d’une suite hautement prévisible à l’arme blanche, La Cabane dans les Bois dévie soudainement de sa trajectoire, et nous entraîne dans un imbroglio de grands Dieux anciens régissant la terre, et exigeant des sacrifices pour laisser les humains tranquilles. A ce petit jeu du « tu ne devineras jamais », La Cabane dans les Bois est un modèle absolu, et un sursaut de créativité dans l’univers sclérosé de l’horreur qui préfère souvent recycler qu’inventer. Meilleur film de sa génération, régulièrement cité en exemple, il profite de cet enfumage pour nous bombarder les oreilles avec BLIND GUARDIAN, POWERWOLF, IRON MAIDEN, Iggy POP, NINE INCH NAILS, qui trouvent là une promotion incroyable. Et lorsqu’un film est au diapason de sa musique, le résultat ne peut être que brillant. Ce qui est assurément le cas ici.
Il arrive souvent qu’un film soit exactement ce qu’il prétend être. La plupart du temps même. Je ne parle pas ici de twist plus ou moins habile qui tente de justifier une heure et trente minutes de formalisme, mais bien d’un scénario habile jouant avec les clichés d’un style pour le transcender, et offrir un travail novateur et captivant. Sur le papier, La Cabane dans les Bois avait tout pour être un énième slasher radiocommandé par un réalisateur lambda. Le cahier des charges respecté à la lettre, entre acteurs jeunes et sexy, prétexte à la Evil Dead, endroit isolé et occultisme bon marché. Avec un casting alléchant (Chris Hemsworth, Jesse Williams, Kristen Connolly et Anna Hutchison), l’éternel benêt drogué en sidekick, et un spot plutôt inquiétant, Drew Goddard brode avec l’incontournable Joss Whedon (Buffy, évidemment) une histoire incroyable de jeu télévisé diffusé dans le monde entier, auquel participe chaque pays. Si les premières mesures du film laissent augurer d’une suite hautement prévisible à l’arme blanche, La Cabane dans les Bois dévie soudainement de sa trajectoire, et nous entraîne dans un imbroglio de grands Dieux anciens régissant la terre, et exigeant des sacrifices pour laisser les humains tranquilles. A ce petit jeu du « tu ne devineras jamais », La Cabane dans les Bois est un modèle absolu, et un sursaut de créativité dans l’univers sclérosé de l’horreur qui préfère souvent recycler qu’inventer. Meilleur film de sa génération, régulièrement cité en exemple, il profite de cet enfumage pour nous bombarder les oreilles avec BLIND GUARDIAN, POWERWOLF, IRON MAIDEN, Iggy POP, NINE INCH NAILS, qui trouvent là une promotion incroyable. Et lorsqu’un film est au diapason de sa musique, le résultat ne peut être que brillant. Ce qui est assurément le cas ici.
 Hellion ne joue pas dans la même catégorie, mais nous concerne encore plus directement. Lorsque Jacob, 13 ans, passionné de motocross et de Heavy Metal commence à sombrer dans la délinquance, les services sociaux à l’enfance se voient forcés de placer son petit frère, Wes, avec sa tante. Jacob et son père émotionnellement absent, Hollis, doivent enfin prendre la responsabilité de leurs actions et tout faire pour ramener Wes à la maison. Un scénario assez classique, pour un métrage hésitant entre drame et thriller, et échouant de peu dans les deux catégories. Si les prestations sont toutes très raisonnables, une mise en scène peu inventive et un climat trop forcé peinent à convaincre et à s’identifier aux personnages, un peu trop cliché pour convaincre. Si l’on apprécie toujours de voir Aaron Paul et Juliette Lewis à l’écran, ce sont les plus jeunes qui emportent l’adhésion, parfaits dans les moments de colère et d’émotion. Kat Candler, réalisatrice capable, a signé pour la petite histoire un court métrage sobrement baptisé Black Metal, dont le récit de meurtre sous l’emprise d’un style musical nihiliste est assez caractéristique des goûts personnels. Mais pour Hellion, Kat Candler peine à convaincre, nous laissant parfois bien seuls avec cette bande-originale, l’une des meilleures de ce dossier. Rien de moins que METALLICA, SLAYER, TOXIC HOLOCAUST, CONTRABAND et quelques autres friandises, qui n’attendent que vous pour être dégustées, sur fond de trame dramatique de l’Amérique rurale constamment en prise avec ses démons et sa solitude.
Hellion ne joue pas dans la même catégorie, mais nous concerne encore plus directement. Lorsque Jacob, 13 ans, passionné de motocross et de Heavy Metal commence à sombrer dans la délinquance, les services sociaux à l’enfance se voient forcés de placer son petit frère, Wes, avec sa tante. Jacob et son père émotionnellement absent, Hollis, doivent enfin prendre la responsabilité de leurs actions et tout faire pour ramener Wes à la maison. Un scénario assez classique, pour un métrage hésitant entre drame et thriller, et échouant de peu dans les deux catégories. Si les prestations sont toutes très raisonnables, une mise en scène peu inventive et un climat trop forcé peinent à convaincre et à s’identifier aux personnages, un peu trop cliché pour convaincre. Si l’on apprécie toujours de voir Aaron Paul et Juliette Lewis à l’écran, ce sont les plus jeunes qui emportent l’adhésion, parfaits dans les moments de colère et d’émotion. Kat Candler, réalisatrice capable, a signé pour la petite histoire un court métrage sobrement baptisé Black Metal, dont le récit de meurtre sous l’emprise d’un style musical nihiliste est assez caractéristique des goûts personnels. Mais pour Hellion, Kat Candler peine à convaincre, nous laissant parfois bien seuls avec cette bande-originale, l’une des meilleures de ce dossier. Rien de moins que METALLICA, SLAYER, TOXIC HOLOCAUST, CONTRABAND et quelques autres friandises, qui n’attendent que vous pour être dégustées, sur fond de trame dramatique de l’Amérique rurale constamment en prise avec ses démons et sa solitude.
 Passons à la catégorie supérieure avec l’anxiogène Green Room. Jeremy Saulnier nous propose une histoire plutôt originale, celle d’un groupe de Punk-Hardcore qui se voit forcé de se battre pour sa survie après avoir été témoin d'un meurtre commis dans un bar néo-nazi de skinheads. Evidemment, la confrontation est rudement violente, à l’image de cette musique jouée sur scène face à un public de dégénérés néo-fascistes. Pour bien provoquer l’audience, le groupe se lance dans une interprétation fiévreuse du classique « Nazi Punks Fuck Off » des DEAD KENNEDYS, chauffant à blanc une salle qui n’en demandait pas tant pour exploser. Le reste est un magnifique jeu de chat et de souris, entre des musiciens en sous-nombre et des fachos lourdement armés et déterminés. Il est impossible de ne pas se prendre de passion pour ces individualités qui luttent pour leurs opinions, et plus simplement pour leur vie, face à ces sous-hommes nostalgiques d’une époque de haine et de xénophobie. Très en phase avec les obsessions de son époque, Green Room jette un regard sans fard sur ces factions de l’alt-right qui constituent aujourd’hui une grosse partie de la base votante de ce cher Donald « no suntan » Trump, et dont les rangs grossissent d’année en année, créant un inquiétant phénomène de résonnance plus que de résilience. Plus prosaïquement, qui dit Punk-Hardcore dit évidemment soundtrack ad hoc, et on trouve dans les sillons du BATTLETORN, du FEAR, du HUMAN BRAINS, HOCHSTEDDER, POISON IDEA, NAPALM DEATH, SYPHILITIC LUST, les DEAD KENNEDYS bien sûr, OBITUARY, SLAYER, et les BAD BRAINS. Un sacré générique pour un film coup de poing, qu’on ne regrette pas d’avoir vu mais qu’on hésite toujours à voir de nouveau, eu égard à sa violence abrupte et extrêmement réaliste. Et toujours d’actualité, malheureusement.
Passons à la catégorie supérieure avec l’anxiogène Green Room. Jeremy Saulnier nous propose une histoire plutôt originale, celle d’un groupe de Punk-Hardcore qui se voit forcé de se battre pour sa survie après avoir été témoin d'un meurtre commis dans un bar néo-nazi de skinheads. Evidemment, la confrontation est rudement violente, à l’image de cette musique jouée sur scène face à un public de dégénérés néo-fascistes. Pour bien provoquer l’audience, le groupe se lance dans une interprétation fiévreuse du classique « Nazi Punks Fuck Off » des DEAD KENNEDYS, chauffant à blanc une salle qui n’en demandait pas tant pour exploser. Le reste est un magnifique jeu de chat et de souris, entre des musiciens en sous-nombre et des fachos lourdement armés et déterminés. Il est impossible de ne pas se prendre de passion pour ces individualités qui luttent pour leurs opinions, et plus simplement pour leur vie, face à ces sous-hommes nostalgiques d’une époque de haine et de xénophobie. Très en phase avec les obsessions de son époque, Green Room jette un regard sans fard sur ces factions de l’alt-right qui constituent aujourd’hui une grosse partie de la base votante de ce cher Donald « no suntan » Trump, et dont les rangs grossissent d’année en année, créant un inquiétant phénomène de résonnance plus que de résilience. Plus prosaïquement, qui dit Punk-Hardcore dit évidemment soundtrack ad hoc, et on trouve dans les sillons du BATTLETORN, du FEAR, du HUMAN BRAINS, HOCHSTEDDER, POISON IDEA, NAPALM DEATH, SYPHILITIC LUST, les DEAD KENNEDYS bien sûr, OBITUARY, SLAYER, et les BAD BRAINS. Un sacré générique pour un film coup de poing, qu’on ne regrette pas d’avoir vu mais qu’on hésite toujours à voir de nouveau, eu égard à sa violence abrupte et extrêmement réaliste. Et toujours d’actualité, malheureusement.
 Parlons brièvement du cas moyennement intéressant de Some Kind of Hate, film d’horreur anonyme pour fans indécrottables d’esprits vengeurs et de malédiction incontournable. Un adolescent victime de harcèlement est envoyé dans une maison de redressement où il invoque accidentellement l’esprit d’une jeune fille, elle-même victime, qui se venge de ses bourreaux. Une histoire tellement rebattue qu’on pourrait organiser Roland Garros dessus, et mise en scène par un réalisateur peu inspiré par la thématique. Les clichés sont donc égrenés avec minutie, les personnages héritant du caractère le plus standard possible pour ne prendre aucun risque. Unidimensionnel, Some Kind of Hate est en quelque sorte l’archétype du film d’horreur que vous allez regarder lors d’une soirée particulièrement oisive, et qui ne réclamera pas plus d’attention que votre chat se soulageant dans sa litière. Mais - et c’est la raison de sa présence ici - le film nous permet d’apprécier un morceau de MYRKUR dans un contexte particulier, et un autre des méconnus SERPENTINE PATH dont le Sludge/Doom prend une saveur nouvelle mis en images. On peut se dire que c’est bien peu, et pas suffisant pour s’infliger pareille purge, et je ne pourrais contredire l’argument.
Parlons brièvement du cas moyennement intéressant de Some Kind of Hate, film d’horreur anonyme pour fans indécrottables d’esprits vengeurs et de malédiction incontournable. Un adolescent victime de harcèlement est envoyé dans une maison de redressement où il invoque accidentellement l’esprit d’une jeune fille, elle-même victime, qui se venge de ses bourreaux. Une histoire tellement rebattue qu’on pourrait organiser Roland Garros dessus, et mise en scène par un réalisateur peu inspiré par la thématique. Les clichés sont donc égrenés avec minutie, les personnages héritant du caractère le plus standard possible pour ne prendre aucun risque. Unidimensionnel, Some Kind of Hate est en quelque sorte l’archétype du film d’horreur que vous allez regarder lors d’une soirée particulièrement oisive, et qui ne réclamera pas plus d’attention que votre chat se soulageant dans sa litière. Mais - et c’est la raison de sa présence ici - le film nous permet d’apprécier un morceau de MYRKUR dans un contexte particulier, et un autre des méconnus SERPENTINE PATH dont le Sludge/Doom prend une saveur nouvelle mis en images. On peut se dire que c’est bien peu, et pas suffisant pour s’infliger pareille purge, et je ne pourrais contredire l’argument.
 Terminons en beauté ce panorama évidemment loin d’être exhaustif, par un hold-up de haut vol ayant passionné les fans d’Oceans Eleven. The Big Short : Le Casse du Siècle nous raconte trois histoires parallèles, toutes reliées par la fameuse crise des prêts au logement et des conséquences qu’elle a eue sur la vie d’investisseurs lambda. Avec un casting de luxe (Christian Bale, Brad Pitt, Steve Carell, Ryan Gosling, les dames sont comblées), le film d’Adam McKay (déjà présent dans cette liste via Ricky Bobby, Roi du Circuit) parvient à rendre visible cette profonde rupture entre le milieu de la finance, corrompu jusqu’à l’os et la classe moyenne qui a vu ses économies et placements fondre comme neige au soleil. Tragédie américaine comme seul le capitalisme acharné peut en produire, la crise des subprimes est l’un des derniers témoignages de la catastrophe sur laquelle le système financier US repose, avec des prêts à taux indécents qui terminent dans la corbeille eu égard aux spéculations de traders sans scrupules. L’histoire est portée à bout de bras par ses acteurs tous aussi brillants les uns que les autres, et cette manière de traiter l’action en scindant l’intrigue permet au métrage de garder un rythme très soutenu. A la hauteur des meilleurs films de fauche de l’histoire, The Big Short renoue avec la tradition américaine du film chorale, spécialité de Robert Altman, et ici mise en lumière par un résisteur surdoué, maîtrisant complétement la complexité de son sujet. Adam McKay nous gâte encore une fois en choisissant certains de nos groupes préférés, et case METALLICA, PANTERA, GUNS N’ROSES, mais aussi MASTODON et LED ZEPPELIN, qui achèvent de souligner l’action de riffs en béton. Un film que je recommande chaudement, et qui laisse un arrière-goût très amer dans la bouche.
Terminons en beauté ce panorama évidemment loin d’être exhaustif, par un hold-up de haut vol ayant passionné les fans d’Oceans Eleven. The Big Short : Le Casse du Siècle nous raconte trois histoires parallèles, toutes reliées par la fameuse crise des prêts au logement et des conséquences qu’elle a eue sur la vie d’investisseurs lambda. Avec un casting de luxe (Christian Bale, Brad Pitt, Steve Carell, Ryan Gosling, les dames sont comblées), le film d’Adam McKay (déjà présent dans cette liste via Ricky Bobby, Roi du Circuit) parvient à rendre visible cette profonde rupture entre le milieu de la finance, corrompu jusqu’à l’os et la classe moyenne qui a vu ses économies et placements fondre comme neige au soleil. Tragédie américaine comme seul le capitalisme acharné peut en produire, la crise des subprimes est l’un des derniers témoignages de la catastrophe sur laquelle le système financier US repose, avec des prêts à taux indécents qui terminent dans la corbeille eu égard aux spéculations de traders sans scrupules. L’histoire est portée à bout de bras par ses acteurs tous aussi brillants les uns que les autres, et cette manière de traiter l’action en scindant l’intrigue permet au métrage de garder un rythme très soutenu. A la hauteur des meilleurs films de fauche de l’histoire, The Big Short renoue avec la tradition américaine du film chorale, spécialité de Robert Altman, et ici mise en lumière par un résisteur surdoué, maîtrisant complétement la complexité de son sujet. Adam McKay nous gâte encore une fois en choisissant certains de nos groupes préférés, et case METALLICA, PANTERA, GUNS N’ROSES, mais aussi MASTODON et LED ZEPPELIN, qui achèvent de souligner l’action de riffs en béton. Un film que je recommande chaudement, et qui laisse un arrière-goût très amer dans la bouche.
(à suivre...)
Commentaires (4) | Ajouter un commentaire
Humungus
@83.196.136.179
Poh poh poh poh... ... ...
Tout le monde ici à l'habitude de te remercier pour la somme de taf fournie mortne2001, mais là... Là, on peut dire que tu t'es surpassé.
Improbable cette énumération.
Et le pire, c'est qu'apparemment ce n'est pas fini.
Je me pose alors une question : Est-ce que tu te souviens de mémoire de tous ces groupes présents dans tous ces films où est-ce que tu as "triché" via le net ?
Si c'est la première hypothèse, Asperger n'est pas bien loin l'ami... ... ...
Au delà de tout cela, une autre question malheureusement plus triviale :
Est-ce que ce bréviaire est foncièrement utile ?
Car au vu du pourcentage plus que conséquent de bouses listées ici, vaut vraiment mieux passer son chemin hé hé hé... ... ...
mortne2001
membre enregistré
Cher Humungus,
Je connaissais à peu près 95% des films cités, j'ai cherché sur la toile pour compléter. Il y a quand même de sacrés bons films dans la liste, qui excusent les quelques daubes qui traînent. Mais je suis d'accord pour dire que c'est la partie la moins intéressante du dossier. La troisième partie sera à mon goût la meilleure.
Ivan Grozny
membre enregistré
Le grand drame du metal est de mal se marier à l'audiovisuel généralement. C'est très vite too much. Hâte de découvrir la 3e partie de ce passionnant dossier néanmoins. Merci mortne2001.
Sphincter Desecrator
@2.8.159.124
Quel boulot, encore! Bravo!
Ajouter un commentaire
Derniers articles
Concerts à 7 jours
Tags
Photos stream
Derniers commentaires
Au vu de la dernière vidéo-ITW en date du gonze sur ce site, pour ce qui est de "feu sacré", il a toujours l'air de l'avoir le mec.Je pars donc confiant.
08/05/2025, 09:17
@ MobidOM :oui, pas faux pour la "captation d'héritage" ! :-/ En même temps, s'il a encore le feu sacré et propose un truc pas trop moisi... De toute façon la critique sera sans pitié si le truc ne tient pas la(...)
07/05/2025, 11:52
Ah ce fameux BRUTAL TOUR avec Loudblast / MASSACRA / No Return et Crusher en 95 ! LA PUTAIN de bonne époque
07/05/2025, 11:04
@ Oliv : Montpellier étant une ville et une agglomération plus petite que Lyon, il n'y a véritablement de la place que pour deux petites salles orientées Rock-Metal-Punk-etc, à ce qui me semble après vingt-cinq ans d'observation. Au-delà,(...)
06/05/2025, 20:29
"Death To All", à chaque fois que je les ai vu ils avaient un line-up tout à fait légitime (dont une fois tous les musiciens qui ont joué sur "Human", à part Chuck bien sûr)Et puis la phrase "Chris Palengat pr(...)
06/05/2025, 20:28
Je ne vois pas beaucoup l'intérêt, et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas attendu les trente ans de l'album l'an prochain. Ces dernières semaines je me retape les premiers, et ça reste un bonheur.
06/05/2025, 19:29
Vénérant ces albums et n'ayant jamais vu la vraie incarnation de Massacra, hors de question de louper ça (si ça passe à portée de paluche, pas à Pétaouchnok). Un peu comme un "Death To All"...
06/05/2025, 17:11
Ils sont juste trop faux-cul pour assumer le statut de tribute band, voilà tout.
06/05/2025, 16:15
Si je comprends bien il n'y a qu'un seul membre d'origine ? et évidemment que c'est un tribute band, comment l'appeler autrement. à ce point autant commencer un nouveau groupe avec un clin d'oeil, pour affirmer une certaine continuité. Faut assum(...)
06/05/2025, 05:51
Perso, je suis plutôt preneur ! Reste plus qu'à espérer que ce soit à la hauteur de mes attentes !(Faut bien avouer que même si je suis fan de l'album Sick, mon préféré reste Enjoy the Violence ! Quelle tuerie absol(...)
05/05/2025, 23:34
J'ai eu la chance de les voir il y quelques semaines dans une salle stéphanoise chauffée à blanc et je peux vous dire qu'on va entendre parler de ces garagnats dans le monde entier !!!! Du grand art .
05/05/2025, 18:16
Après j'ai 50 balais et je ne vais plus trop a des concerts ou festival et pourtant j'ai le sylak a 10 minutes de chez moi mais ce n'est plus ma tasse de thé et désintéressé de la scène actuelle et l'ambiance qui ne me correspond(...)
04/05/2025, 12:35
C'est très surprenant car Montpellier est bien connu pour être étudiant , dynamique et jeune . Je ne comprends pas ces difficultés car je ne maîtrise pas tout alors qu' a l'inverse dans la région Lyonnaise où je suis , c'est plut&oci(...)
04/05/2025, 12:25
Moi j'y serai !Avec les copains de Sleeping Church Records, on sera sur place !
04/05/2025, 09:55
Je l'ai essayé, alors que je n'écoute plus Benediction depuis beau temps. Ce sont des vétérans et le retour de popularité du Death vieille école leur vaut une certaine popularité, qui n'est pas volée au regard de cette long&ea(...)
03/05/2025, 22:39
T'as même pas le courage de dire que c'est un comportement typique de la population noire américaine, ce qui n'a aucun rapport ici.
03/05/2025, 21:41